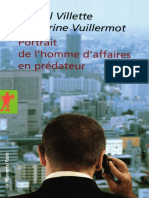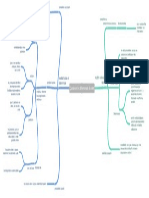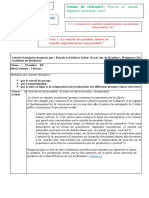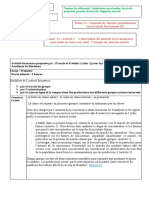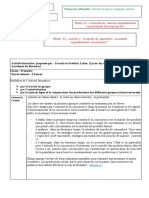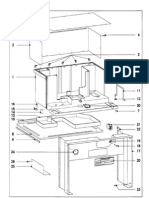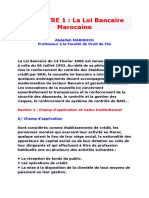Professional Documents
Culture Documents
Correction Keynes
Correction Keynes
Uploaded by
Mme et Mr LafonCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Correction Keynes
Correction Keynes
Uploaded by
Mme et Mr LafonCopyright:
Available Formats
ENSEIGNEMENT DE SPCIALIT
Ce sujet comporte un document. THME DU PROGRAMME : Sous-emploi et demande DOCUMENT [...] La thorie classique a t habitue expliquer l'aptitude suppose du systme conomique s'ajuster de lui-mme par la prtendue fluidit des salaires nominaux et, quand ceux-ci sont rigides, rendre cette rigidit responsable du non-ajustement. [...] Le raisonnement est simplement qu'une rduction des salaires nominaux, toutes choses gales d'ailleurs, stimule la demande en abaissant le prix des produits finis, et par suite qu'elle dveloppe la production et l'emploi [...]. Dans sa forme la plus sommaire un tel raisonnement revient supposer que la rduction des salaires nominaux laisse la demande inchange. [...] Personne en effet ne songerait nier que, lorsque la demande effective reste constante, une rduction des salaires nominaux s'accompagne d'une augmentation de l'emploi ; mais la question rsoudre est prcisment de savoir si la rduction des salaires nominaux laissera subsister ou non une demande effective globale qui, mesure en monnaie, sera gale la demande antrieure ou n'aura pas, du moins, subi une rduction pleinement proportionnelle celle des salaires nominaux [...]. [...] Une rduction des salaires nominaux a-t-elle pour effet direct, toutes choses gales d'ailleurs, d'augmenter l'emploi ? [...] la question nous avons dj rpondu par la ngative [...]. Nous avons dmontr en effet que le volume de l'emploi est associ par une relation biunivoque au montant de la demande effective [...], et que la demande effective tant la somme de la consommation et de l'investissement attendus, ne peut pas varier si la propension consommer, la courbe de l'efficacit marginale du capital et le taux d'intrt demeurent tous inchangs.
Source : John Maynard KEYNES, Thorie gnrale de l'emploi, de l'intrt et de la monnaie (1re dition 1936), Payot, 1969.
QUESTIONS 1 ) l'aide de vos connaissances et du document, vous montrerez comment J.M. KEYNES s'oppose l'analyse (no)classique prconisant la baisse des salaires pour atteindre le plein emploi. (8 points) 2 ) En vous appuyant sur le dernier paragraphe, vous prsenterez les diffrents lments qui dterminent la demande effective. (6 points) 3 ) Dans une logique keynsienne, un programme d'investissements publics permettrait-il de soutenir la croissance ? Illustrez votre rponse l'aide d'un exemple. (6 points)
1. John Maynard Keynes est n dans un milieu bourgeois victorien caractris par le sens des affaires, le got des belles choses, l'intellectualisme et l'lvation morale. Malgr son appartenance llite anglaise, il dveloppe une analyse contraire celle dveloppe son poque. Il soppose notamment lanalyse no-classique du march du travail qui postule que le chmage peut tre rsolu en diminuant les salaires. Son explication repose sur plusieurs points : Si le march du travail est en cpp,les offres et les demandes de travail sy rencontrent. L'galisation entre l'offre globale et la demande globale de travail, toutes deux dtermines par somme des offres et des demandes individuelles, va permettre de dterminer d'une part le salaire d'quilibre, ce salaire toutes les offres et toutes les demandes sont ralises et satisfaites, d'autre part, le niveau optimal de l'emploi. Cet quilibre est un quilibre de plein emploi qui est stable ;lorsque le systme s'loigne de sa position d'quilibre, des forces internes au systme tendront le ramener l'quilibre. En effet, les mcanismes de march quand ils jouent librement permettent un retour spontan l'quilibre. Si pour une raison quelconque lquilibre se dtriore, la flexibilit des prix (= des salaires) va permettre un retour lquilibre. Il ne peut donc exister que deux types de chmage pour les noclassiques :un chmage volontaire qui rsulte d'un refus individuel ou collectif d'accepter de travailler au salaire dquilibre qui permet d'galiser offres et demandes d'emploi et un chmage frictionnel li aux ajustements ncessaires de loffre et de la demande sur la march du travail court terme. La baisse des salaires na aucune influence sur la demande de biens et services daprs la loi de Say : L'offre cre sa propre demande. ou encore Les produits s'changent contre des produits. Le processus de production d'un bien destin tre vendu sur le march engendre la cration d'un revenu grce auquel ce bien peut tre achet. Cest ce que lon appelle la loi des dbouchs de Say. Toute crise de surproduction s'avre impossible dans la mesure o le montant des ventes des entreprises (somme des valeurs ajoutes) en tant intgralement revers et reparti entre les salaris et les capitalistes sous forme de revenus, assure un dbouch la production. L'pargne, loin d'tre une fuite, sert intgralement au financement de l'investissement via le march des fonds prtables (= march des capitaux). Keynes va rfuter ces diffrents points : Il rfute dabord la loi de Say : Selon Keynes en effet, la monnaie n'est pas seulement demande pour des motifs de transaction mais galement pour des motifs de prcaution (du fait de l'incertitude pesant sur l'avenir) et de spculation (la liquidit peut ainsi tre mise de ct et tre affecte l'achat d'obligations lorsque des opportunits se prsenteront).Ces deux dernires raisons (prcaution et spculation) de dtenir des encaisses montaires (= sommes dargent dtenus par un individu) constituent une dperdition pour l'conomie puisqu'il s'agit d'encaisses oisives (=qui nont aucun effet dentranement sur lconomie). Cette dperdition, en effet, met mal la croyance selon laquelle l'offre crerait sa propre demande. L'existence d'une thsaurisation rend ds lors possible, voir probable, des dsquilibres entre l'offre et la demande et avec eux des crises de sous-consommation. La baisse des salaires peut alors avoir un effet sur la demande de biens et services. Si les salaris ont des revenus en baisse, leur niveau de consommation diminue, ce qui incite les entreprises produire moins et donc licencier. Comme la demande effective diminue, la demande de travail diminue aussi. Alors que loffre de travail, contrairement ce que disent les no-classiques ne diminue pas avec la baisse des salaires. En effet la demande de travail dpend de variables structurelles long terme : comportements dmographiques, attitude face lactivit des femmes, allongement des tudes
Keynes observe alors quil ny a aucune raison pour que le niveau de lemploi corresponde au plein emploi (cest dire lutilisation de toute la force de travail disponible dans lconomie). Le chmage qui rsulte de la diffrence entre le niveau de lemploi et leffectif de la population active peut donc tre involontaire,car les ouvriers seraient prts travailler au salaire existant mais ne trouvent pas de travail Dans ces conditions, la baisse des salaires engendre une hausse du chmage
2. La demande effective dpend : De la consommation : qui dpend : o Du revenu global de la population o De la propension consommer : la part du revenu affect la consommation. La propension consommer globale sera dautant plus forte que les ingalits de revenu seront faibles, puisque ce sont les plus pauvres qui ont la propension consommer la plus forte De linvestissement : qui dpend o De lefficacit marginale du capital : le rendement escompt de linvestissement (= gains quest susceptible dapporter linvestissement) va dpendre des prvisions que font les entrepreneurs sur le long terme quant la variation de la demande, aux changements de gots des consommateurs, lvolution prvisible des salaires o Du taux dintrt, cest--dire du cot de lemprunt o Tant que lefficacit marginale du capital est suprieur au taux dintrt, lentreprise a intrt investir 3. Ainsi il ny a que peu de chances pour que le volume de production qui est mis en place dans lconomie corresponde spontanment celui qui assure le plein emploi. Keynes pense que lEtat doit alors soutenir la demande effective pour assurer le plein emploi. Un mode daction est de recourir la dpense publique. LEtat peut certes encourager linvestissement priv en diminuant les taux dintrt mais il peut galement investir lui-mme en recourant au dficit budgtaire : cest la socialisation de linvestissement. Ainsi, lors du plan de relance franais aprs la crise de 2007, le gouvernement a particip au financement des lignes TGV du Grand Est. Investissement supplmentaire hausse de la demande effective hausse de la production hausse de la demande de travail baisse du chmage hausse des revenus hausse de la demande effective hausse de la production hausse de la demande de travail On retrouve le principe du multiplicateur dinvestissement keynsien selon lequel, un supplment dinvestissement dans lconomie entrane un supplment de production grce au supplment de demande quil induit. Ainsi, lorsque la demande augmente les entreprises sont incites mettre en oeuvre un volume de production et donc demploi plus importants.
You might also like
- Rapport Du Comité Chargé Du Travail Sur La ConstitutionDocument9 pagesRapport Du Comité Chargé Du Travail Sur La ConstitutionalexNo ratings yet
- Portrait de L'homme D'affaires en PrédateurDocument296 pagesPortrait de L'homme D'affaires en PrédateurCaptain Trroie100% (1)
- Les Problèmes D'asymétrie D'information Au Sein de L'entreprise PDFDocument5 pagesLes Problèmes D'asymétrie D'information Au Sein de L'entreprise PDFmed_kerroumi76No ratings yet
- Les Instruments Et Les Objectifs de La Politique Monétaire EuropéenneDocument27 pagesLes Instruments Et Les Objectifs de La Politique Monétaire EuropéenneElFuegoDios100% (4)
- Sujets Possibles Par Toile SESDocument2 pagesSujets Possibles Par Toile SESMme et Mr Lafon0% (1)
- Fiche 1113 - Des Inégalités Multiformes Et Cumulatives ?Document2 pagesFiche 1113 - Des Inégalités Multiformes Et Cumulatives ?Mme et Mr Lafon100% (1)
- 11 - Les Composantes Institutionnelles Des Régimes DémocratiquesDocument8 pages11 - Les Composantes Institutionnelles Des Régimes DémocratiquesMme et Mr Lafon100% (2)
- Correctionthème 2131 - Comment Définir La MondialisationDocument4 pagesCorrectionthème 2131 - Comment Définir La MondialisationMme et Mr LafonNo ratings yet
- Activité 1 - Les Institutions de La DémocratieDocument5 pagesActivité 1 - Les Institutions de La DémocratieMme et Mr Lafon100% (1)
- Fiche Révision Programme PremièreDocument2 pagesFiche Révision Programme PremièreMme et Mr LafonNo ratings yet
- Fiche Introductive - La Classification de La Population Par l'INSEEDocument3 pagesFiche Introductive - La Classification de La Population Par l'INSEEMme et Mr Lafon100% (2)
- Coorection À Partir de Devoirs ÉlèvesDocument2 pagesCoorection À Partir de Devoirs ÉlèvesMme et Mr Lafon100% (1)
- Fixhe 1112 - La Mesure Des InégalitésDocument3 pagesFixhe 1112 - La Mesure Des InégalitésMme et Mr LafonNo ratings yet
- Dossier Documentaire de l'EC3 Du 24 Mai 2018Document7 pagesDossier Documentaire de l'EC3 Du 24 Mai 2018Mme et Mr LafonNo ratings yet
- Thème 5.21 - Analyse Des Recettes Publiques Les Prélèvements ObligatoiresDocument7 pagesThème 5.21 - Analyse Des Recettes Publiques Les Prélèvements ObligatoiresMme et Mr LafonNo ratings yet
- 43 - Activité 1 - La Création MonétaireDocument1 page43 - Activité 1 - La Création MonétaireMme et Mr LafonNo ratings yet
- Activité 1 Construction Politiqueunion EuropéenneDocument4 pagesActivité 1 Construction Politiqueunion EuropéenneMme et Mr LafonNo ratings yet
- Correctionthème 3123 - Les Instruments Des Politiques ClimatiquesDocument7 pagesCorrectionthème 3123 - Les Instruments Des Politiques ClimatiquesMme et Mr LafonNo ratings yet
- 2121 - Les Instruments Du ProtectionnismeDocument3 pages2121 - Les Instruments Du ProtectionnismeMme et Mr Lafon100% (1)
- 2131 - Comment Définir La MondialisationDocument2 pages2131 - Comment Définir La MondialisationMme et Mr Lafon100% (1)
- Quels Sont Les Dterminants Du Vote PDFDocument1 pageQuels Sont Les Dterminants Du Vote PDFMme et Mr LafonNo ratings yet
- Correctionthème 3123 - Les Instruments Des Politiques ClimatiquesDocument7 pagesCorrectionthème 3123 - Les Instruments Des Politiques ClimatiquesMme et Mr LafonNo ratings yet
- Activité 1 Les Monnaies Locales ComplémentairesDocument2 pagesActivité 1 Les Monnaies Locales ComplémentairesMme et Mr Lafon100% (1)
- La Participation Aux Élections PDFDocument1 pageLa Participation Aux Élections PDFMme et Mr LafonNo ratings yet
- 2111 - Comment Expliquer L'augmentation Des Échanges InternationauxDocument5 pages2111 - Comment Expliquer L'augmentation Des Échanges InternationauxMme et Mr Lafon100% (2)
- La Participation Politique Non Conventionnelle PDFDocument1 pageLa Participation Politique Non Conventionnelle PDFMme et Mr LafonNo ratings yet
- Correctionthème 33 - Activité 1 - Le Marché Des Produits Laitiers Un Marché Imparfaitement ConcurrentielDocument10 pagesCorrectionthème 33 - Activité 1 - Le Marché Des Produits Laitiers Un Marché Imparfaitement ConcurrentielMme et Mr LafonNo ratings yet
- Correctionthème 33 - Activité 3 - L'intervention de L'etat Pour Réguler Les Marchés Imparfaitement ConcurrentielsDocument11 pagesCorrectionthème 33 - Activité 3 - L'intervention de L'etat Pour Réguler Les Marchés Imparfaitement ConcurrentielsMme et Mr LafonNo ratings yet
- 2111 - Comment Expliquer L'augmentation Des Échanges InternationauxDocument5 pages2111 - Comment Expliquer L'augmentation Des Échanges InternationauxMme et Mr Lafon100% (2)
- Correction 33 - Activité 2Document10 pagesCorrection 33 - Activité 2Mme et Mr LafonNo ratings yet
- Correction Thème 3111 - Les Limites Écologiques de La CroissanceDocument5 pagesCorrection Thème 3111 - Les Limites Écologiques de La CroissanceMme et Mr LafonNo ratings yet
- Narcissisme Et Fétichisme de La MarchandiseDocument4 pagesNarcissisme Et Fétichisme de La MarchandisebordigaNo ratings yet
- Conflits Et Pouvoirs Dans Le Capital Is MeDocument332 pagesConflits Et Pouvoirs Dans Le Capital Is MeMyriam Guetat100% (1)
- Quiz FrancofoniaDocument3 pagesQuiz FrancofoniapagapitaNo ratings yet
- Sco Dempre CEF 1082 NjI0ODA4Document2 pagesSco Dempre CEF 1082 NjI0ODA4anis walid ramdan belaggounNo ratings yet
- Gratuite de Visa 2015 Long Sejour MarocDocument1 pageGratuite de Visa 2015 Long Sejour MarocEl Mehdi EchebbaNo ratings yet
- Miele Cva620Document29 pagesMiele Cva620alfa_75No ratings yet
- Sahel 27 08 19Document20 pagesSahel 27 08 19issiakam6071No ratings yet
- Note MintpDocument2 pagesNote MintpPaul Zephyrin AwonaNo ratings yet
- Les Évolutions Du Lien Social, Un État Des LieuxDocument17 pagesLes Évolutions Du Lien Social, Un État Des Lieuxkhouadi abdelwahidNo ratings yet
- Écriture Inclusive - Leszexperts - QuestionsDocument2 pagesÉcriture Inclusive - Leszexperts - QuestionsRobMarvinNo ratings yet
- Régularisations Fiscales - L'étau Se Resserre Sur Les Banques Et Les Contribuables - L'EchoDocument8 pagesRégularisations Fiscales - L'étau Se Resserre Sur Les Banques Et Les Contribuables - L'EchoddNo ratings yet
- Chapitre 1Document13 pagesChapitre 1simo abNo ratings yet
- Dossier - de Carvalho - Sarah.étudiante ErasmusDocument14 pagesDossier - de Carvalho - Sarah.étudiante Erasmussarah sarahdcvlNo ratings yet
- Georges Sylvain - Confidences Et Mélancolies - Poésies, 1885-1898. Précédées D'une Notice Sur La Poésie Haïtienne (1901)Document148 pagesGeorges Sylvain - Confidences Et Mélancolies - Poésies, 1885-1898. Précédées D'une Notice Sur La Poésie Haïtienne (1901)chyoung100% (4)
- Modele Ago Sarl Associe UniqueDocument3 pagesModele Ago Sarl Associe UniqueAbdou El HaddadNo ratings yet
- Fleur Langues 1Document11 pagesFleur Langues 1silviacorolencoNo ratings yet
- Niveau: Du Lundi 13 Novembre 2023 Au Mardi 06 Fevrier 2024Document3 pagesNiveau: Du Lundi 13 Novembre 2023 Au Mardi 06 Fevrier 2024Chris Junior AdaloNo ratings yet
- Examen Droit 2018 2019 PDFDocument4 pagesExamen Droit 2018 2019 PDFAngie O'BrienNo ratings yet
- Wmo 1100 FRDocument92 pagesWmo 1100 FRmilou88No ratings yet
- Sectes Et DéviancesDocument40 pagesSectes Et DéviancesPaco Alpi100% (2)
- Fanjakana MasikoroDocument4 pagesFanjakana MasikoroJulio BaptisteNo ratings yet
- Halwar Groupe Scolaire AnnéeDocument91 pagesHalwar Groupe Scolaire AnnéeAbdoul aziz dabakh War0% (1)
- Polycopie 1ere H 1 1 3 La Revolution Napoleon Bonaparte Et LeuropeDocument10 pagesPolycopie 1ere H 1 1 3 La Revolution Napoleon Bonaparte Et Leuropethe queenNo ratings yet