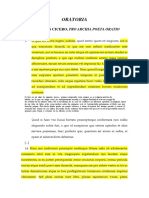Professional Documents
Culture Documents
(Pierre Chantraine) Grammaire Homérique. Syntaxe PDF
(Pierre Chantraine) Grammaire Homérique. Syntaxe PDF
Uploaded by
Anabel Poquet0 ratings0% found this document useful (0 votes)
97 views383 pagesOriginal Title
[Pierre_Chantraine]_Grammaire_Homérique._Syntaxe(BookZZ.org).pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
Download as pdf
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
97 views383 pages(Pierre Chantraine) Grammaire Homérique. Syntaxe PDF
(Pierre Chantraine) Grammaire Homérique. Syntaxe PDF
Uploaded by
Anabel PoquetCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
Download as pdf
You are on page 1of 383
COLLECTION DE PHILOLOGIE CLASSIQUE
Iv
GRAMMAIRE HOMERIQUE
TOME If
SYNTAXE
PAR
Pierre CHANTRAINE
PHOFESSEUR A L'UNIVERSITE DE PARIS
DIRECTEUR D'ETUDES A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES
Ouvrage publié avec /e concours
du Centre national de la Recherche scientifique
PARIS
LIBRAIRIE C. KLINCKSIECK
11, RUE DE LILLE, 11
1953
Tous droits de reproduction, traduction et adaptation réservés.
Copyright by Librairie C, Klincksieck, 1953,
AVANT-PROPOS
Ce volume de Syntaxe Homérique compléte la Grammaire
Homérique dont le premier tome, Phonétique et Morphologie, a
été publié en 1942 et réimprimé avec quelques corrections en
1948 (il y est plusieurs fois renvoyé par Ja référence : cf. I, p.).
Les problémes de syntaxe homérique se présentent dans des
conditions tout autres que celles ou l’on doit étudier la phoné-
tique ou la morphologie. I] ne s’agit plus de discuter des formes,
mais d’analyser des emplois ou des structures de phrases. On a,
en effet, entendu, dans ce livre, le terme « syntaxe » au sens tra-
ditionnel, c’est-a-dire que l’on y a envisagé a la fois l'emploi des
formes et la structure de la phrase. On s’est efforcé de montrer
certains traits archalques de l’'usage homérique : indépendance
des termes, construction appositionnelle, emplois anciens des
cas, des modes et des temps, usage libre des prépositions et des
préverbes, construction paratactique de la phrase complexe.
L’Iliade et ’Odyssée sont, d’autre part, des ceuvres littéraires qui
se sont développées par les procédés d’un style oral, au moyen de
Ja technique des formules épiques. I] en résulte que telle formule,
- employée en un passage donné, peut étre transférée ailleurs od
elle convient ‘moins bien. En outre, le texte, on le sait, a da
étre modernisé. I] convient donc de rester trés prudent dans
Panalyse des exemples : pour ]’emploi des particules 4, xe ou te,
du subjonctif ou de l’optatif, du duel, les données sur lesquelles
nous raisonnons peuvent n’étre pas toujours authentiques.
Pour ne pas grossir le volume 4 l’excés, on s’est décidé, A regret,
A ne pas traduire tous les exemples. Homére a été traduit dans
toutes les langues, et les lecteurs frangais disposent de deux
vu AVANT-PROPOS
excellentes traductions de V. Bérard et de M. P. Mazon. Lorsque
Pinterprétation est controversée, le sens est toujours donné. Le
sens de plus d’un passage se trouve discuté au cours de l’ouvrage.
Des notes bréves donnent, notamment en téte des chapitres,
les indications bibliographiques essentielles. On s’est systémati-
quement référé au second tome de Ja grammaire de Schwyzer
(cité Schwyzer-Debrunner). Ce livre doit également beaucoup aux
Vorlesungen iiber Syntax de J. Wackernagel, ala Syntaxe Grecque
de M. J. Humbert, aux Homerische Worter de M. Leumann, &
V Homeric Grammar de D. B. Monro (pour laquelle on renvoie a la
seconde édition), 4 Védition de Jliade de W. Leaf.
Deux anciens éléves, qui sont aussi des amis, m’ont aidé a
rendre cet ouvrage moins imparfait. M. H. Goube a accepté d’en
lire une épreuve de mise en pages et M. G. Redard a tenu a se
charger d’établir un index qui, je crois, rendra grand service au
lecteur.
P. CHANTRAINE,
CHAPITRE PREMIER
LA STRUCTURE DE LA PROPOSITION
§ 1. En indo-européen, la proposition pouvait présenter une double
structure : verbale, lorsqu’elle comporte une forme personnelle du
verbe ; nominale, lorsqu’elle n’en comporte pas. La phrase nomi-
nale est constituée d’un substantif (ow d’un infinitif) qui en est le
sujet et d’un autre substantif (ou d’un adjectif, ou d’un adverbe)
qui en est le prédicat.
Le réle respectif de la phrase verbale et de la phrase nominale
dans le systéme de la langue vient d’atre mis en lumiére par M. Ben-
veniste*. Soit A 281 : aka’ 8 ye géprepdg tone, Emet niedveony dvdscer
«il est Je plus fort, puisqu’il commande a plus d’hommes » ; les deux
propositions, qui comportent l'une et Vautre un verbe, énoncent
une assertion déterminée, dont la conformité avec la réalité est cons-
tatée. Cette constatation peut concerner soit un verbe exprimant
un procés quelconque, comme dvéacet, soit un verbe exprimant la
notion d’étre (éerfv). — Soit maintenant A 216-217 ; yph piv cpulrepdy
ye, Oed, Enog elpbcoacbar, | xal wdha mep Supa xeyohupevov’ do yap Xpstvoy :
on ne trouve dans ces deux vers aucun élément verbal ; ypj est nomi-
nal, comme le &< dpewov, On observe que ces propositions nominales
expriment une vérité générale et un conseil. Si l’on pousse plus loia
Panalyse, on constate qu’il ne s’agit pas d’une « prédication d’étre »,
comme dans les phrases verbales, mais de la position d’un rapport
qui établit dans Pabsolu une équivalence entre deux termes. II con-
cerne l’essence plutét que l’existence.
Si tel est bien le réle propre de la phrase nominale, il en résulte
(et e’est ce que l’on observe) qu’elle ne se trouve pas, en principe, dans
Ja description ou un récit, mais dans le discours of le sujet parlant
pose des rapparts qui ne sont ni situés dans le temps ni modalisés.
Loraque lon examine les textes grecs les plus anciens, on constate
4. Schwyzer-Debrunner, p. 628, avec la bibliogsaphie, notamment Meillet, M.
L.A&, p. 1-24; Bruginana, Syniaz des ejnfachss Satzes, p. 58-78; Benigny, 1. F.
B. Pp. 126-144; J. Kinzel, Die Kopula bei Homer und Hesiod, Programm Mahrisch-
Ostrau, 1968-1909 ; en oufre, L. Hjelmslev, Mélanges Marouzeau, p. 253-281.
2 B.S. Le, 46 (1950), p. 19-86.
2 CHAPITRE PREMIER
qu'elle apparait surtout chez Hésiode ou Pindare qui énoncent des
préceptes, mais non chez un historien qui décrit ou qui raconte
comme Hérodote, qui ne l’emploie guére que dans des discours.
§ 2. L’examen du texte homérique confirme ce trait structural
essentiel. Si l’on envisage, par exemple, les chants A et I de I’Jliade,
on constate que la phrase nominale ne figure jamais ailleurs que dans
les discours ou propos tenus par les personnages! et qu'elle présente
le plus souvent avec netteté les caractéres que nous avons définis :
A 80 xpzicowy yap Bactheds éte yesoetar... «un roi a toujours |’avan-
tage... »; — A 116 ei 2d y' dpervov; — A 167 oi +4 yéaag mOAd pettov;
—A 156 émet } pada modda peratd | odpedt te oxidevta Odhacad te hy ecea ;
— ATA nag’ tol ye vai Eddor...; — A177 alei ydp cor Epte te gin d=
Aepol re payee te; — A 246-218 (voir plus haut); — A 274 énsi w:(eo-
Oat Zwevov ; — A 404 6 yao ace... ob nacpac duelvav ; —A 416 Ene! cor alex
pivoved mep ob tt pad Sty; — A515 emei od vor Em Béoc; — A518 4 Bh
Rolytx Epy’ bte...3 — A525 colo yap & eudder ye wer” dlavdrorst péyto-
soy | téxuwo: od yag phy nadwvdygetov... | ou. 3 tte
On reléve la fréquence des maximes générales, l’usage des tours du
type zp7;, aica, ete... Mais, dans la parole, ou, si l’on veut, dans le détail
du style, le poéte peut choisir le tour nominal, alors que la phrase
verbale serait possible, pour conférer 4 l’énoncé une valeur essen-
tielle; ainsi : A 156 imei 4 ude coAha werakd | odped te oxideven Od acon
(ainsi se trouve mise en accent la distance qui sépare des Troyéns
Je pays d’Achille) ; — de méme : A 167 coi <6 yépag cohb peitov; —
A 404 6 yap abte... ch matpig duetvwy.
Le chant I présente des données toutes comparables :'1 75 psiha BE
pedo ndveas "Ayauols | dobhiig xai muxwie; —1 100 vi oe yph nepi pav gdo-
Oat; — I 158-159 "AlSng ror dueOryog 78? aBdlpxetos | toSvexa xal te Bpo-
rotst Oeiy EyOtetas amdvewy ; —1 197 tt wha yped; —I 227 neipa yp
pevosexda rohAd ; — I 230 tv Sor% BE caweduey % dmodéatar; — 1 256 g-
opposivy yap ductvov ; — I 312 eyApae yap pot xetvos Spade "AlBao mbAyet 5
— 1318-319 fon wotpa pévover xat ei dda tic moRepibor’ | ev 8 tq th due
xaxdo 48 xa tedhdg ; —1 378 tyOed 34 po: tod Bispa; —I 401 08 yap epct
poze avedEvov, ob8’ Bow... ; — 1406 Ayretot pev ycip te Bées xal Ipia pada, |
xerytol 88 tpizoBec x. 7.2.3 — 1 496 olBé wi ce yor | vndeds Trop tyes otpen-
rot Bf re xai Geol abot, | tov mep xxi wellwy deer} teu te fly te; — 1 521
of te cot aura | of
dédaban ; — 1.608 of cf pe ravens | ypeds typi; — 1 615 xaddv rot ody dunt
arot Apyelov ; — I 523 melv 3° ob tt vepecentby xeyo-
4, Il est vrai que, lorsque Homére décrit ou raconte, il ne Ie fait jamais gu’a un
temps du passé et que l’on admet que la phrase nominale n'est possible que lorsqpe
le verbe d’existence serait employé au présent. Mais la raison de l'absence de tels
exemples est liée 4 la nature propre de la phrase nominale.
LA STRUCTURE DE LA PROPOSITION: 3
by wider 6g x’ aud x48; — 1 626-627 dnayyetha: Bi tdytora | yph w3dov -
Aavactar. .
Les nombreux exemples du chant I confirment ce que nous avons
observé dans le chant A : la phrase nominale confére 4 l’énoncé une
valeur essentielle; on pourrait dire aussi qu’elle comporte un juge-
ment de valeur. Comme dans Je chant A, la phrase nominale peut
étre employée 1a ot I’on pourrait attendre un verbe d’existence :
171 whetat tor ofvav xdtsfat ; la proposition se trouve ainsi placée dans
un registre différent.
La phrase nominale se trouvant posée hors du temps, si l'on vou-
lait, introduire un verbe, ce verbe devrait étre le verbe efvat. a la troi-
siéme personne du singulier ou du pluriel de lindicatif présent.
Remarque. — Certains tours exclamatifs ou impératifs peuvent sombler
proches de la phrase nominale. Is s’en distinguent parce quwil n’y a
pas proprement proposition : E 787 Aldi, "Apyeto: « honte, Argiens »
(= © 228); cf. aussi § 45. — Avec un adverbe : I 247 day’ diva, et
pépovas ye « debout... » (cf, Z 331, etc...); — un tour comme I 376
GAug 8¢ of « en voila assez » peut bien étre interprété comme une
phrase nominale. — Sur les infinitifs exprimant un ordre, voir
§ 460.
§ 3. Certains substantifs jouent un réle particulitrement impor-
tant dans la phrase nominale, Ils expriment les notions de besoin,
de nécessité, d’espoir, etc...:B 24 ob xpd... edderv (cf. A 216 ete...) ; —
A 606 si 8é ce ypew Epzio (of. I 75, I 197, ete...); — E 633 tig roe
dvdyxn nrbsaery (cf. Y 251) ; — 4 373 od8é nw By eSbery ; — 1 707 ob vs
tot alon...; — H.52 03 ydp m5 tor wotpa Gaveiv; — B 280 edmwpy tor
greta tehevtHoat; — F156 ob vipests Todas... dyea ndoyew ; — P 336
aldidg pav viv Be... eloava6ivar ; — ¥ 203 ¥% por By0¢ peyadhropos Alvelio ;
— wo 286 4 yap buts (seul exemple, cf. § 7),
Avec un adjectif neutre comme prédicat : 1.615 xadév ro. abv Epoi tov
xhBewv 36... — a 392 0d piv yap tt naxbv Bacrhendpey; — B 298 aicypsv
cot Snodv te wévetv; — A 274 énel nreibecbar dwervov; — B 204 obx dyaldv
moduxotpavin ; ete...
Un type particulier de phrases nominales est constitué au moyen
d’adverbes : X 453 éyybg 34 tt xaxdy Mordworo téxzcorv ; — surtout avec
des préverbes accentués, employés au sens fort : A 545 énet ob cor Exe
Béog « puisque tu n’as rien a craindre »; — E 603 wi 8 ate néga ele
ye Se@v « il a toujours prés de lui Yun des dieux » (cf. I 227, ete...) ;
— 1125 sqq. od Yap Kuxddmece: ves xdpa wrdtomdpnar | 008) dvipes vyiay
kt téxroves; — % 53 be’ Epoi Eve xfSea bupd « toutes les peines que j’ai
au coeur »; — p 279 népr tor pévos « ta force eat intacte »; — ¢ 93 od
yap tg pera totoc dvi...
4 CHAPITRE PREMIER
Avec un préverbe qui équivaut simplement 4 un adverbe : 3 635-636
tvba pot Umma | Sddexa Ofdetan, ord 8 hyplover taddepya; — E 740
év 8 "Epic, ev 8 "Adar, bv BE xpudecsa "Tox; — A 395 oluval 8 nepi
Thées 78 yuvaixes. Voir d’autres exemples dans l'étude des prépositions
et des préverhes.
Homére offre des exemples variés de phrases nominales avec un
substantif sujet, un substantif ou un adjectif prédicat : » 87 aith
B adre nédwp xaxdv; — A 167 aoi vd yépas cold peivov; — B 204 odx
dyabdy moAuxotgavir 5 etc...
§ 4, On peut se demander quelle place la proposition nominale
tient dans les propositions subordonnées. On a observé qu’elle semble
fréquente dans des relatives qui constituent une sorte de parenthése :
@ 524 pibos 8 d¢ wey vov dyuts, elonpedvas Eorw ; — A535, 1500 dvavyes a?
nept Sigpov ; — @ 353 iyGbec of xark divac; — Z 146 of nep qudRwv yever,,
toln 6& xal dv3pdv; — B 604 WW’ dvépes dyyipayytal. D’od des tours
comme : ése0 ’Ayatoé (I 55, ete...); — Rodv... % tts deform (P 62); —
Ect téyota (A 193, © 112); ete... On observe, notamment dans ces
derniers exemples, plutét qu’une véritable phrase nominale, une sorte
de tour abrégé, qu’il faut rapprocher de J’absence du verbe dans les
propositions comparatives (§ 8).
Propositions conditionnelles : A 116 «i <6 y’ dpervov... ; — X 52 ei 8”
FB tebvaior xat civ Aldao Sduore (suit une proposition verbale).
Temporelles : x 176 d¢p' év vat Bor Bpiats te ndarg te; — A 477 bgp"
aiwa Mapov xai yadvar’ boaen; — o 394 npiv py (dans ces exemples le
verbe attendu serait au subjonctif, of. § 6).
Causales : A 156 émet % pdha noddd perakd | ollped te oxtdevra... 3 —
T’ 106 énet ot raider dreppiador xal gmarot; etc...
Propositions complétives : E 2241 dpe’ yar | olor Tpuxoe tremor; —
1 827 eiBhoeic 88 xat abrds... daaov dprovar | vifer wai. Sur ¥ 434 et @ 108,
voir §.5. +
La phrase sans verbe étre a pu servir dans la subordonnée & fournir
un tour brachylogique qui ne présente pas toujours l’originalité propre
de la phrase nominale. C’est ce que l’on observe dans la structure
des propositions comparatives du type de tc éte, i ondre, tig et +
B 209 as dre xdpa nohvpdoicboro Oxrdcans (cf. § 372 et les exemples qui
y sont cités).
§ 5. En ragle générale, s'il fallait « sous-entendre » une forme du
verbe étre dans une phrase nominale, ce sont, commé nous |’avons dit,
les formes de troisisme personne du présent de lindicatif ioc ou
clot. Les exemples de premiére et de seconde personne sont excep-
tionnels.
LA STRUCTURE DE LA PROPOSITION 5
Premiére personne : ® 482 yahenh to Eyl pévog dveupépesbar ; — T 140
RGpa 8’ tyiby 63a ndvra mapacyépev « je suis 1A pour... »; —o 64 Eetvoddxog
uty yay ; — 0.396 sob yap ty Oepdmwy ; — 8 180 cara 8 Lyd alo modddv
dpelvov pavredeotar; — 2 372 adtdp bye nap’ Sesaw dmdcponos ; — B 60
fypetg 8° of wh v1 voto dpuvépev ; — I 225 Bards phy lors ox emeBevets ; —
T 409 od3¢ coe Hpets | atstor dAAS Oedg nad poipa xparatr}. — Dans une su-
bordonnée : & 108 ody &pdas olog nai bya nade ce peyas te.
Seconde personne : 8 206 xolov yap xa) narpog 8 xai nenvontva Biers;
— © 439 dpye- ob yap yevetigr vewtepos; — X 288 od ydp ogiot nipe
peyatoy; — A 335 ob tf por Sppes exattiot, ad’ “Ayauénvov, — Dans
une subordonhée ; Y 434 offa 3 St ob pby eobhdc, edo 88 oddev nord
yelpwv.
Dans certaines de ces propositions, il est possible que l’on n’ait
pas proprement une phrase nominale, mais, que le verbe étre ne soit
pas exprimé. Cette derniére interprétation est évidente, lorsque
la proposition sans verbe est coordonnée 4 une proposition a-verbe
étre :W 587-588 nohddv yap Lywre vewrepds ete... ob 8% mpdcepog xat doelwy 5
— 2 U8 h piv yap Boords Eort, od 8° dOdvatoc nal dyhews ; —B 201 ...
ot ago géptepol elor, ob 8 dardhepog xai &vadnic; — 0 533-534 bperdoon 8°
obx dort yévens Bacchebcepov EdRo | ... AAD’ Dpets xapreped ael,
Remarque. — On observe que la phrase nominale est proche parfois
de Vexclamation : © 493 abtép éyd navdnoritoc émel téxov... répond a
2. 255 "O wor bye navémorwos énel téxov...
§ 6. La phrase nominale ne permet de donner aucune indication
temporelle ou modale. I] existe quelques cas particuliers, que le con-
text> permet aisément d’interpréter. — Imparfait : « 477 sqq. So0bg 8
Ap Snr Avbe Odpvous | ... & piv quding, 68 Eratns; — T 43 sqq. of te xub_-
vitae xal Eyov olvta vadv | xol tawior maps vavatv Eeav « Geux qui étaient,
pilotes et tenaient la barre des nefs, ceux qui étaient intendants...,
etc... ». — Subjonctif, en particulier dans les propositions relatives :
E 376 85 34 x’ dvinp pevézappoc, Eyy 8 driyov adxos Gp, | yelpove putt
Sétw (vers athétisés); — A 547 dv pév x’ Enteric dxovénev ; — E 481
sav ESeran dg x’ EmBevrs ; — avec dppa: A 477 Sop" alya Aaoty xal yos-
var’ bone 3 cf. encore x 176, o 394 et voir § 4.
§ 7. On a établi des statistiques pour fixer la proportion des phrases
nominales et de celles ot le verbe étre se trouve exprimé. Meillet a
observé que, dans le chant E, on compte vingt-quatre exemples de
phrase nominale contre quatorze oi le verbe éeti ou clei est exprimé.
En réalité, les deux tours sont également anciens, mais ils ne se
trouvent pas sur le méme plan, le verbe oti exprimant la notion
d’existence; cf. A 281 cité § 1. Ce tour est employé avec un par-
6 CHAPITRE PREMIER
ticipe prédicat : A 388 pifoy 8 8} tereRecudvos torit; — % 196 xai el
reveheautvoy tociy. — En A £69, le rapprochement de viv, la considé-
ration des circonstances entrainent l'emploi de tat! : viv 8" ciyr bOinvd’
amet wodb g€otepdy fort; — de méme / A 144 émel ob iey dove yepelwy ;
— 1706 rd yao pévoc éoti xai ddx¥ (cf. encore T 45, 164, 242, E 304,
etc...). On observe que le verbe ciui s’emploie volontiers avec la par-
ticule te, de sens contingent (cf. § 498) : I 502 xal yap re Acral elot
Aag xcipa: « c’est qu’il y a aussi les filles de Zeus... »; — A 63 xai
ip t’ bvap éx Ards gotty; — 1 39 & te pitas éoti wéyrotov. On remarque
aussi qu’avec 0x5 le verbe d’existence est toujours exprimé : I 276 4
Odurg éotiv (cf. B 73, ete... ; seule exception w 286). .
D’une maniére générale, le sens fort de ciué est bien attesté : Z 152
Bort nots "Epp ¢ il y a une ville... »; — Z 267 of8€ ny Sou... edyerda-
far; — w 263 ef mou Liber ge xal Eat ; ete...
Avec d’autres formes du verbe étre : « 79 war’ efng... waite yévoro 5
etc... Notamment lorsque le prédicat est adverbial : Z 134 0328...
Auxdopyos | Shy Fy... ; — B 82 20" Hdor wey mdvres dxty Foav..,
Le verbe elva: a, toutefois, été concurrencé par d’autres verbes
qui exprimaient originellement des nuances variées et se sont subs-
titués 4 lui. Le plus notable chez Homére est néhw et surtout xédopat
qui peut s’employer au sens fort avec un adverbe : cf. I 324 xaxig
Bé té of néAet ade. On a également : A 284 5 wéya mda { Epxog "Ayarot-
atv méAetat, etc... A la méme racine appartient un doublet redgbw
plus rare qui marque l’aboutissement de Paction (cf. H 282, 293, et
voir I, p. 327) et qui s’emploie dans des propositions de valeur géné-
rale : I 444 tva x’ dvBpes dornpendes teAeGoucry « ot les hommes se font
Temarquer ». — Un autre équivalent propre a la langue épique est
le parfait moyen de teiyw, tétuxtar : A 84 taping... tétuxrar « (Zeus qui)
est larbitre... ». —- Kipw, qui, plus tard, équivaut parfois & la co-
pule, ne s’emploie chez Homére qu’au sexs d’ « atteindre » avec un
complément. — De méme, 2suv n'est pas employé comme équivalent
du verbe étre chez Homére,
Parmi les verbes que la prose attique a utilisés en cette fonc-
tion, Homére emploie souvent y(yvecda : A 57 inet ody Hyepbey Spnye-
pées te yévovro. Mais yijvec0a: exprime l’aboutissement du proces.
§ 8. Il n’existe pas, A proprement parler, chez Homére d’ellipse du
verbe dana la phrase verbale. Toutefois, il peut n’étre pas répété lors-
qu’il peut étre aisément suppléé : ) 413 sqq. ... xteivevto, bese dpyidbov-
neg, | of Bat” bv dgvetad dvBpbs ya Buvapévoro | yep H tpdiw % ethamivy
4, Ce tour périphrastique s’observe, bien entendu, hors de Ja troisitme personne
du singulier de 'indicatif. Gf. E 873, 4 5%, B 641, « £58, ete...
LA STRUCTURE DE LA PROPOSITION 7
teOahuty : il faut suppléer xteivevrat dans la proposition subordonnée.
L’omission du verbe est particulitrement fréquente dana les com-
paraisons : M 299 sqq. Bi 6’ tpev de te Aéwv bpsaltpopos, &¢ tv” emBevie |
Supv Eq xperdv il part, comme (part) un lion... ». Les exemples sorit
innombrables. — Nombreux exemples de i; te : B 209 4%, tig ote
xopa... Bpéuetar « avec un fracas comme (cela se produit) lorsque... ».
Enfin, il arrive que ni o¢ ni Sxe ne soient suivis d’un verbe : A 462
Fipene we Gre nbpyos « il s'’écroule comme (cela arrive) lorsque (tombe)
un mur »; voir § 372. De méme : E 374 tig wi oe cord’ Epebe... the et
tt xaxby Cousay « qui t’a ainsi traitée ... comme (cela arriverait) si l’on
te traitait ainsi pour avoir commis un méfait ».
En 6 292 déxtpovée doit signifier « au lit », phrase sans verbe, et étre
suivi d’une ponctuation (cf. I, p. 400).
§ 9. La proposition comporte, en principe, un sujet'. On sait, tou-
tefois, que la of Je frangais doit nécessairement employer un pro-
nom personnel sujet, le grec ne l’exprime pas, sauf si l’on désire
désigner ce sujet avec une vigueur ou une intention particuliére.
Toutefois, Pomission du sujet s’observe méme 1a ot le frangais
wemploierait pas un simple pronom personnel. Ainsi, lorsque le sens
du verbe est si précis que le sujet n'a pas besoin d’étre exprimé :
y 142 dev té mep olvoyeder (6 sivoydos). Lorsque l’on donne un ordre a la
troisigme personne de l’impératif, le sujet n’a pas besoin d’étre ex-
primé : 8 214 yepai & ty’ Sbwe | yevavray; — + 599 dekeo... H yopddie
stopéoas, 3% to xatd Bipvia Odvrwy ; etc...
De méme, lorsque Je sujet a l’accusatif d’une proposition infinitive
peut aisément se tirer du contexte, il n’a pas besoin d’étre exprimé :
@ 168 ef nép wis 2myOoviwy dvozamwv | pio EAetaesfar « méme si quel-
qu'un parmi les hommes dit qu’il (Ulysse) reviendra » (cf. » 316).
Remarque. — C'est cette syntaxe que présenteraient les verbes dits
impersonnels, qui décrivent des phénoménes naturels, et ot le sujet
non exprimé serait Zeus. Mais Homére a Phabitude d’exprimer le
sujet de ces verbes : M 25 = & 457 be 8 dpa Zeic; — I 237, dans
un passage od T’intervention du dieu doit étre soulignée : Zed...
aotpérter. De méme, Bpdvrqce posséde un sujet : Y 56, » 415, £ 305,
etc... Toutefois, il y a peut-étre 1a rationalisation de expression
impersonnelle primitive.
§ 10. Lorsqu’il s’agit d’un sujet indéfini « les gens », etc..., Homére,
comme l’attique, n’exprime pas ce sujet, en particulier avec un verbe
4. Schwyzer-Debrunner, p. 620, avec la bibliographie citée, notamment Bd.
Herrmann, Die subjektlosen Sdtze bei Homer, Gott. Nachr., 1926, p. 265-297 ; Bran-|
denstein, J. F. 46, p. 1-26; W. Havers, Worter und Sachen 1, p. 1-26.
8 CHAPITRE PREMIER
« dire » a la troisitme personne du pluriel. Ainsi paci, I 14, ¢ 42,
ete... : of. 11 14 Chew pav Ext gaat Mevolnov. De méme : E 306 xorbhyy
dé 4 pty xaddeuer ; — LZ 125 yvotev « on comprendrait ».
“Tl arrive également que la troisieme personne du singulier soit
indéfinie sans que le pronom ttc soit exprimé : N 287 ot8é xev Evia tedv
ye pevos xai yetpag dvorra « ... On ne critiquerait pas... »; —X 199 we
8 by dvelpa ob Buvarar gedyovta Stadxey « comme dans un réve on ne
peut... »; — e 400 Seeov te yéywve orcas « jusqu’od la voix porte
quand on crie ».
De méme dans une subordonnée a l’infinitif : « 440-411 038° Snéserve |
yvduevat... «et il n'a pas attendu qu'on le eonnaisse... ». I] manque
et le sujet indéfini de yespeva: et le complément d’objet.
Le sujet non exprimé peut étre un neutre : + 143 oud: npodgatver’
'ésbac « il ne faisait pas clair pour y voir »; — avec un prédicat au
neutre pluriel : [1 128 odxért guxté néhwvrat « qu'il ne soit plus possible
de fuir »; — 8 203 od8é aot’ tox | Eooeton.
Passage du pluriel au singulier indéfini : 8 691 sqq. § +’ Eati Sixy,
Osiwy Bacthyiwy | EdAov x’ ExBaipyar Bpotév, Edoy xe groin.
La seconde personne est employée, au sens indéfini, au sens poten-
tiel ou irréel, dans des tours souvent formulaires : A 223 t6" odx av
Boltovta Ybor "Ayapépvova Blov; — A 429 obBé xe wainc | cdasov Lady Emes-
éat (cf. O 697, P 366, mais F 220-dans un dialogue); — E 85 otx av
yvolng ; etc...
§ 14. Un élément essentiel de la phrase nominale ou de Ja phrase
a verbe étre est le terme que les grammairiens frangais appellent
attribut, mais que, pour suivre l’usage général, i] vaut mieux nom-
mer prédicat et qui exprime ce qui est affirmé du sujet de la propo-
sition : E 695 && of ofhos ev étatpeg, La phrase homérique est earacté-
risée par 'autonomie des termes qui la compose et que nous mon-
trera pleinement la syntaxe de l’accord (cf. §§ 15 sqq.,.ete...). I]
en résulte que l'emploi du prédicat nominal y est trés souple.
Un prédicat au nominatif peut étre malaisé a distinguer du sujet.
Ainsi, lorsque ’on donne le nom d’un personnage. Dans une proposi-
tion comme 1 54 “Aphry 8° Gyoy’ Early exdvopov, les mots "Aptzy et
Svopa sont tous deux au nominatif (cf. o 256, ¢ 5, + 247, + 409) et
"Apirn semble étre le sujet; — en t 183 duct 3 Syoua xdurdv Atdov |
aomhétepog yevey, le mouvement semble faire de Svoua le sujet: et,
dautre part, oriétepos yever s’emploie par attraction au nominatif.
Avec toutes sortea de verbes (et pas seulement avec le verbe étre),
le verbe peut étre accompagné d’un adjectif qui joue le réle de pré-
dicat apposé : H 158 woddag ydo tic Exerto maphopos Zvla xat EvOa « i] gi-
sait énorme, les membres étendus de part et d’autre » ; — B 148 \a6p0¢
LA STRUCTURE DE LA PROPOSITION 9
tnaryltov « agitant avec violence »; — A 543 ob8%... nedgpwv téranxag
« tu n’as pas voulu avec bienveillance »; — B 242 duecpoemhs exon
«il jacassait sans mesure ».
Pour exprimer une circonstance ou une attitude : — 344 tondprot...
dginovte; — B 2 ei8oy navy; — A 424 yoke ten; — 0 3d
radvepaos dxéory « il s’éearte en se redressant »; — A 108 onto
Yunese néton « il est tombé a la renverse sur la pierre »; — E 204
melds ig “Dov etdhouda ; — 9 146 he puyotrarog; — YW 274 ork 8 00d. ;
— Q 11 dots dvasrag ; ete... .
L’adjectif, comme on l’observe parfois en attique, peut exprimer
un résultat : A 266 xdptisvor 3% xetvor Emtybovioy cpdgev dv8pav « ils
ont grandi pour devenir les plus forts... ». L’adjectif prédicat peut
étre en accord avec le régime et marquer ainsi le résultat ou les
circonstances de l’action : 0 38 Ooi» ddeysvete Satta « préparez promp-
tement un festin »; — B 257 dusev 8’ dyoohy alfyoyy « brusquement il
leva la séance »; — 3 6 fepud hoespd... Beprivy; — A 39 yaolevs’ ext
vapy Epetpa; etc...
Lorsque le verbe n’a pas de sujet exprimé, le prédicat s’emploie
au neutre : E 674, etc... udgoov Fev; — T° 410, ete... vepeconrdy d¢
xev Fev; — 170, etc... oStor derxég,
Le pluriel neutre est parfois employé : — 489 odxét ouxtd méAovtat
« plus moyen de s’échapper » (cf. 6 299, II 128, et voir § 25). Le prédicat
peut étre constitué par un substantif qui posséde parfois une grande
valeur expressive : P 556 aot piv 5h, Mevéhas, xarygety, xai Sverdoq Eoae-
zat el...; — 1.316 (= P 147) ox dpa tic yépte Fev | udovastar... — Dans
des phrases nominales sans verbe éire exprimé : T 156, etc. .. ob vépeats;
— Il 707, ete... ob wi rot aoa. — Avec un pronom sujet : H 97 4 piv
BH OSH tebe y' Eoseru...
Les pronoms 68. et éxeivog sont volontiers employés pour indi-
quer le lieu : E 604 xai viv ot mépa xetves “Apys « pras de lui, Ards est
la-bas »; — K 484 Opyixes of8' éntveube « les Thraces sont ici a l'écart ».
— De méme dans des phrases verbales : K 82 tlc 3’ ottos... Eoyeat
« qui va la-bas? »; — ¢ 276 tle 8 &e Navaixks exerar « qui suit Nau-
sicaa par ici? ».
Le prédicat peut, enfin, étre exprimé par un adverbe : A 762 i¢
Yow, el noc’ Lov ye; — 1 554 Koughcesar xaxire Hy; — H 424 Biayvivar.
zodenids Av; — A 838 aide + Ap Lor tdde Zoya ; — 2 336 mide Spytv avig
Se patveta: etvar ; — Z 131 of8s... Shy Av «et il n’a pas véeu longtemps »;
— B 82 80" dda piv navteg dxyy Eoav (cf. + 393)1. Dans ces exemples,
le verbe av éywo
einw, reddyela nivesg; — EB 273 ci 8’ av duots endeo, middyeta; —
O 553 sqq. ofrw 5% Meddvinne, pethisopev; o35¢ wo ool nep | évepénerat,..
roe. — Noter aussi p 375 é ot Bac Extapev Hyets, bien qu’ Ulysse ne se
soit pas trouvé avec ses compagnons lorsqu’ils ont tué les vaches du
Soleil.
Remarque. — “Aye et &yete étant devenus des adverbes, on observe
avec ces formes soit le passage du singulier au -pluriel : T 441 &ye
Bip... tpameloyer ; 7 392 Aye thuvere ; B 437 dH dye, whpunes, ... Rarbv...
dyerpévewy ; — soit inverse o 418 dyer’ olvoydog uty EmapEdateo ; 4199
an dye0? buiv tedyen evelxor.
t. Bolling (Class. Philol. 26 [1931], p. 313), a voulu voir un pluriel de courtoisie
en E 249 yatwpel’ ég’ tenwy « retirons-nous vers notre char », c'est-a-dire « retire-toi
vers notre char ». Mais il est plus probable qu'il faut entendre « retirons-nous sur
notre char », cf. 42 356.
CHAPITRE IV
GENERALITES SUR LES CAS
NOMINATIF ET VOCATIF
§ 44. Le systéme! des huit cas indo-européens est déja réduit a
cing dés les plus anciens textes grecs. Le procés de syncrétisme par
lequel s’est opérée cette réduction est antérieur A Homeére. Il est ten-
tant de chercher dans l’étude du génitif ce qui continue le génitif
indo-européen et ce qui vient de I’ablatif, dans celle du datif ce qui
appartient au datif, au locatif et & instrumental. Nous nous effor-
cerons de mener a bien cette analyse qui est instructive, mais elle ne
répond & rien dans la conscience linguistique des Grecs du temps
d’Homére. Dés cette époque, il n’existait qu’un génitif, qu'un datif.
L’emploi des cas était trés libre. Le nom, apposé au verbe; se met-
tait au cas exigé par le sens, sans étre uni a lui par un lien étroit.
Avec un verbe comme x)vety, le génitif, le datif et ’accusatif peuvent.
étre employés (cf. §§ 65 et 88). I] se produit souvent une concurrence
entre les cas qui, pour certaines notions, se trouvent proches l’un de
Vautre. Il y aura lieu de définir les nuances de sens qui séparent les
cas lorsqu’ils semblent s’équivaloir. Déja chez Homere, le sentiment
commence & se développer que tel cas dépend du verbe; autrement
dit la rection s’introduit dans la syntaxe. Ce développement a été haté
par l'emploi des prépositions. Elles ne sont pas indispensables et Pon
trouve chez Homére des compléments de lieu comme {xsvro beiiv
80; (E 367). Mais les prépositions, particules originellement auto-
nomes, ont tendu & se lier soit au verbe (préverbes), soit au nom (pré-
positions proprement dites). Cette évolution, d’une grande impor-
tance, est en cours 4 l’époque ot ont été composées | Iliade et l’Odys-
sée, et il y aura lieu de l’examiner de prés. Plus d’un passage permet
@observer le développement des prépositions : que l’on compere, par
exemple > 195 gpeo! névOog défer et 4 218 évt presi névios Eyovea.
1, Schwyzer-Debrunner, p. 52 et la biblidgraphie citée. Ajouter Th. Simenschy,
La construction du verbe dans les langues indo-européennes (Bulletin de VInstitut de
Philotogie roumaine, XIII), Jassy, 1949.
36 CHAPITRE Iv
§ 45. Le nominatif’ exprime ce dont i] est question dans la phrase,
Il sert donc a désigner le sujet, qui peut d’ailleurs n’étre pas exprimé,
lorsque l’interlocuteur I’a présent a l’esprit (sur les verbes employés
sans sujet, voir § 9).
C’est sous la forme du nominatif que, hors de la phrase, Je sujet se
présente a l’esprit. Chez Homére, on le trouve parfois employé quasi
absolument : cf. §§ 19 et 20; sur Z 395-396, voir § 347. I] joue volon-
tiers le réle d’une exclamation : E 403 Syéshinc, d6ptucepyde oo 03x
SGer’ aieuda déEwv (cf., pour cet emploi de szétdtoc, S 13, X 86, ete...) ;
— de méme en v 194, Siepopos; — A 234 2nynbseas Buorheds, amet ob-
mSavotary dvdaserg | — vijrtos est souvent employé de cette facon : B38
vimtog obBE ta TBn, & Zed wibero Eoya (cf. E 406); — exemple typique
en P 234 sqq, : wade B¢ agiaw Exmero Gupds, | vexpav On’ Aiavtog Epbew Te-
Aapwvddao, | vintoc’ H te xoddaay én’ abr Opty dxysea...
Le nominatif sert donc a interpeller et se trouve ainsi proche du
-vocatif. Dans certains types de déclinaisen, et en particulier dans
les démonstratifs comme odes, c’est, on le sait, la forme de nominatif
qui sert de vocatif. En + 406 yap6pis twos Bvyarne ve... ladjectif
possessif?, ne possédant pas de forme propre de vocatif, a entrainé
yaub6pdg (le vocatif avec cette structure du vers était d’ailleurs impos-
sible) et @vyizyp (Je vocatif @dyates est également attesté).
Dans la plupart des exemples* que l’on cite, Je nominatif offre une
forme métriquement commode : @ 301 xat ad, gidoc, pdda yao... 3 —
p 4415 Bd, gfhocg> od wey... (la forme gfAe causerait un hiatus, d’ail-
leurs telérable A cette place); cf. y 375; — de méme A cété d’un
substantif au vocatif : A189 itor @ Mevéhac,
Remarques. — I. {1 semble que le grec archaique ait hérité de I’indo-
européen Pusage qui consiste, dans une invocation a deux per-
sonnes unies par la particule *tve (skr. ca, grec te), A employer le
vocatif pour la premiére et le nominatif pour la seconde : T' 276 Zed
rnérep... "Hérds 0...
II. I est possible que, dans des passages ot la tradition manus-
crite donne le vocatif, la bonne legon soit le nominatif. Ainsi on a
proposé de lire : B 8 Bdsx’ 6’ obdoc Svetpe (mss. obae); — E385
Thrte Oétic tavorende est donné par quelques manuscrits ; ~ 6 408
yaipe, wavhp & Eetve (tnss, wétep}.
§ 46. llarrive souvent que le vocatif soit rattaché 4 Ja phrase qui
suit par une particule.
4, Schwyzer-Debrunner, p. 64; Havers, 7. F. 43, p. 207-257, Glotta 16, p. 94-127.
2. Cf. Wackernagel, Mélanges de Saussure, p. 154,
3. Dans les exemples comme I 94 of Siow. tawimpusy (ef. T 83) avec larticle,
il s’agit proprement d'une apposition.
GENERALITES SUR LES CAS NOMINATIF ET VOCATIF 37
a) Pour introduire une opposition apparente ou réelle : A 282
*Arpetdy, cb 88 mabe tedv pévoc...; — @ 448 doibe, ob 5° eldimodac Edtnag
Bots Bouncdéeoxes; — Z 429 “Europ, dtdp ob pot door narhe xai xdrve
wrizne | 4BE xaatyvntos, ob 3¢ por Oadepds napzxofrye ; le mouvement est +
« j’ai tout perdu, mais toi... » (cf. encore Z 86, X 331, 8 236).
b) yae se trouve pour introduire une question ou une explication :
x BOL & Kigan, ric yap tabeyy Sev Syepovesoer ; — H 328 ’ArpetBy, te xai
Gra dprorhec Mavayniiv, codhot yap t6vace (explique le vers 334);
of. ¥ 156, 890, a 337, ete...; — avec ime! : 159 “Hxtop, émel pe ner’
alcay Evetnecas 088 onto alsav... « Hector, puisque tu me prends a
parti A bon droit (je te dirai ceci) »; cf. N 68, + 103, etc...
§ 47, Un des problémes qui se posent & propos du vocatif! est celui
de l'emploi de Ja particule &, Chez Homére, l’emploi de la particule
est moins fréquent qu’en attique (et plus fréquent dans l’Odyssée
que dans I’Jliade). Tandis que, chez Platon, & eat devenu la formule
de politesse banale, usage de la particule répond chez Homére 4 une
intention : interjection exprime souvent un ton assez vif et brusque.
Au contraire, on n’emploie pas © en principe lorsqu’un homme
s’adresse A une divinité ou un inférieur A un supérieur, une femme &
son mari, un serviteur 4 son maitre. L’emploi de @ est en définitive
exceptionnel (huit exemples sans 4 dans ’Jtiade contre un avec o;
cing exemples sans @ dans l’Odyssée contre un avec 4).
Lorsque Athéna emploie © en s'adressant & Zeus, c’est avec un ton
d’impatience, ainsi @ 31. De mémie, c’est dans une dispute qu’Arés,
en 394, interpelle Athéna : & xuvéyua « mouche a chiens... ».
Il est exceptionnel que la particule se trouve employée avec un
patronymique (cf. 7 287, » 517). En revanche, elle s’observe dans des
contextes, dont le ton d’émotion est sensible : A 158 &hh& o2/, & péy’
dyadéc, tonduct”...; — B 796 & yépor, ael ror per gidot dxorsol eborw s
— & 189 ethos & Mevédze (dans la bouche d’Agamemnon) ; — I] 24
& ’AyAe (dans la bouche de Patrocle); — ¥ 19 yaipé po, & Me
cpoxds (Achille s’adresse & Patrocle mort); — 2 300 6 ydva (Priam
s’adresse & 8a ferme).
*Q semble se trouver 4 sa place dans des scénes de ton familier :
E115 @ gihe, tis yap os apixto xredtecary toiowv; — On a observé que,
dans la scéne entre Eumée et Ulysse a la porcherie, la particule n'est
pas employée moins de six fois en quatre-vingts vers (£ 80-166).
4, Schwyzer-Debrunner, p. 59; J, A. Scott, Am, Journal of Philology 24, p. 192.
CHAPITRE V
LACCUSATIF
§ 48, On ne peut donner. de l’accusatif! qu’une définition fort large.
ll exprime directement objet sur lequel porte D’action verbale
(sans introduire de précision accessoire), Par extension, il a pu s’em-
ployer avec des substantifs et surtout des adjectifs.
On distingue, pour la commodité de lexposé, l’accusatif d’objet
direct (avec des verbes transitifs), les accusatifs d’objet interne, de
direction, d’extension spatiale ou temporelle, de relation. Mais, dans
tous ces emplois, la valeur propre du cas ne varie pas profondément,
Chez Homére, l'emploi de l’accusatif ne différe pas essentiellement
de celui que l’on observe en ionien-attique, mais il n’est pas encore
bien fixé et apparatt plus libre. L’accusatif de lobjet externe est,
bien entendu, banal chez Homére, avec des verbes qui présentent
aussi cette méme syntaxe en ionien-attique. Les premiers vers de
PIlade contiennent des accusatifs compléments des verbes dsidev,
xtOévar, mpodarery, Tedyery t
Af Mi derde, ed, My dyridew “Axrios
odhopévay, H pupil "Aymoig dhye’
TOdag 5 igbtpoue puyds “Arde apolarpey
‘Apwwy, adtobs Bb Ehddcra tedye xbveocrv. ..
§ 49. Toutefois, cet emploi de V’accusatif est plus étendu chez
Homére qu’en ionien-attique.
A) Les verbes signifiant « dire, parler » sont suivis de l’accusatif
de la personne 4 qui l’on s’adresse (cf. aussi § 52) :
N 725 Moududdpas Spacby “Excoca cine...
P 651 xai tit’ to’ Atag elne Boy dyz0bv Mevéaov.
A proximité de l’'adverbe ivtiov :
= 155 (et ailleurs) cov 8 ab Necropidns Metstotextos ivtiov wba...
Enfin, avec un verbe composé, le préverbe semble «régir »]’accusatif :
3147 (et ailleurs) chy 8 dxapebdpeves npoadny Eavldg MevéAaos,
1. Schwyzer-Debrunner, p. 67; J. La Roche, Der Accusatif im Homer (Homerische
Studien), Vienne, 1861.
L’ACCUSATIF 39
B) Avec les verbes signifiant « dire », on emploie également l’accu-
satif pour désigner la personne dont on dit quelque chose :
A 90 008’ 4 "Ayzuépvova efxys... « pas méme si tu veux parler
d@’Agamemnon »; — [ 192 etn’ dye wot xat tovte... d ti 88° gti « dis-
moi encore celui. +, qui c’est ». Noter Z 480 : xal noré stg efor « ma-
pds 7’ BBe TOAAIY dpeivwy » | bx ToAEBov dvidvea,
Les verbes exprimant |’idée de connaissance, de souvenir, peuvent,
comme en attique, étre accompagnés d’un accusatif qui se trouve
souvent en concurrence avec le génitif. Avec oda : Z 150 S9p’ & eldiig |
typerépny yeveryy, noddot 8é rv AvBpeg Leas ; — E 702 Envboveo werd Tpibesarv
“Agena; — 9 549 al x’ altov yyw vymeptéa mivt’ bvénovta ; — B 409 dee
yap xutk Quniv dBedgedy dog éxovetzo (of. N 275, E 604, ¥ 314),
Avec péuvnya:, Paccusatif s’emploie avec un sens un peu différent
du génitif : avec le génitif « se souvenir de », avec l’accusatif, qui n’a
pas la valeur partitive du géuitif, « avoir le souvenir de, se souvenir
complétement de » : [ 527 péwvypar 96 af-
wxtog Eppa mio « pour que je boive du sang »; mais, avec Vaccusatif,
2 98 tei niev aly xerawvdv « quand il eut bu le sang noir » (cf. encore
o 391, ete..., ef avec des compléments comme xinedx ou xpyriga ;
A 346, © 232) : le génitif est choisi lorsque l’attention est attirée sur
une certaine quantité de boisson ou de nourriture prise sur ce qui est
offert. — Méme emploi du génitif avec des verbes de sens voisins
comme yevecta. « godter », ou cette syntaxe est particuliérement
naturelle, cf. au figuré ® 60, etc... Sovpdg dxwxiic fuetépowe yevoerat 5
— nasdo8ar « se rassasier » (« 124); — doa « rassasier » (E 289) ou.
«se rassasier de » (® 168, T 307); — Svyo0 « profite de » (x 68); —
A 562 éxopésoato popbijc « il s’est repu... »
La syntaxe de cépxeofa mérite d’étre examinée. Le verbe signifie
« jouir de, se rassasier » : A 780 émel rdépmmpev e8yrbo¢ WBE moTirog
« quand nous eimes satisfait notre soif et notre appétit »; — y 70
émel tdprenoav E8ad%¢ « quand ils eurent joui des plaisirs de la table » ;
au figuré ¥ 10, 4 242: — Mais, au sens plus évolué de « prendre plaisir
a, se réjouir », on a le datif instrumental :- 1 441 gidét yt tpunelope 5
— 8597 psdoraw tnesal re cota dxovuy | céprowe,
4, Sur cet exemple, et sur le géaitit partitif comme sujet, voir Nachmanson,
Goteborgs Hogskolas Arskrift 48, 2 (1942).
52 CHAPITRE VI
Les verbes exprimant Vidée de « baigner, laver » présentent la
méme concurrence entre le génitif et le datif. Ainsi Aovectar : Z 508
rovesOat... worayolo; mais ¢ 216 Actclo. notapoto foyjor; — de méme
avec vitew : B 261 yetpas wicuevos mody¢ ddé¢; mais ailleurs Vinstru-
mental S3ar., cf. A 830 alua xerowiy | vit? S3an deaeg et méme IT 229
Eup WBatog xadjjor dofjer.
Le génitif exprime d’une fagon générale la chose dont on prend
une partie. En particulier pour exprimer la notion de plénitude :
1 244 ndsce 3° dads; — 1 224 rajaduevog 8° olvaro; — 8 134 viuaros...
Bebvoudvov; — 0 22 qipow | aluacec; — A 470 xeyriipas éneactbavzo
nozoto « ils couronnérent (remplirent jusqu’au bord) les cratéres de
beisson »; — I 580 redtoo r2zéc0x « tailler dans la plaine »; —
+ 219 tapaol usv rypiiv ApiBov, atelvovzo 38 anxol | dpvaov 43° Eplgav « les
claies étaient chargées de fromages, les stalles bondées d’agneaux et de
chevreaux »; — y 408 droavikGovres dAciparos « brillants d’huile » (mais
le datif © 596) ; — e 72 rewédvec... tov 488 cedivon | OFAeovs
Noter Pemploi avec le complément nupéc : Z 331 katy mvpds Snore
Gépnto. « que la ville [ne] se consume dans le feu dévorant »; —
p 23 mupds Oepéw « se chaufler au feu »; — I 242 éumphaew padepod
mupés ; — H 440 mvpts uettoatuey « faire Phommage du feu ».
Un génitif de la personne se trouve avec les verbes signifiant
« profiter de, etc..
sh aev hog bviaerar ; — 2 452 vlog ewxdnabijva « profiter de la pré-
sence de mon fils ».
A 410 twa mivies enatpavre Baariog; — I 34
§ 63. D’autres groupes sémantiques s’associent volontiers au
génitif +
a) Les verbes signifiant « toucher, atteindre, ete... ». Le verbe
suyxaverw n’admet pas Vaccusatif (en A 106, E 582, myay et tuxhoag
constituent des parenthéses; en O 580, civ dépend de Bardy plutdt
que de riyysc). Le génitif est bien attesté, cf. 1 609; — deyydvew
admet le génitif, © 76, « 311, et l’accusatif, A 49, Q 70, ete... ; noter
a Paoriste redoublé et factitif : H 80 mupdc... Aerkdyuot Oovdvrx; — eu-
ope en A 278 Euwops tuys; cf. peut-étre yeloco (I 616). — Un verbe
de sens contraire, ipapvéve est également suivi du génitif ; ef. K 372,
etc... Mais, en ce cas, l’emploi se trouve proche de celui du génitif-
ablatif.
Le génitif de but s’emploie avec des verbes qui indiquent un mou-
vement, faisant concurrence a l’accusatif : H 428 vexpodc nupxaiic
éxevivecv « ils entassaient les morts sur le bicher »; — N 643 diya
& dahdov epixovto « ils sont tous deux l'un sur l’autre en méme
temps »; de méme : émGatvew (¢ 399, E328, © 129, ete...) ; Eméaoxéuev
(B 234).
LE GENITIF 53
Cette syntaxe ne s’observe pas seulement pour les composés avec
él : O 693 &s “Exrup tvae vebc xvavorpdpao dvelog diac (le génitif
«dépend » et de Ouse et de dvtoc); — avndfo, ou avrde « aller vers,
aller au-devant de », cf. N 215 xodéuoto .. dvréav « affronter la bataille »
ou « recevoir » (x 25, A 67, etc...); sur l’accusatif avec ce verbe, § 55;
sur le datif, § 86 ; — dv-bortou (A 342)2.
6) Le génitif s’observe avec les verbes signifiant « s’attacher a,
prendre, tenir » : A 512 tate youve (cf. 3 60); — exe signifie « te-
nir », mais ¢yeaQar « toucher a, s’attacher a » : ¢ 429 rig Exero atevayav
(ef. 1102, « 435). Sur ’emploi de gyouar avec le génitif-ablatif, voir § 79.
Les verbes signifiant « prendre » fournissent de bons exemples :
N 393 xéwos dedpayyévos « agrippant la poussiére »; — ¥ 711 dyxdc
& Didthov dabéryv; — t 225 wupéiv alvoyseoug « en prenant des fro-
mages » (cf. 4 64); — d’ot. E 310 = A 356 épeioato... yatns « il a pris
appui sur le sol ».
Le génitif a notamment indiqué par quelle partie du corps Von sai-
sit quelqu’un? : A 197 EavOig 38 xdurs be TInpetwva ; — en A 323, yerpdc
&év- « prenant par la main » est bien différent de ce que serait
ystoa Bréve’; — A 407 adée ~otwov (of. ¢ 365); — A 463 xby BE neadvea
roBiiv Arab; — A BOL pihe nodde veraydy; — X 493 sd0v pe prays
Epdav, ov 88 yhatvng; —T 78 pésoou Sovpds Edy « tenant sa jave-
line & mi-hampe ».
Apres certains verbes, l’idée de « prendre » est seulement impli-
quée : A 258 fixe modés « tirer par le pied » (cf. = 477); — ¥ 854
Bijoey wo8Ss; — O 51D yépovex BE yeipdg dviom ; — y 439 fotw 3° dvémy
xepiev.
Ces derniers emplois doivent reposer sur des génitifs proprement
dits ; toutefois, ils continuent peut-étre pour une part des ablatifs.
Remarque. — Le verbe Alocesta: pouvait étre suivi d'un génitif dési-
gnant la personne au nom de qui l’on supplie (cf 6 68 et § 82).
Lianalogie de ce tour et celle de AxpEdvew, &xtecbat ont conduit a
des expressions du type de I 451 4 8° alév gud \ueakoxe70 yolwav
« elle me suppliait en me prenant les genoux » (cf. x 481, x 337).
Lranalogie a été aidée par les tours off Atcoecfat el eBay ou hav
se trouvent associés : Z 45 AnGdv éANoaeto youve (cf. ® 71, f 142,
¥ 810). Sur X 943, voir § 82.
§ 64. Les verbes exprimant l’idée de « viser a, chercher & atteindre»
sont proches de ~vyydvew et s’associent volontiers au génitif. Ainsi
dpéyount est suivi de laccusatif, lorsqu’il s’agit d’une partie du corps
(cf. § 55), mais du génitif, lorsqu’il s’agit d’une personne : Z 466 of
1, Schwyzer-Debrunner voient dans ces génitifs des génitifs ablatifs (p. 97, ete...}.
2. Schwyzer-Debrunner, p. 129.
54 CHAPITRE VI
mauddc Spétaro « il tend les bras A son fils »; — IT 322, le génitif peut
dépendre de &p6y, plutét que de dpe%dwevos ; — émpatopa. « chercher
4 atteindre, désirer » (¢ 344, u 220, K 401) (pour l’emploi avec
Paccusatif, voir § 55); — teva « s’élancer vers, désirer » : 0 69
igpevov véozoo ; A 168 léuevor xédog (voir encore x 529, ¥ 371); —
ESoua « désiver » est volontiers suivi du génitif : '¥ 122 e8dpevar me-
Siow ; ete... (pour l’accusatif, voir § 55); — le parfait de yeyjoSan, xé-
yenuas « désirer » : « 13 véotov xeypnuévoy ASE yuveuxds 2124 xom-
B¥ig xexenuévor svBpec (cf. v 378, x 50); — T 262 oti’ edviic mpdpacny xe-
yenuévos oice tev &Adov : ebviic semble servir a la fois de complément &
Redpacw et a xexenuévoc (cf. aussi la note de l’édition Leaf) « par
désir avoué de son lit » (Mazon); on observe enfin que certains em-
plois de xexyenuéves sont proches du sens de privation et que le géni-
tif se trouve ainsi au contact de lablatif ; — autres verbes signifiant
« désirer » : pépova, participe ueuavia (E 732); — énetyoum (T 142,
a 309); — Yeaya (I 64); — épacitay (P 660); — tyelpw (x 555); —
Mreclopart (x 315; mais, avec l’accusatif d’un mot neutre, E 481, « 409) ;
— lyavdw (¥ 300, 9 288; sur la forme, cf. 1, p. 360); — newhpevar
(v 137); — dhelovres (E 37); — noter @ 159 rdkou newphoer; M 301
uipov neghoovra (of. 1 345, 9 124, x 237). :
Verbes signifiant « viser, titer sur » : tofebew ( 855); — dxovritew
(P 304) ; — drozevew (A 100); — terboxeoton (N 159).
§ 65. Une autre catégorie importante est constituée par des verbes
exprimant une opération des sens : dxovew, ete... En principe la
personne ou la chose d’ou vient le son est exprimée au génitif, ce que
Von entend est 4 Daccusatif : A 455 tév 5€ te tHAdce Sodmov... Exdve 5
—T'76.... piov dxovsug ; — A 357 tod 8 Beve nore hme ; — 8 505
0d St Tloceddev.,. dehvev adSioavros; — 0 491 kdov dxoboac. Le com-
plément de personne pourrait étre un ablatif (cf. Schwyzer-Debrun-
ner, p. 94), mais la comparaison engage 4 y voir plutét un génitif
(cf. Humbert, Syntaze..., § 374).
Des termes comme éy, 2534, etc..., peuvent désigner la voix en
tant qu'elle émet un son et qui n’est percue que partiellement (géni-
tif), ou le son perou totalement (accusatif) : 2 198 pOoyy%i¢ Letphvev
jeobouev; — X 447 xuxurod 8 Fxovae, nal olwayiig; — X 451 aidoing
énvpfig dndg Bdvov; mais O 270 beod exdwov bra; — + 401 Borg dlovres ;
thais © 222 dov &xx.— Combinaison des deux tours en » 265-266,
poxnyod 2° Yovsw Bodv adaLouevtev | oldv te BAnyiy.
Méme syntaxe pour xevoum, génitif de la personne et accusatif
4, En 6 23, accusatif dela chose et génitif dela personne, tod; (a¢0hous)... émerpy-
cay’ O’vohos ; accusatifen 6 119 = w 238 Exacta muphoaico, cf. Y 601.
LE GENITIF 55
de la chose : O 379 émifovco Atds xrinov « ils entendent le fracas » (cf.
P 408); mais O 224 udyns énidovro xal kot avec un sens différent,
« dautres ont lexpérience de la guerre »; on opposera de méme
le génitif de Z 465 et Paccusatif de x 147. — Noter Pemploi du gé-
nitif au sens de « s’informer sur quelqu’un » : 2 281 revadpevos na-
pd Biv olyopévoio; —-P 377 ome... nenbaOyy | ... Tlarpéxhovo Oavbvrog
(cf. v 256). — Mais laceusatif de la personne sur qui on apprend
quelque chose : E 702.
De méme avec dxotew le génitif partitif peut désigner la personne
ou la chose au sujet de laquelle on s’informe ou I’on apprend quelque
chose : 3 114 natpdg &xobeac « ayant entendu parler de son pére »
(cf. y 15, v 256, ete...). Avec un participe : x 301 pq mic Eners® "OSvetog
dxovsdte ev8ov édvrog « que personne n’entende dire qu’Ulysse est a
la maison »; — © 490 xeivég ye céOev Covtog dxobov | yaloer. En ce sens
de « au sujet de », la prose a employé la préposition rept (cf. déja
370 sqq.).
Le génitif peut. done exprimer concurremment et ce qu’on entend,
et la personne au sujet de qui l'on entend, et la personne de qui l'on
entend : on a ainsi deux génitifs sur des plans différents : p 144-415
*OBusayog... Ceood ob88 Oxvdvrog enryBoviev tev dxoticw. « apprendre d’un
des immortels quelque chose sur la vie ou la mort d’Ulysse ».
Remarques. — I. Les verbes signifiant « entendre » se sont prétés &
prendre le sens d? « obéir » : 0 220 of 8° &pa 705 dda pdv wrbov ABE
rtBovto ; — O 236 038’ Kea natpde dvnxobatysev *"Anbddwv (cf. Y 14).
Avec le génitif de la chose : 8 767 Oe& 58 of Exdvev dpijg (cf., pour le
datif of, § 88).
II. Le génitif exprimant la personne que l'on entend doit étre
proprement un génitif partitif. Toutefois, il est proche du génitif
ablatif, comme V'indique certains tours prépositionnels : Z 52%
aleye’ dxobi | mpdg Tpduv; — V 129 catira Oedv &x nebaerar dn0%6.
Le verbe cvvinut « comprendre » s’emploie de fagon comparable :
« 34 cotw 38 Euvény’ tepdv usvos “Avenéoto (roitw génitif) ; ef. 876; — ac-
cusatif de la chose : B 182 Evvénxe Oks bna ; — génitif de la chose :
A 273 xt dv pev Bovdéev Etvtev,
§ 66. D’une maniére générale, le génitif s'est employé avec les
verbes de connaissance : } 109 ywwodyed’ dXWAov « NOUS NOUS Tecon-
naitrons lun l'autre » (cf. ¢ 36, dans les deux exemples on a une
variante @0frw); avec un participe : A 357 &3 yS ywoudvoro; —
avec le verbe édyv : + 325 misc yap tue ot, Eetve, Sajoent « comment
sauras-tu 4 mon propos? »
Les verbes signifiant « savoir » sont volontiers suivis du génitif
56 CHAPITRE VI
partitif, en particulier au sens de « s’y connaitre » : M 229 é¢ odpa...
eldetn tepdav; — O 412 réxrovos... dg dk te mkong | ed ei8% coping; —
® 487 rortuoto duqyevat; — en particulier avec un participe : B 718
roEwv &) elBehg; — a 202 luvv adga *i8ebs; — A 710 ol}... ei8dre Oodpidos
exis — M 100 payne ob elBdre dons; — I 814 8:Bxoxdpevos roArguouo 3
— ¢ 406 pdppryyos emorduevos xat dordijc, — Noter K 493, anfeccov
yap Er’ abrév « ils n’y étaient pas encore habitués ».
“Verbes exprimant Vidée de « se souvenir de, faire mention de »,
etc... : ¢ 29 pvhoaro yap xard Oopby dubpovog Alylofoo ; — a 321 int
uynoev 8 & maiddc. Méme syntaxe pour les verbes signifiant « oublier »
(ou le génitif se trouve proche du génitif ablatif) : TT 357 of 8 pééo0 |
Svoxed8ov pvisavto AdBovto Se OobpiSos dAxyig7 — V 648 dc uev del pé-
prjoat evydog ob8¢ ce A4Go Tyg « tu te souviens encore de mes bon-
tés, et tu n’oublies pas ’hommage... »; — 4 224 é& 8€ pe mévtev | A7-
Odver... (sur Pemploi de Paccusatif, voir § 49 E). C’est A ces emplois que
se rattache un tour comme ) 174 elné 86 pot matpdc te wal vidos... A err
nip xelvorowy éudy yépas, Fe...
Quelques exemples avec epi ont un sens un peu différent : 7 194
rep rouniis | yynodueOx « nous aviserons au retour ».
§ 67. Verbes signifiant « se soucier de, craindre pour », etc... : A180
adder 3° eye odx dMeyito | 0d3° Soum ; — B 384 nodéuoto yed{oGo (autres
compléments avec ce verbe éxi¢, véotov, xoltov, Snvov, ete...); —
« 271 éudv eundteo wibev (cf. + 134); — E 708 péya mrobroro weumrcis 5
— 70 0d phy pev Ldovrog dachBerg; —- 1 630 0838 perarpérerae persentos 3
— 8 820 ro5 8 dyqurpopto xai 8éBia pH te wk6Oqou. Sur la concurrence de
rept et sur K 93 et P 240, voir § 179. Concurrence de |’accusatif :
268 vnéiv dra perarvdwy dréyousr (ce qui évite une cascade de génitifs).
Méme syntaxe avec des verbes signifiant « défendre » : M 155
duvvduevo: opav abtéy te xal wucdov ; cf. M 179. Le verbe a l’actif est
volontiers suivi du datif (cf. § 90); toutefois, le génitif est parfois
attesté : A411 adrod xfjpas &uiver; ef. M 402, N 140, 11 522, 5 1741 (avec
le datif comme variantes dans ces deux derniers exemples). Mais,
dans ce tour, le génitif est également proche de V’ablatif (cf. § 78). Cest
ce que confirment les constructions prépositionnelles. On trouve P 182
rept Tlarpdxroo Oxvdvioc, mais II 80 vetiv dm, Le rapport avec rept
s’observe également dans l’emploi du composé nepi6jvon : E 21 rept-
6fiva aBedperod (cf. § 179).
68. Un emploi particulier du génitif est celui que on observe
> ‘pion Pp g q
1, Sauf pour peynhid<, on a, avec ce verbe, des tours comme pelyjgoust 8 Epol
frmot, En revanche, N 419 093’ E03 dudinoev éruipad.
LE GUNITIF 57
avec les verbes signifiant « régner sur, dominer ». II s'agit bien 1a
d’un génitif partitif, comme l’indique, par exemple, la comparaison
du sanskrit, qui emploie Je génitif avec la racine ksi- « régner », ou
la syntaxe du verbe dvéssw accompagné du génitif, qui indique dans
quel domaine s’exerce l’autorité : A 38 TevéSo.o te tpt dvdaaers (cf.
Z 478, etc...). Le génitif est en concurrence avec le datif (locatif),
qui s’emploie volontiers pour les noms de peuples ou de personnes
(cf. § 111); noter Y 180 Tpdeaaw dvatew innoSduorn | tig ts Tptdpou
« régner parmi les Troyens sur tous les droits de Priam » (de méme
zyshs dvdooew en w 30). Rares exemples du génitif désignant des per-
sonnes : K 32 ’Apyetav ivacee ; cf. 4 276.
Méme syntaxe avec Baovebo : 4 285 IIbhov Bacitev:; mais « 404
Bucvetoer ’Ayadv; — xpatéw (A 79); — onpatve (EZ 85); — Oeproreber
(. 114) ; — hyepoveto (B 527) ; — Xpye (B 494, etc...) ; — avec jyéopor
(M 104), mais le datif I 169.
Le participe pedtav dans Aw3dvng uedtov ([1 234), etc..., est isolé.
§ 69. Au sens partitif du génitif peut se rapporter la valeur d’appar-
tenance qui apparait en particulier avec le verbe étre (cf. latin domus
est patris) : Y 241 rabry¢ tor yeveiic te xal afparog eyouot evar; —
E457 vuch_ utv 8h oatver’ dpnipiaov Meveddou (cf. encore ® 109, 5 232),
Ce génitif, d’ailleurs voisin du génitif complément de nom (cf.
§ 75), se trouve parfois proche du génitif-ablatif. Cf. © 89 ti¢ 8% duu
yevdueo0a.
Remarques. — I. Ce tour a été concurrencé par éx suivi da génitif :
® 189 Alaxdc éx Aros fev.
II. Cest, en définitive, de ce type de génitif que reléve un tour
comme ® 360 ti pot piSoc xat dowy ic « qu’ai-je affaire d’aller a la
bataille et leur porter secours »?
§ 70. C’est également au génitif partitif que se relie l'emploi du
génitif de matiére : K 262 (xovény) pivob noryriy ; — E574 ypusoto te-
zebyato ; cf. encore + 226. Ce génitif s’est trouvé en concurrence avec
le datif instrumental (cf. § 102). — Avec un substantif : A 24 olpor...
sudvoro ; — 8 124 tamyze... éptoro, ete...
§ 74. La notion de prix situe un objet ou une action dans une cer-
taine « sphére » : ¥ 485 tplmodeg mepidduebov « parions un trépied »; —
V 78 éyé0ev nepidcsoouat « je me donnerai en gage* ».
La méme syntaxe s’observe avec des verbes comme ttzdobu : Y 649
1. Wackernagel, Vorl. ber Syntax 113, p. 218, indique que le génitif pent se trou-
ver en rapport avec le nept du verbe.
58 GHAPITRE V1
(vuiic) Fic té wo Eome rettuycar; ou avec des adjectifs comme &£to¢
(® 234, ¥ 885, ete...). .
Cette notion de prix se retrouve avec les verbes signifiant « acheter »
ou « racheter »: X50 yadxod te ypvaot +’ dmodvadueba (cf. A 106, etc...) 5
— 2 327 ypuadv gitov dvSpd¢ eéZaro Theva « regut de Por précieux
pour prix de son mari ».. Ainsi s’explique l’emploi du génitif avec
duel6e. « échanger » : Z 236 tedye’ dusibev ypdcex yarxelwy « il échan-
geait des armes d’or pour des armes de bronze ».
Remarque. — Noter A 547 dhtyov yévu youvds d&uel6wv « changeant de
peu un genou pour l’autre », c’est-a-dire « marchant lentement ».
§ 72. Une des originalités du génitif est d’avoir fourni des complé-
ments de lieu et de temps. Ce génitif de lieu et de temps n’est, en
somme, qu’un cas particulier du partitif. Nous avons déja rencontré
des génitifs qui peuvent étre considérés comme génitifs de lieu (cf.
§ 63, A 197, A 356, eto...).
La syntaxe du génitif proprement local est nettement attestée
chez Homére et tendra ensuite a disparaitre : y 251 # obx "Apyeos fev
*Ayauxod « Ménélas ne se trouvait-il pas dans Argos l’Achéenne? »;
— 9 108 atm viv obx kore yuvh xan’ "Ayauida ~yatay | otite IIvaov tepyc, oft”
“Apyeog, ote Muxhyns ; — « 24 of wey, Sucopevov ‘Yreplovos, of 8° dvudveog
« les uns dans la région du couchant, tes autres dans celle de l’au-
rore »; — I 249 dyrlov Iev... | tolyou rot érépoio « il s’assied en face
(du divin Ulysse) contre le mur opposé » (cf. Q 598, ¥ 90); —
P 372 végos 8” of gaivero atone vaing; — u 27 9 dndg 4 enl yg; — 8 678
adrfig éxtdg édy « 6tant dehors dans la cour » (plutét que « hors de la
cour? »); — c’est de la méme fagon que l’on peut expliquer + 239
Badetyg txrddev addi « dehors, dans le creux de la cour » (mais di-
verses corrections ont été proposées).
Le génitif s’emploie avec les verbes de mouvement pour indiquer
espace dans lequel le mouvement se déroule : K 353 Sxcuevn. veoto
adelng myxtbv dipotpov « a travers la profonde jachére » (cf. ¥ 5418).
I] s‘agit généralement de vieilles formules, particuliérement de géni-
tifs en -o1o, qui occupent la fin d’un vers : ©2 264 tva nphoswpev d380t0
« pour que nous avancions dans notre route » (cf. 8 404, y 476...),
Crest surtout le génitif we8too qui, de fagon formulaire, figure dans
des expressions de ce genre : A 244 rodtog nediowo Oéouse « courant
par la vaste plaine »; — X 23... Oéner rrrawéyevog medioro « court en
allongeant dans la plaine »; — E 597 ... téw modog neSicto (cf. B 222);
— N64 neSiovo Sidxey 5 —¥ 475 redtow Sievrat ; — N 820 xoviovtes we-
diovo « en soulevant la poudre dela plaine » (mais l’accusatif en 3 145);
— B 804 kpyovra: mBioro; — B 785 Sumpnesoy neSiowo, of. P14, ete...
LE GENITIF 59
(mais v 83 rpjscous xéhev8ov) ; — Z 38 d&rtopévo medtoro « affolés dans
la plaine »; — ® 602 redioro Sicdxeto mupopdpoto (mais pour s 8, voir
§ 78); — © 247 neSior... méteaban, ete... 1.
Noter enfin le tour “At8oc 8& Bebyxer «... chez Hadés » (II 856, ete...).
Remarque. — Le caractére partitif de ce génitif est mis en lumiére par
les exemples ov il se trouve associé 4 un adverbe : Z 2 EvOa xat Ev0’
YOuse udyn medtoro ; — § 639 mou xdtod &ypdv; mou et adroit sont ad-
verbiaux, éypév partitif.
§ 73. Un méme emploi du génitif présente une valeur temporelle
et indique comment le procés exprimé par le verbe se découpe dans
Yétendue du temps : v 278 ixdvoyev évOaide vuxtd¢ « nous sommes arrivés
ici 4 un moment de la nuit » (distinct de were « tout le long de la
nuit », ef. K 342, § 54) ; — © 470 jote... Sen «des Paube... tu verras »
(distinct. de 44 « pendant tout le petit matin » en @ 434, ef. § 54); —
71 118 ollmore xnpmdc dmbdurar ob88 deiner | yeluarog oS88 Oépeuc « de l’hi-
ver ni de 1’été »; — X 27 &¢ £& tT dmdpne elow « qui vient a un mo-
ment de l’arriare-saison ».
Avec article, le génitif indique le secteur du temps a l’intérieur
duquel quelque chose arrive : & 164 = + 306 rob adtod Auxdéavtog
rebate ev0d8" “Oduaseds « ce mois-ci »; — A 691 tév mportowy ertav
« au cours des années précédentes »,
GENITIF ADNOMINAL
§ 74. Comme complément, le génitif exprime ce qui est de la sphére
du nom, ce qui complate le nom, ce qui lui est lié par un rapport de
participation, et l’on ne s’étonne pas, en définitive, que la méme
forme grammaticale serve 4 exprimer le partitif et le complément de
nom.
Les emplois du génitif complément de nom apparaissent extréme-
ment variés et n’admettent pas un classement vraiment satisfaisant.
Le génitif partitif constitue, il est vrai, une catégorie définie parti-
culiérement proche des emplois que nous avons observés avec le verbe.
A 761 névrec 8° ebyetéwvto Bediv Au Néotopl 1° av8pdv « tous rendaient
grace, 4 Zeus parmi les dieux, 4 Nestor parmi les hommes » ; — II 850,
génitif partitif 4 cété d’un génitif d’une autre nature, ... Antoic &-
ravev uidc, | évBpév 8° Eiqopfog ; — B 198 Siyou... dvBea, ot Je génitif doit
étre considéré comme partitif plutét qu’explicatif.
Toutefois, le génitif partitif sert assez rarement de complément a
1. Cf, encore 147, X 26, © 247, et voir M. Leumann, Homerische Worter, p. 189,
2. 36.
60 CHAPITRE VI
un substantif. I] sert. plutét de*complément d’un adjectif : & 364 (ef.
€ 443) & derrd Eetvav, ete... Surtout avec dia : T 423 dia yowatxiiv...
(cf. B 714, T 171, 228, 423 et neuf.exemples dans |’Odyssée ; d’aprés
cette expression, Sta Oedav : E 381, Z 305, = 184, 5 205, 388, T 6, 293
et vingt-six fois dans l’Odyssée). De méme encore : A 248 épi8eixeros
d8pdv; — y 452 apéoba... Ovyatpav. Les exemples les plus nombreux
du partitif s’observent aprés des pronoms comme ts ou 7c, Exxst0s,
etc... : A 8 (cf. 540) tig top ape Mediv Epds ovens pdyeada; cf, A 88,
198, 271, 547; cf. A 159, A 300. En outre : E 603 ef¢ ye Oeav; — A 118
olog | "Apyetav; — A 428 Exaarog | hyepdvev; — 8 350, p 144 sav od8év.
Avec un pronom ou un adjectif au pluriel : 4 371 twag dvnbéwy érd-
pov; — B 164 (cf. B 177, E541, M 14, 226, © 271, @ 737) morob
*Ayudv. — Au neutre : A 300 tv" Grav & wot gor...
Avec le complément au singulier : A 165 7d yév rdctov modvdixog
orgy.
C'est également un génitif partitif qu’il faut reconnaitre dans le
complément du superlatif, comme Vindique le rapprochement du
latin. Toutefois, le sanskrit emploie parfois en cette fonction l’ablatif
et quelques exemples homériques montrent que l'ablatif de différence
pourrait convenir : A 505 6 axvpopdtutog dddwv | Echet’ « entre tous
(ow plus que tous) voué a une prompte mort ». Cf. encore T 96. Pour
Vemploi de é, voir § 139.
§ 75. Dans tous les autres emplois, le génitif exprime de maniére
trés diverse un rapport, une participation avec le nom dont il dépend.
Le génitif exprime la possession. Ainsi pour les parties du corps
ou des notions apparentées : A 3-4 Woydc... hpdav,; — A 225 xuvds
Super’ Eyov, xpadlyv F erdqoro ; — A 249 tod... ad3h ; — A 395 xpaBinv
Aide; — A 529 yatta... dvoxtos. Cf. encore : A 44 Odavuroro xaphyvov
«les sommets de POlympe »; — A 605 gdog jerlowo ; — A 388 fe vieaow
éa6g, etc... Au sens possessif en général; par exemple dans le chant A
de I'Iliade : 12 viae *Ayady (cf. 71, 347, 374, 559); 14 oréupara...
>Anddavog (cf. 28, 373); 19 Hpduoro nérw; 53, 383 nije Beoto ; 138
Alavros... vépag ; 164 Teddy... wroheOpov ; 322 xdtainy Tp rmidea Ayeijos ;
229 orpardy edpdy ’Ayaréy (of. 384, 478); 396 marpdg Wl uevdeoow ; 426
Atdg ror... 34; 570 dvd Saya Aus. Noter les génitifs qui marquent au
service de qui l’on est : A 334 Asde dyyero: #88 xat dv8pav; — A 370
tepeds... "Anddrwvos ; — ef. A 248 rrybc Hudev dyopytyg. I] existe un
génitif qui désigne la famille ou l’origine d’un personnage et qui se
trouve ainsi exprimer @ la fois la possession et l’origine : A 9 Anrods
wal Ards vidc; 24 Ares vidv; 202 utysdyou Atig téxog ; 255 [pidyoro mat-
Bec ; 302 xodony Borojiog ; 489 [niéos vids ; 538, 556 Suydryp dAtow yépov-
705; 544 narhe dv8piv te Oediv ve; 162, 237, 240 vtec ’Ayouiv, Noter
LE GENITIF 61
B 311 orpovdcio veosaol, et surtout 2 214 yuvaixa noduxdypav dvodnov
«une femme d’une famille opulente ».
Ce génitif exprime une idée voisine de celle de l’origine et, se trouve
ainsi proche de l'ablatif. T 426, Hélene est dite xospy Ards, mais l'on
peut rapprocher T 199, etc,.., o Atds éxyeyauta, avec l'emploi du pré-
verbe é&, se situe nettement dans la sphére de l’ablatif.
A cété d’un nom propre sans autre mot signifiant fils ou enfant,
On a Osos tayd Alas (B 527, N 66, B 442, P 256, ¥ 473, 488, 754).
Ce tour, bien attesté dans le grec postérieur, est exceptionnel chez
Homére et on a voulu l’éliminer en interprétant Otajiss tayds Alas
et en voyant dans *OuAhtog un adjectif patronymique (W. Meyer, De
Homeri Patronymicis, 1907, p. 22).
D’une maniére plus générale, le génitif se préte 4 exprimer l’origine :
A 273 ... uev Bovdev « les avis qui viennent de moi »; — A 385 Oeonpo-
rlag ‘Exdroto ; — B 396 xipare... xavroiav dvénev « les vagues soulevées
par des vents soufflant en tous sens »; — B 723 @dxet... 8pou « la bles-
sure faite par une hydre »; — H 63 Zepbporo... ppt& ; — A 305 végen...
Nérovo ; — 1 411 voiigov... Awd « une maladie venant de Zeus ».
Remarques. — I. C’est peut-étre a cet emploi du génitif qu’il taut rat-
tacher le tour dpundels Seo en 9 499 (cf. § 81), car le tour semble
se retrouver en indo-iranien avec le génitif et non l’ablatif (cf.
Schwyzer-Debrunner, p. 119, et la bibliographie citée).
IL. C'est également a cette catégorie que l’on peut rattacher le
génitif de matiére avec un substantif (cf. § 70).
§ 76. Au génitif possessif et d’origine se rattache le génitif dit sub-
jectif, c’est-a-dire qui deviendrait le sujet, si l’expression était ver-
bale et non nominale : A 1 piv... Tyaddem ’Ayrtjog (= Hy pyle); —
A5 Aude Bourh ; — A 49 wrayyh... dpyupfowo Broto ; ~— A 203 SBpw... Aya
pduvovos; — A 224 pile ’AOnvaing ; — A 495 apetudev | maid dod 5 —
B 767 ¢éov “Apyog « la déroute qu’inspire Ares ». Le génitif peut
également exprimer non le « sujet », mais I’ « objet » : 1 421 Savécov
avew « libération de la mort »; — ¢ 443 oxénas... dvéuoro « protection
contre le vent ; — A 16 xoayhtope Aadiv; — A 106 udver xaxdiv; —
B 380 avé6rnarg xanod; — 0 326 Oeot Seariipes dav; — B 347 dwaig 3°
odx Eoerat adtéiv ; — © 344-345 voron | yalng Pauteo,
Dans quelques cas, le génitif peut également bien exprimer l’origine
et lobjet : o 8 wert8nuata maxpds « ses inquiétudes pour son pére », ow
« venant de son pére »; de méme : © 458 dyoc ebEapévoro « la douleur
qu’inspire ce cri de triomphe »; — O 25 636vq ‘Hpaxaijos « le chagrin
que lui inspire Héraclés »; — O 138 yédrov ulog ; — E 88 névOog... randd¢
anopOtuévoro. Le sens objectif est net dans des exemples comme :
© 28 xowihy Uatpdxdoro... Gavdveog « expiation pour la mort de Pa-
62 CHAPITRE VI
trocle » ; — a 40 tits... "Axpet8xo « le chatiment pour venger l’Atride ».
Remarque. — Un vers est discuté en B 356 = 590 thaacBar 8° “Edxévng
dpyhpatt te otovayde te « venger Jes sursauts de révolte et les san-
glots d’Héléne ». Il faudrait supposer une forme de la légende ou
Héléne a été enlevée de force et non pas séduite. Mais l’interpréta-
tion d’Aristarque fait d’Edévy¢ un génitif objectif « les combats et
les sanglots dont Héléne est cause ».
§ 77. Parfois le génitif comporte une valeur purement explicative
et descriptive, si bien qu’il se trouve trés proche de la valeur d’une
apposition. En partieulier, avec des noms de villes : « 2 Tpotn¢ tepv
roMeOpov; — B 538 Atov 1’ aim) nroMedpov; — y 485 et 0 193 I1dAou
alm) wtodeOpov (mais le plus souvent des tours appositionnels comme :
B 501 Me8edva 7’ tuxtinevov mrodigbpov, cf. B 505, 546, 569, 584, y 4,
8 283, » 377; ou le génitif du nom de peuple : A 164 Tpdav... mtoAle-
pov, cf. « 165); — de méme : A 103 tepiis els ory Zerelng ; — A 406 O4-
6g 80g; — 0 301 Atpvor yataw beéoBon,
En quelques passages, la tradition des Anciens et de nos manus-
crits hésite entre ’INov et "Tov. En B 133, Aristophane préfére "Tov...
éxnépoa... mrodteOpov, plutét que ‘Ialov. Méme variante en N 380,
® 433; "Tatu est la legon des manuscrits en A 33, E 642, © 288,
*Trov en I 402.
Avec des noms d’étres animés : A 250 yevea! pepérov &dWpdnov ; —
A315 txardp6ag | raipev; — A 454, ete... dadv “Axenéiv ; —- B53 Bovad...
yepvtav ; — E676 nn8dv Auxtay ; — K 338 troy ze xul dv8odv... Sucrov,
Le méme tour s’observe encore avec quelques autres substantifs,
oa le génitif comporte une valeur explicative : Z 346 dvépow Odedra
« une bourrasque de vent »; — y 152 nijpe xaxoto.
Enfin, c’est 4 cette syntaxe qu’il fait rattacher le tour formulaire
avec un nom de personne au génitif, du type ofévos "Hetiwvoc (‘Y 827),
Is Tyrendxou (8 409), tepay pévos ’Arxivder0 (v 20),
Avec des noms de parties du corps : B 851 Tludapéveog Adotov xHp ;
— A 500 doSpdiv nince xdenva; — I 407 tnmav favOd xdpnva (of. ¥ 260,
x 524).
La variété des emplois du génitif complément de nom s’observe
bien si ’on rassemble ces divers compléments de gpxog : E90 gpxen...
@rokov « clétures des vergers » (génitif possessif); — A 137 Epxos
dxévrav « protection contre les traits » (génitif objectif); — A 350,
etc... texog b8évrav «l’enclos de tes dents » (génitif descriptif) }.
Remarques. — I. Le génitif exprimant l’appartenance, de méme que
4, Un tel gtnitif se lrouve proche du génitif « de matidre »(cf. § 70} : ainsi Eoxoc
wacorcépou (2 564), vigor xudvoto (A 24), nine Epforo (8 124), vedo ehépaveos
LE GENITIF 63
celui que l’on observe: dans le tour du type t¢ Tyreudyoto, se trouve
concurrencé par un tour plus ancien qui consiste dans l'emploi
d'un adjectif dérivé, surtout lorsqu’il s’agit de personnes (cf. § 17).
11. Comme Padjectif, le génitif adnominal peut servir de prédicat :
% 460 “Extoposg Se yu © 109 marpbs 8° ely’ dyadoio (ce cas
touche au génitif-ablatif d’origine) ; etc.
ILL. Le génitif se trouve avec des adjectifs dont la signification
répond a celle des verbes étudiés ; §§ 62 sqq. : A 244 évavelor Ayatdy 5
— 8 819 dvBpéiv mretog Shug; — a 165-dgverdrepor ypvavio; — B 434
emarepéng olvoro; — & 113 otvov evirhetov (cf. 8 319); — E 388 katos
monéoto ; — 8 221 xaxdiv enlayov émdvrwv ; — v 379 Epyov | Eunarov's
— '¥ 885 Bodc dEtoy; etc... — Avec un génitif possessif : O £93 Euvh
mévrov ; — % 922 lpdv *AGqvatng ; — v 104 Ipbv Nupodav.
IV. Lvemploi dun génitif déterminant un adverbe, largement ré-
pandu en attique, est déja attesté chez Homére : B 131 &do0e yalng 5
ete...
GENITIF-ABLATIF
§ 78. L’ablatif indo-européen indiquait le point de départ, la
séparation. Le génitif grec continue bien Pablatif indo-européen en
cette fonction.
Aprés des verbes signifiant « s’éloigner de, s’écarter de » : O 655
ved... dxcpnoav (cf. M 406, It 629); — A 504 ydfoveo xeraidov (of.
M 262); — © 138 nérw rpdmed’ vlog toto; — a 18 (ob) nequypevos Kev
4é00v 5 — E 348 clue, Aids Obyarrep, mokduou xan Syrorijrog.
Avec des verbes transitifs : E 456 otx &v 8) réva" dvSpe wdyns Epboara
«ne pourrais-tu écarter du combat...? »; — M 449 oire... Aavaol Auxtoug
eBivavto | telcos BY doaadar; —o 8 dudnero ole Sbzoo « chassait de sa
maison » (opposer © 602) ; — E 126 unde p’ Epuxe udyne ; — Y 438 sqq.
wail 26 y? AOhyn | maui "AyuASjoc médw Expame ; — A 130 Bre whee naidde
&pyy yviav; — noter lexpression de 3 380 nedéix xal ESyaev xedei0ov
« m’entrave et m’enchaine pour m’arréter sur ma route ».
Ce génitif-ablatif s’observe aprés des verbes munis de préverbes :
B 310 Bwpot sratkas « jaillissant de dessous un autel »; — E 585
tenese Biggov ; — E 109 xara6hoeo Sippov; — P 480 trmov dnobhaoua 5
— YT 125 Odxbyxot0 xarhAOopev; — ¢ 81 mapémray%ev 58 Kubjeav « m’a
écarté du détroit de Cythére ».
Le verbe composé ne peut pas toujours étre considéré comme le
verbe simple suivi de la préposition : en A 359 dvé8v nods dds ne
pourrait pas étre remplacé par *83u dvd modtiig dds.
Emploi du génitif-ablatif avec les verbes qui expriment T'idée de
{(p 7)5 de méme dair’ ayabty xperdy ce xak ofvov (0 507) et, pour exprimer ie contenu,
miGar otvaro maaatod (6 340).
64 CHAPITRE VI
« écarter un mal de »: x 288 xparic ddd dena xaxdv Hap ; — O 731 Tetiag
&uuve vediv « i] écartait les Troyens des nefs » (pour certains emplois
du génitif avec dytvew ou duivecbar, voir § 67). — Avec l’accusatif
de la personne protégée ou libérée et le génitif de la chose : ¢ 397 tév
ye Geol xoxdm70¢ Hhusav « les dieux ont tiré du danger ».
L'idée de « priver de, étre privé de, manquer de » comporte un com-
plément au génitif qui doit représenter un ancien ablatif : ¢ 192 ods"
ad to%jrog Sevfioen ; — E100 eueto 38 d¥oev... « et il ne m’a pas trouvé
1a pour... »; —v 262 repeat rij Anidog ; — ¢ 153 xexadijoe: | Oupod « pri-
vera de vie »; — 7 48 dedv yaréous' &vOpwrot « les hommes ont besoin des
dieux »; — « 195 Shdrrouc. xehaibov « l'écartent du chemin »; — x 4
younddy, gaxtev ; — X 5B aldrvos dpep8ie; — t 42 drepBspevoc tong... (ef.
W 445). Sur xeypquévos, qui pourrait étre cité ici, voir § 64.
Remarque. — Pour certains de ces verbes, l’ablatif est proche du géni-
tif qui s’emploie avec des verbes de sens contraire : &uaprdvew que
nous avons classé avec tuyydverv, pourrait également étre classé ici.
§ 79. Les verbes exprimant l'idée de « prendre, recevoir de, enle-
ver » sont suivis d’un génitif représentant un ancien ablatif : A 596
runddg eEaro yerph xbmeArov; —E 124 mapeutav... Sdxov duopkauevyy ; —
Y 305 niBwy Aebecero olvos ; — 8 746 eyed 3° Ereto weve Spxov.
Les verbes exprimant l’idée de « cesser, faire cesser » et des idées
analogues sont suivis d’un génitif-ablatif : P 422 yijmea tig epwettw moré-
pow ; — P84 dsyovr0 wayne (cf. E 129); — B 275 doy’ dyopdov ; — 1 277
xegiSoluny | obte oe5 086” étdpwy ; — A 382 dvémveveay xaxért0¢ ; — B 595
adoav dowdijg; — Z 107 r#¥ow 88 pévo1o; — A351 nodtuowo uebduev,
etc...
Avec les verbes de sens opposé qui expriment l’idée de « commen-
cer », le cas employé peut étre soit le génitif partitif, qui peut expri-
mer lidée de début, soit un ablatif d’origine : 1 97 év oot pév AnEo, ocd
8 dpFowar ; — A 335 kpEeov rodtuoro (ef. encore x 63, etc...); — oppo-
ser € 237 jpye 3° ddoto « elle marchait en téte » et @ 107 heye 82 th abzhy
43dv « elle lui montrait le chemin ».
Avec ytyvectar : © 89 ric 58 3bca yevduecba ; — E 637 Ards éBeyévovro,
Pablatif (cf. lat. Gnaiuod patre natus) s’est confondu avec le génitif
(cf. § 69).
§ 80. C’est également le sens de séparation du génitif-ablatif qui
rend compte de son emploi avec les verbes signifiant « étre derriére,
étre inférieur » ou« dépasser, !emporter sur» : ¥ 522 récaov 3) Mevéhaog
&utjrovos "AvttAdyowo Aetmeto « c'est a pareille distance que Ménélas se
trouve suivre Antiloque » (ci. + 448); —- le verbe dasoua: peut étre
suivi d’un génitif désignant une personne : VY 484 idx te mévea | debeat
LE GENITIF 65
*Apyelwv; ou d’un nom désignant « la bataille » : P 142 payne dex
moddov édeveo (cf. N 310, ¥ 670); en Q 385 ob psy yap we udyns enéBever”
*Ayatév « au combat, il n’était en rien inférieur aux Achéens », il
semble que ptyn¢ dépende de énedetero, et "Ayatdsv de udyng!; —o 248
mepleaar yovarxdv; — A 51 pédv 8% uéy’ inmov... (concurrence de l’ac-
cusatif, cf. ® 262, etc...); — Z 460 6 dpocebeaxe pdyeota | Toduv
{ici le génitif peut étre proche du partitif); — de méme Q 546 iv...
xexdoGa. (mais y 282, l’accusatif avec Exatvuso).
§ 81. Il existe un génitif de cause qui doit reposer sur un génitif-
ablatif, mais qui se trouve en contact avec le génitif partitit employé
avec les verbes du type ééyc. Ce contact avec \es verbes de sentiment
apparait dans des exemples comme © 125 dyvipevég nep &raipov, ott le
génitif exprime 4 la fois la participation et l’origine; — de méme
B 694 sic... dydeov; — + 159 doyordg d8 nduc Blorov xatedévrwv ; — @ 250
otc yduov toosatiroy 685pozar; — X 169 gudv 8° drogiperm Trop | “Exzopos.
De méme pour Jes verbes signifiant « étre en colére », etc... : A 703
edey xeyarapevos ABE xal Keyav; — A 429 yodpevov nak Goudy... yo-
vaixés ; — E 178 tpav unvicas ; — A 168 rijed" dmdeng xorkuv.
C’est au méme type d’emploi que se rattache le génitif de Ja faute
avec les verbes signifiant « chatier, blamer », etc... : P 366 4 7 égdunv
stoxatar “AXtEnvBpov xaxdmycog ; — A 65 ef cup 8 7’ edywrtig emysduperan 48”
dxurdu6ne (of. B 225).
Le génitif marquant le point de départ a pu exceptionnellement
servir 4 exprimer le complément du verbe passif (cf. Meillet-Vendryes,
Traité?. .., § 835). Ce tour, bien attesté dans la tragédie attique, semble
se trouver dans un chant de l’Odyssée qui ne doit pas étre trés ancien :
8 499 8 8 dpyunlels Oc0d Kpyero gaive 8° dord}v « sous V’élan du dieu, il
prélude et tisse son chant »; mais on a parfois tenté de rattacher
le génitif A gexero (cf. l’édition Stanford). Sur ce tour, voir encore
875.
§ 82, Noter Vemploi d’un génitif-ablatif d’origine avec le verbe
Aeaeatu pour indiquer la personne au nom de qui I’on supplie : 6 68
Aocouor hytv Znvi¢ ’Oduurlov H8t O€uiorog; ce tour voisinait dans Ia
conscience linguistique avec celui de“Accous, suivi du génitif du nom
de Ja partie du corps que I’on touchait (yobvay, etc...), cf. § 63. D’ot
une expression comme X 345 py ue... youvey youvdteo undt toxqev « ne
me supplie ni par mes genoux, ni par mes parents? »,
C'est encore a ce type de génitif qwil faut rattacher l’emploi du
1. Cf, M 277, etc... ; voir la note de l’édition Leaf, et Simenschy, £a construction
du verbe..., p. 16.
2. Voir Manu Leumann, Homerische Warter, p. 189.
66 CHAPITRE Vi, — LE GENITIF
geénitif aprés une exclamation, dont l’Odyssée fournit un exemple
(mais qui se développera plus tard) : » 209 dor... O3ueyjoc.
§ 83. Un génitif-ablatif se trouve aprés les adjectifs dont le sens
répond aux verbes que nous avons envisagés : e 443 detog metpdav
« lisse de pierres » ; —~ T 163 dxpnvog clrow « a jeun » (pour cet exemple,
ef. aussi le génitif employé avec un verbe comme néaacba, etc...,
§ 62); — Padjectif émBevis est suivi d'un génitif Bing en 9 185 rondv
8 Btyg emBevées Faav et. en p 253 Bing exwevdes eludy | dveeOdov "OSvazjos, ot
*O8uoqoc est complément de Bins.
Méme emploi avec des adverbes comme dvevOe, ardvevle, dxtéc, tee
tolev, dugls etc... (cf. le chapitre des prépositions).
Remarque. — Pour le complément du comparatif, voir § 224; pour le
génitif absolu, § 472.
CHAPITRE VII
LE DATIF
§ 84. Le datif gree est issu de la contamination de trois cas : le datif
proprement dit, Pinstrumental comitatif et le locatif?.
Le DATIF PROPREMENT DIT
§ 85. Le datif proprement dit, comme son nom l’indique en grec
méme, est associé A l'idée de donner et s’emploie essentiellement en
parlant d’une personne. I] est également associé A l'idée opposée et
symétrique de retirer, dter. I] sert avec les verbes qui expriment les
idées complémentaires de ressembler et différer, commander et. obéir.
Jl s’est prété a indiquer Ja destination, ce qui lui a permis (sans parler
de la confusion avec le locatif) de servir pour certains compléments
de lieu. Enfin, il a connu un emploi trés libre pour exprimer l’intérét.
ou la possession. Le nombre des exemples ow Je datif désigne la per-
sonne a qui l’on offre et l’on donne (avec Sidaut, etc...) est tres grand :
A 3 quyds “Adi xpolabev; — A 18 dyiv pay Geo Boiev... duntpom ; —
A 72 pavroatvny chy of mépe.,. AndXav; — A118 duct yépag abtig? évor-
pdoore; — A127 chy8e Geis mpbeq; — A 353 cushy wep wor... BryuarlEa ;
— A 390 dyova 8% Sapa Svan ; — A 572 pnzpl ply ent Hoa pépew 3 —
2 634 wh wor Topyetny xepodiiv... réuberev dyauh Tepoepéverc.
De méme avec les verbes signifiant « sacrifier » : & 446 dpypate Oise
Oevts ; — A 444 Dolby... ExarduByv | dba; — A 315 epBav P "Arden
reantoous Exaripbag; etc...
Avec les verbes de sens contraire signifiant enlever, dter, dont cer-
tains admettent l’accusatif ou le génitif (ef. §§ 52 et 79) : «9 abtdp 6
1. Schwyzer-Debrunner, p. 137, et la bibliographie citée, notamment C. Guenther,
De genuint quem wocant dativi usu Homerico, Halle, 1884 ; J. B. Bulendt, Drei home-
rische Abhandlungen, Leipzig, 1864, p. 37 sqq.; C. Capelle, Dativi localis quae sit vis
aique usus in Homeri carminibus, Hanovre, 1864; J. Nahrhaft, Uber den Gebrauch
des lokalen Datios bei Homer, Vienne, 1867; H. Lehmann, Zur Lehre com Lokatie bei
Homer, Neustettin, 1870; B. Walther, De dativi instrumentalis usu homerico, Bres-
Jou, 1874; W. Havers, Untersuchungen zur Syntax der indogerinanischen Sprachen,
Veidelberg, 1931.
68 CHAPITRE Vit
rolaw dgetiero worypow Fuap (ef. 7 369); — Z 234 Prats Kpovldng ope
vag &dero Zetg: — P 236 nortcow én’ ace Bopdy damipa (cf. + 192, v 132,
ete...); — A 161 xad 84 por yepac abrhs dpmphceation dmedeic. Le datif
exprime mieux que Paccusatif ou le génitif Pintérét de la personne
que l’on prive de quelque chose.
Remarque. — En cette fonction, le dati gui exprime l'attribution peut
se Tapporter & un nom : B 186 sé ofxtp SHpov; — T 268 Béaw tyObeu.
§ 86. Avec certains verbes de mouvement qui expriment particu-
ligrement la destination, la langue épique emploie plus librement
que la prose un datif de destination : E 174 Au xeipac dvaoyay (of.
LT 318, Z 301, + 294); — H 130 dbovdroun gidrag dvi xetpag dete ; —
A 523 xetpe ptrors Erdporor merdcoxs ; — 257 yetpag euol dptyovtas (op-
poser O 371, et, pour dpéyopo, cf. §§ 55 et 64); — E 294 Oxadecy Broa
Ayasods ; — A 88 sqq. of 116... Gol... Bapelag yetpag emoloe ; —~ A 567 bre
xeév toe ddrerong xetpag agela; — A 51 adbroter Pédog exemeuxts eprelg ; —
A 593 otixe’ Gporor xAalvavess ; — H 218 npoxadtocaro ydouy « il Pa défié
(appelé) au combat »; — © 394 Geodg spud Euvedodvers (cf. A 8, TY 66).
Apres des verbes intransitifs : « 374 mpavig 6A xinnece; — Y 94
bre Boualy empudev tueréenar. — Lorsque le complément est une per-
sonne, le sens est proche de celui d’intérét : « 452 sqq. éonépros &
*Odveq. xal vide dto¢ bpopbsc | Haver; — M 200 dpvig ydp agw enqrde ;
etc...
Notamment avec les verbes signifiant « apptocher » ou « s’appro-
cher », ete... B 744 AlOtxcoo: néaxcoev « les a poussés vers les Ethices »;
— 2 154 *Ayay, merdoon ; — avec un complément de lieu : @ 277
akvras,,, mérace yo; — FY 719 oWSa te meddaoa; — y 291 tas wey
Kphtn tnéracoey (cf. & 315, 0 482); — & 350 enéracon Oardcan | otiOos ;
— a propos d’un objet, d’une partie du corps : A 434 totdv 8 loroSéxn
roocay; — A 123 vevphy uty yale néracav »—- au figuré E 766 xaxfjc
E8bvpct meAdtew. — Avec des verbes intransitifs : ¥ 368 yOovt mlavaro
(opposer T 92 sqq.j ; — © 438 mayro yOovt (cf. E 468); — p 108 oxo-
rbd meranuévos ; — A 449 donides,.. | Exdyve darjaqa « les boucliers se
heurtent »;— M 112 réducev viecot Oofot « il s’appreche des vaisseaux
rapides ».
Verbes signifiant « aller au-devant de, rencontrer » : H 423 of ¥
Hyreoy ddatoiaw 5 — Z 399 4 of Enert” Hvrqse; — Z127 eu wdrver dv-
ztdaor; — o 147 und dviukostac exetve, Le datif se trouve en concur-
rence avec le génitif (cf. § 63). De méme : A 416 pdve dvdpGv dvreddan-
sas (cf. H 113 sqq.,et, sur le génitif, voir § 63); — Y 70 “Hep 8 dvéary
(cf, Y 72).
C'est également & ce groupe que |’on pourrait rattacher le datif
LE DATIE 69
qui suit les verbes signifiant « céder » : Q 716 elfaré yor obpedot SreA0k-
uev (odpeton dépend de etfure et yor est: un datif éthique) ; — & 221 6 ve
por elfere rddecot (uot dépend de etéere et médecnr est un datif instru-
mental) ; — & odté dun génitif-ablatif : A 509 und” etxete ydpung | 'Ap-
yelorg; — a coté d’un accusatif de relation : X 459 +6 8v pévog oddevt
elxav ; — avec un aceusatif complément d’objet : ¥ 337 etgat re of
‘via; — = 332 Wpog Zeqiow elEaoxe Stexerv (rhv vativ). — Avec un com-
plément indiquant le sentiment ou les circonstances auxquelles on
cede : K 122 obt’ Sxve efxwv, oc” dgpadiqar voto 3 — v 143 Bly wok udpret
elxwv; — & 157 nevi etkav 5 — & 262 b6per etfavrec.
Remargue, — Méme syntaxe avec les adverbes.et les adjectifs qui
appartiennent a ce groupe sémantique : ¥ 732 mayalor dAdo 5 —
A 339 sqq. od36 of Inno | Eyyi¢ Hoo npopuyety; — X 453 eye 3h
at xaxby [pripowo téxecow; — P 554 6 ydp pd of eyyiOev fev; —
X 300 dy7i0 por Odvarrog; — + 23 oyeddv dartAnot. — Noter H 20
THB dvsloc, Gow’ "Anddrav ; cf. O 584 (ailleurs le génitit).
§ 87. Les verbes signifiant « guider » ou « commander » appellent
volontiers le datif. Verbes signifiant « guider » : © 134 fipye 8° &pa
apt divak dvBpav "Ayapéuvey ; — Tl 65 dpye 8 Mupuibévecar piorrrodsporay
pdyeotor; of. IF 552, 0407; — B 345 dpyeu’ "Apyeloin; — hyetodan
«conduire » ; X 101 Tpwat..... hyhoxota:; — avec le datif de la per-
sonne et le génitif de la chose : ¥ 134 tyiv iyelobe... dpynSyoto ; — au
sens de « commander » a Ja guerre < E 214 hyeduny Tedeon ; — A 71
vieoo’ Iyyhsar’ "Ayadv (cf. B 687, 864), mais en ce sens plus souvent le
génitif, cf. B 867 et voir § 68; — de méme ‘pour jyepovebo « guider »
(y 386, etc...) ou « commander » en B 816 (nftis le génitif en B 563).
Verbes signifiant, « commander, s’adresser A », ete... : II 372 Aavaotet
xehedov (cf. B50, 151, 1 658) ; — avec un complément de chose a Vac-
cusatif : Z 324 dyprndhovsy mepixkuck epya xéhevev; — Z 66 Néorwp ®
“Apelor dxdcdero; — K 419 xérovren | doavrorg; — E 156 péya Be
Tpdeoow dpdxra; — A 295 drrorow 3% taiir” nictareo; — O 258 inned-
ow inbtpwov... |... thoawdpev dxéas tmoug; — I’ 296 ebyovro Oevig; —
A 289 n&ot 38 onualver (mais le génitif 5 85, of. § 68).
Remarques. — I. Kedcverv se trouve également avec le complément
de personne & l’accusatif : cf. 5 274, 6 350, ett... {voir § 52}.
1k. Pour les verbes signifiant « régner », dvécoenv, ete..., of. § 141.
III, Avec les verbes « dire » ou de sens voisin, le datif employé
pour désigner les personnes & qui on parle ou parmi lesquelles on.
parle peut reposer sur un ancien datif ou un ancien Jocatif. I] pour-
rait s’agir d’un datif dans des tours comme Q 728 cfjow 8° *AvBpo-
wdyn Aeuxddevog Fpye yoow ou e 202 rolg Apa widav Hoye Kadvided of
70 CHAPITRE VII
Calypso va s’exprimer avec bienveillance. Toutefois, Pinterpréta-
tion Ja plus générale de ces tours doit atre celle d’un ancien locatif
(ef. § 114).
§ 88. Les verbes signifiant « avoir confiance, obéir, écouter », etc...,
peuvent étre suivis du datif : 7 98 olct mep dvi | uzpvanévorsr méxove ;
— t 107 Oevicr meroOdrec. — Méme syntaxe avec les verbes dxovew,
xabew. Cet usage s’observe surtout pour les pronoms enclitiques po,
oot, of, dont on a pensé qu’originellement ils ont pu servir 4 la fois
de génitif et de datif. D’ou les formules fréquentes du type xAs0t por
(E 115, K 278, ¢ 324); »airé por (C 239); mais la variante ev figure
généralement dans la tradition (cf. A 37, 451, 8 762) ; — 8 767 ck 3¢
ol Bovey dpiig; — I BBA Sree of doe Frovse peyas Oedg edEaévoro : on note
Pemploi du génitif ed8opévoto aprés of, ce qui s’explique par le carac-
tere paratactique du style ; enfin, avec d’autres datifs que celui
du pronom personnel : © 335 Boaves 6 x” 266q08a ; — TL 515 Sbvaco at
ob mdvtoa" dxotew | dvépe xnBouévp « tu peux en tout lieu préter Poreille
& l'homme en souci »,
§ 89. Datif pour exprimer la notion de ressemblance : II 716 dvépr
eloduevog...; — a 105 eiSopévn Eevee ; — E 604 Bote dvipt dovuds ; —
avec un adjectif : 8 276 é.0te. mare ; — avec une expression abrégée :
P51 xdua yapltesow dpoia « des cheveux pareils 4 ceux des Graces »; —
A 163 od av col mote Ioov Eye yépas. — Dans ces empleis, le datif pro-
prement dit se trouve au contact de l'instrumental : cf. ® 194
ob8t xpetav "Ayeddtos loopapite. « & Zeus ne se compare (avec Zeus ne
peut rivaliser) ni le puissant Achéldos?... ».
§ 90. Notion d’approbation, de bienveillance, d’hostilité : © 312
“Enerope... Exfynaav ; — 9 74 olal FB gpovénor?; — X 264 rank opovéovar
Burunepte dAdiorow ; — a 20 pevéaver | dvelé "Odvo%; — A 9 Bast
ie yokooBetg ; — N 16 Au 88 xparrepiig Eveyéona } — 2 97 xaorywirorg emis
pear; — M 24 del ply mde pot ememdrfooerg; — ¥ 579 mel uw’ of td
aur | ddov émrdhEew (ott pw’ est une élision pour por).
Notion d’ « aider, défendre, étre utile » : A 28 ph vb to ob ypaiauy
axincpov8; — N 633 dvdpeco. yaptten i6piecfjior; — 2 489 Oytevduev
Gp; — B 363 de pphten gotten dehy; ; — T 30 24 yby eyo reiphow
daxew &ypra pore (mais pour le génitif, voir § 78); — Q 19 ré&oav
4, Voir Schwyzer-Debrunner, p. 161, _
2. A73, etc..., dans la formule 6 sow 2 gpovtww dyopyeato zai perderney, il n’est
pas sir que le dalif porte sur 20 gpovdev ; voir Manu Leumann, Zomertsche Worter,
p. 116 sq.
3. En A 566, ror dépend également de xpalcpworv, mais téve’ doit étre un aceu-
satif ; cf. § 36, Remarque f.
LE DATIF nw
demetny &rexe ypot; — le verbe dpiver, a lactif, est volontiers suivi
du datif : A 456 Aavaotaw rorydv duvov; of. 341, 0 525; — Z 262
duivey cotow Epa (cf. E 486, 2 500); opposer Je génitif §§ 67 et 78.
— C'est. 4 ce groupe d’emplois qu’il faudrait rattacher un tour comme
A 2 4 wupi? "Ayouoic dye’ 8Oyxev (mais aussi Vaceusatif, cf. § 52, c).
Le datif accompagne les verbes qui expriment l’idée de « plaire,
convenir », etc... : 3473 Bpedev Odvarég wor &Seiv; — H 45 Bovddy 4 ba
Ocotow epty8ave ; — B 338 olg ofr péder moreufa Boye; — BE 228 pe-
djoovow 8 gol Urno.; — E 520 60 aelew elec AoxHou « Pendroit qu’ils
avaient choisi pour J’aguet »; — K 440 ta way of tr xarabyntotaw tor-
vev | dvBpecaw goptew ; — 1 70 dorxé tor, ob toe derxes.
§ 91, Le datif s’est prété 4 exprimer l’appartenance avec Ja nuance
que quelque chose est 4 Ja disposition de quelqu’un. I] se trouve ainsi
assez proche du génitif exprimant Ja possession : 1 144 xpetc 8€ uot
clo. Osyarpeg; — ¥ 173 eee ro ye avant... wives Foav; — A 188 fn-
dete 8° dyos yéveto; — K 453 Enevta ob mid zor’ doacat Apyelotow ; —
TL 498 aot yap tye xal Enerea xampeln xa BverBog | Kooopar; — Y 209 wh-
mp 84 pol Zac "AppoBtm.
Dans des phrases nominales : + 112 totew 8 ot’ dyopad... otlte 6E-
proreg, — ¢ 366 Otic Euory’ Svopa ; — ® 360 ct wor Epidog xal dowyiic.
§ 92. Une extension trés ancienne de lemploi du datif consiste
dans J‘usage de ce cas pour désigner Ja personne qui est particuliére-
ment intéressée au procés verbal. II se trouve ainsi proche du génitif,
mais comporte une signification moins objective}.
Nombreux exemples de datifs comportant une valeur « possessive » :
A 24 "Hoy 3° odx Bya8e othNog yéaov « Ja poitrine d’Héra ne peut con-
tenir sa colére »; — © 280 r&ow 8 xapal rool xdzmece Oupds « le coeur
a tous leur tombe a terre ».
Ce tour s’observe particuligrement avec les pronoms personnels
atones du type pot, tor, of, etc..., dont on a pensé qu‘ils comportaient
originellement Ja valeur de génitif? : 1 300 &8é ap’ tyxtqaroc yaptdec
dé; — T 338 6 of nardyngw aphpes; — M 174 “Extops yd of Gopdc
eBotreto xidog degfa « c’est A Hector que son cceur voulait offrir la
gloire »; — M 334 &¢ tig of dphy Exdporaww duivar; — | 413 didero yév uot
vooros ; — IT 517 dup 84 wor yelp |... érfrarar ; — T 169 ev 8¢ oE of xpa-
Bin; — VY 489 voxfPnoav dé of immo: (oi est le pronom personnel, non
Particle); — @ 145 pévog 86 of &v gpeat Oye; — X 336 b¢ vor ynbver?
1, Voir Havers, Uniersuchungen..., p. 2 84q., qui appelle ce datif dativus sym-
patheticus.
2. Schwyzer-Debrunner, p. 189; Havers, Untersuchungen..., p. 62; Wackeraagel,
Vorlesungen, 112, p. 77.
72 CHAPITRE Vit
Bvoa; — # 300 4 of morepa xdutov Sera; — 6 50 pnrépr por wvnoriipes
éxéypaov ; — 8 774 & of pdvos vit téruxtat 3 etc...
Avec le datif d’autres mots : B 142 totic: 8 Oupdv evi orhOecow Borve ;
— T 270 Buswretow S8ap ent yetpac Eyevav; — E 493 Skee 8% pobvac
"Bycropt 860g; — E 546 nodteao” dv8pecow svaxta; — K 342 vicoow
tmloxonog huetépyow ; — K 471 evrex 8€ cory | xahd nap’ adtotcr yOovl xé-
ato; — M 428 dee oxpepOevte werdgpeva: yopveadeln ; — N 450 Mivac réxe
Kern enioupov; — P 68 dc sav of tu Oupds... érédua; — P 210 *Kxropr
3 fouose rebye’ eri ypot ; — E 560 Setmvov épidorn ; — T 166 Brdéerar dé
ze yobvar’ vm ; — X 78 0d8° "Exropt Oopav Emeibe ; — 2 603 af mee Sa-
Bexa rai8eg evt weydporsw Sdoveo ; — v 67 sfjor roxijac pty eOicaw Deol; —
9 96 tH 8 kpa Oupd evl ormPecaw &bdner. — Noter plusieurs datifs en
A 11 *Ayauotaw 88 sya oDévos Bu6ar’ Exdorer | xapdtn.
Cette: syntaxe a entrainé des tours ot le génitif est apparemment
en apposition au datif : 1 256 hutv 8 aite xatexddotn plrov Frop | deradv-
rev; —2 75 ofud té yor yedar... | dvBpde Siorhvow (cf. § 469).
§ 93. Le datif d’un pronom atone, surtout de la premiére ou de la
seconde personne, souligne la part qu’un personnage prend, dans ses
sentiments, au procés-verbal. C’est ce que on a appelé le datif
éthique, qui n’est jamais indispensable l’expression de la pensée :
E 249 unde yor ofte | Oive 8d npoudyeov « que je ne te voie pas foncer
ainsi parmi les champions hors des lignes »; — t 42 &¢ wre pot
&reuGdpevog xlor tong « que je ne voie personne s’en aller sans avoir
recu sa part »; — 7 303 ys pot robvex’ dudjova velxee xodpny « ne va
pas, je t’en prie, quereller pour cela cette fille irréprochable »; — a
cété d’un autre datif ; M 334 4¢ tic of &phy srdporaw dpbvar (ol of peut
étre aussi bien un datif « possessif »); — = 504 etréuevat wor Totes
cyaved "Drovfiog | rarel ptt « dites en mon nom au pére de ’illustre
Ilioneus » ; — Q 716 etEaté wor obpetion rerOeuev ; — 8 50 untépt wor uvyo-
tijpes enéypxov obx eeroboq (dans ces deux derniers exemples, le datif
« éthique » est proche du datif « possessif »).
Exemple, avec un datif autre que celui du pronom personnel :
A 250 76 do uév yeveat... ep0tar’ « il a vu passer deux générations »,
Remarque. — Le datif « éthique » to est devenu, on le sait, une parti-
cule : cf. déja N 115 dav’ dxedyeba Sccov’ dxeotal tor ppdveg Eo
OAa@v « hatons-nous de soigner le mal, Je coeur des braves se préte
aux soins ».
§.94. C’est. d’aprés ce type de datif que s’est développé l’emploi du
datif comme complément du verbe passif, d’abord avec l’adjectif
verbal et le parfait : 2 620 morddxputos Sé ror Loar ; — 7 404 rodvdpntoc
BE tol dort; — 0 472 raoior rerysévov; — F138 7H 34 xe vuchoaver ply
LE DATIF 73
xexdhon dmorctc; — N 168 6 of sxodtalngt X¢rerxzo. — Egalement avec des
themes autres que le parfait : A 46 tdwv uot rept xijet tiexero “Tauos tpt 5
— 7,398 tod rep 8} Ovydrnp éye6” “Exrops « sa fille était la femme d’Hec-
tor »; — E 465 xreivecOor tdcete Axdv "Ayatoic; — notamment au
passif du verbe Séuvnut : T 301 ddoyor 8° Kddorer Sapetev; — E 103 Sapev
“Excopt Ste (of. P 429, ete...)-; — X 55 Ayaan Sepacbelg s — © 244 pnd”
ota Tpdecow ta Sdpvacdae "Ayaods; — N 16 Tpaaly dapvapévous, etc...
§ 95. Le datif d’intérét, en général, désigne un objet, ou, le plus
souvent, une personne, au profit (ou au dommage) de qui le proces
se réalise : A 120 rebcaete yap 76 ye mévres 6 por yépac otyera: Edn (le
datif pourrait aussi étre possessif) ; — A 325 76 of xal ptytov Zora: ; —
A 344 Smeg of mapa vavol cor wayéovtan "Ayatol; — A 546 yorerol to
Eoovrar; — H 101 r68e 8 éydv abrd¢ OwphEouat « je vais m’armer pour
combattre contre Ini »; — P 313 ‘Innodéq repiédvtw (cf. P 80); —
W 635 && por avéam ; — W677 Hbpbarog 8¢ of olog dviotero ; ete... (mais
cf. § 86).
Avec des verbes transitifs : A 4 adtodc 8 eidpux tetye xbveor; —
A110 ... opty &enBdrog Adyed tebyer; — A 147 Bop" Fury &xdepyov Ddaceat ;
— A 159 typhy dpviuevor Mevedd « cherchant a obtenir satisfaction
pour Ménélas »; — A 170 sqq. od8¢ 0° dle | ... dgevog xal moiitov
&qbtew (co = aot); — A 283 "AyArg. peOuev ydrov « relache ton cour-
roux a l’égard d’Achille »; — A 309 sqq. é¢ 8 txatéu6ny | Bijoe Beg ; —
A 369 éx 3° Edov "Acpet8y Xpvontda ; — A 447 sqq.-tot 8° dua Oeg xderrhy
éxatéu6ny | telng tornoav ; — A 607 sqq. hye éxdor Sdue... | “Hpaotos
rotnoev; — K 16 rpoderduvoug Brxero yalrac | bY60" dévre Aut « il s’arras
chait les cheveux pour montrer 4 Zeus son désespoir »; — P 547 qice
roppupény “Tw Ovarote: tavieon | Zeic; — 6 88 1 kr pH ddov ind Tpdu0s
®Aa6e yota. — On observe parfois deux datifs qui se trouvent sur des
plans différents : H 314 sqq. toto: 38 Body iépevcev divak dv8pdiv "Ayapén-
voy |... Sneppevés Kpoviovt «en leur nom, Agamemnon sacrifia au fils
de Cronos?... ».
Avec un datif qui ne désigne pas proprement une personne : P 242
duh, neqady mepiBelBia,
Remarque. — Le verbe Sé¢yea0a. est accompagné du datif indiquant
la personne qui offre ’objet pour indiquer que la personne qui offre
Voffre comme une chose due, et ce datif appartient, en définitive,
du point de vue grec, aux datifs d’intérét : O 87 Ofuort 8 xadAurca-
phe | Séeto Sémag « elle accepte la coupe de la jolie Thémis »; — B 186
déEard of oxintpov matpchtov « de ses mains il regoit le sceptre hérédi-
1, D’od, a Pactif, le tour X 176 Fé wey HBq | Merci 'Ayoq: Sapdcooner...
2. Test moins probable que soi: soit un locatif « parmi eux ».
74 CHAPITRE Vii
taire »; — P 207 sqq. 6 roe ob tt pkyng ex voorhaaves | SéEeran “Ave
Spopdyy, wrvté tedyen I yreteowos; -— x 40 dc don quvious of e84ato
yAxeov &yyos. — De méme avec groper: X 119 Testy & od perd-
male yepoiciov Spxov Bray.
Toutefois, le datif peut représenter ici un ancien locatif, comme
Pindiquerait la comparaison du sanskrit (cf. Schwyzer-Debrunner,
p. 169, et la bibliographie citée).
§ 96. Dans certains tours, le datif d’intérét exprime le point de vue,
Ja situation ou le sentiment d’une personne : B 285 ra&ow 2d¢yx0T0v
Oeueven uepdmesor Bporotew ; — ¥ 595 Saiuonw elvar dderode ; — 8 807 ob
av yap tt Oeots durhuevdg don ; — 0479 sq. nicr vip dvOpcroraty Exuydo-
vieraw dovSol | to Zupopol elaw. — Avee un participe exprimant un
sentiment : H 7 d&g dpa td Tpcdecaw tedSopévorcr gavitmy; — & 108 tue
36 nev dopévep ety} — y 228 odm av Eworye | Ermopdve rd ydvoiro ; — 9 145
od xé pou dywoudvey te Byara némva wena | detror,
Notamment pour définir un moment : B 295 fuiv 8 etvarig éotu me~
pixponéay emavtig | evldde unuvéveecn; — OQ 413 Suadenden Bé ol Has
xewév; — + 192 td... evexdry mérev Has | olyouévees — M 374 enet-
youtvorar 8 txovre; — YF 109 puropsvouer dé roiar gdvn sododdueudog ‘has.
— Avec une proposition subordonnée au lieu d’un participe : ® 155
Be 8€ por viv | Hos EWencen, B1 be “Dov elatrovds ; — + 222 sqq. H8y ree
ol Zeixootdy eros éotiv | && ob xeiSev e6n (mais un papyrus donne +63’ pour
ot, voir ’édition Von der Mihll).
Davir INSTRUMENTAL
§ 97. Le cas que I’on appelle l'instrumental, et qui s’est confondu en
grec avec le datif, exprimait soit instrument, soit l’accompagnement
et les circonstances. Autant qu'un instrumental, il peut étre appelé
un comitatif.
§ 98. Datif-comitati{. — Ce cas s’est naturellement émployé avec
des verbes comme durciv, éxeoda, uioyew, etc... Mais il a subi de
bonne heure la concurrence des tours prépositionnels : A 260-261
dpeloaw FE rep fulv | dvSedaw Suinos; — B 24 4S wey pvysriipow outre,
(mais cf. E 86, % 194, o 383); — 1 468 duipnos 36 pn... deryedog duds 5
— TT 154 Ene@? trois s8avdtorn; — 1° 376 xewh 88 cpupdreia dy? o-
nero yetpt mayety ; — A 415 robre way yap xiBos du’ Lherat (noter la pré-
sence de gpa dans les deux derniers exemples, et pour usage de
prépositions, « 278, » 304, & 234); — EB 216 dvepcrue yep wor Smdet
(mais cf. » 165); — 2 123 Dean peuryyévov el8up; — © 437 yly8 ar
Rost Geoir (mais ef. I’ 55, « 379); — Q 335 avipl emuplcon « se faire
le compagnon d’un hormme »; dans ce dernier exemple l'emploi d’un
LE DATIF 75
datif proprement dit serait a la rigueur possible : on apergoit com-
ment les deux cas ont. pu se confondre.
Le cas s’emploie avec les verbes signifiant « combattre, rivaliser »,
pour indiquer la personne contre qui l’on combat, etc... : B 122
rodepttew 488 pdycator | dvBpcor nevporépoiot ; — O 475 pdpvasd te Tpdecar
(mais [ 317 : wer’ dv8phor); — A 277 epitéuever Bacay; — YT 254 ver
xedo’ GAAnot; — 9 188 oly Dalyxes EStoxeov AAHAoro. « le disque avec
lequel les Phéaciens joutaient les uns contre les autres » (le premier
« datif » est instrumental,-le second comitatif); — ® 499 rinxtlCect”
ad6yorat Alog ; — D 225 "Exrog: neipy Over « se mesurer avec Hector »
(mais avec le génitif, cf. § 64); — de méme avec des verbes qui ne
zomportent pas explicitement Vidée de lutte : M 207 néteto mvotific
dvéuovo « il volait aussi vite que les souffles du vent » (ailleurs une
préposition ou un adverbe : peta, 3 148; dua, I 149, « 98).
Remarque. — L’usage du datif exprimant la ressemblance peut, dans
une certaine mesure, continuer cet emploi du comitatif ; cf. § 89.
§ 99. D’une manieére trés libre, ce « comitatif » s’emploie avec toutes
sortes de verbes : M 28 xiuact xéune « i] emmenait sur ses vagues »; —
EZ 506 totaw ene’ Hcoov « ils se dressaient, batons en mains »,; —
. 68 éndipo’ dvepov... | AatAant Oeonesty « i) lance le vent dans un tourbil-
lon divin » ; — 1 82 éwypap gepdyny ddoois dvéuotowy (proche du sens pro-
prement instrumental) ; — & 253 érdgouev Bopéy avéum dxpadt xorg ; —
A 418 xox} lon téxov « pour quel triste destin t’ai-je mis au monde »;
il s’agit, semble-t-il, non d’un datif de destination, mais d’un comitatif
(cf. E 209, X 477).
Un cas qui exprime Paccompagnement, pent aisément servir & dé-
crire : Z 513 tedyes: naugalvwv « resplendissant avec son armure »; —
A 100 ripest rappatvovras; — B 148 tuber dorayvesor « la moisson
s'inclinait avec ses épis »; — c’est la méme syntaxe que l’on,a en
u 243, si on lit odvecxey | Pippo xvavéy « elle laissait apparattre un sable
sombre »; mais la vulgate est xvevén au nominatif « elle apparaissait
rendue sombre par le sable ».
Un tel comitatif se trouve employé a cété d’un comparatif : T 215
véver Gotepog « moins Agé »; — TP 194 edpirepog 8° Suoat « Jes épaules
plus larges »; — o 234 Bly... péptepos; ef. A 404 (ef. aussi § 105).
Exprimant l’accompagnement, le comitatif s'est prété 4 noter une
circonstance, 4 exprimef la maniére : F 2 xdayyij 2 dvorf c toav; —
@ 6 poyed te osowegy ce; — A555 verendee Oopd 5 — 0 BOL nexorgére
Oop. — D’ot un emploi quasi adverbial : A 412 cvwon} hoo; — Z 304
BroruyH... yetpug dvéoyov; — B 209 enesoetovro... | hy; — ¢ 199
gOdrryep enepysuevar ; — % 320 wbp « avec réflexion »; — v 77 xdoug « en
ordre »
v3) CHAPITRE VIL
Cest & ce méme groupe semantique qu’il faudrait rattacher un
comitatif de lieu et de temps qui s’est confondu avec Je locatif. Un
tour comme @ 118 ynvl 8° dp” otto névter nephoauey elpéa mévrov « en
un mois entier... » peut s’interpréter comme un comitatif plutét qu'un
locatif (cf. Debrunner-Schwyzer, p. 163); Aristarque lisait 2v obo.
. Un emploi notable du comitatif sobserve dans des expressions
militaires, ot le complément désigne souvent des tres animés : 2 164
4 vO 3 Toolntey kkdpevos evOds” Ledvers | val ve xal Exéporaw; — 3 8 chy
dip? 8 y° BO" Ernoiat xal Kpyaet néume véeoQa ;*— N 50 péya retyos Smepra-
t6qoxv dui « ils ont franchi en masse notre grand mur »,
§ 100. Le grec a eréé un tour original constitué dun comitatif
associé avec abtéc, qui souligne l’opposition ; ¥ 8 avroic trnow xat
puacw Soaov Vivreq, On a supposé. que derriére vette formule figure
originellement un tour comme adbrol (xzormw (ef. Debrunner-Schwyzer,
p. 164), mais ’hypothése reste incertaine. Autres exemples : @ 24
aith xev yaln dpdoay’ abty te Oxadaon (ici
(cf. encore K 89, II 656). — Avec des composés de peta : B 544; — de
Sn : x 398 ; — de dupl : II 66.
§ 140. Certains emplois du locatif, lorsqu’il suit un verbe impliquant
un mouvement le met en contact avec le datif de destination. Ce fait
est encore illustré par l’emploi de la forme “Aid. Ce doit étre un datif
dans l’expression Sdcew.., “Av&. « donner a Hadés » (E 654, cf. A 445,
TI 625). Ce peut étre un datif de destination ou un locatif dans le tour
“AS. mpolapev « il a jeté A Hadas » (A 3, Z 487, A 55), Enfin, le sens
locatif est net en ¥ 244 “Aid xesGwpat « je m’enfoncerai dans !’Hads »,
_seul passage ob “Aids, désigne un lieu.
§ 111. Le locatif des’ noms de personnes s’observe, au pluriel, dans
quelques expressions : 2, 477 épunpenta Tpdeom « se distinguant parmi
les Troyens »; — 9 266 nitor uty’ EEoyor atmodloim ; — B 483 exmpent’ bv
roddota. xal Eoyov fedsco: « se détachant dans la foule et primant
parmi les héros » (le premier adjectif est suivi de ty, le second du
locatif seul) ; — cf. encore o 227 (avec une variante per’ pour uty’) ; —
© 71 xpdros Eoxe uepatov néaw Kuxrdnesat,
Ce datif-locatif peut parfois se trouver au contact du datif éthique :
B 285 naiaw @rtyyictov Oduevar pepdmeaar Bporotct « aux: yeux de tous les
mortels »; cf. encore A 58 That beds de tlero dhe « était honoré
chez les Troyens comme un dieu aux yeux du peuple » : les deux datifs
semblent jouer le réle de locatifs ; — cf. encore X 119, cité § 95, Re-
marque.
Le datif-locatif de noms de personnes au pluriel s’observe, en par-
ticulier, avec certains verbes: _
49 Des verbes exprimant Pidée de « régner, commander », etc...,
comme xpzttw, dvdccu, Bacdebo, Oeytotebw. Parfois avec des noms de
choses : & 402 &bpacr olaw dvdocor (cf. avec év, IL 572); — « 245
vhsousw érxparéoua, — Avec des noms de personnes : A 231 obrSavoi-
ow dvdccers; — B 669 Geoter xat dvopdroiw dvasae (cf. N 217, ete...) +
— 7 59 Tiydvrecaww Bactreve ; — 2 485 ptya xparters vextiesow ; — 2 569
Geprotedovex véxueow. — Ailleuts, emploi des prépositions év ou pstét,
ef. A 252, 4 62, etc... — Cet emploi du datif-locatif est proche de
celui du datif proprement dit avec jyetaOur, hyspovebo (§ 87).
2° Le datif-locatif a joué un réle important dans les formules intro-
duisant un énoncé, notamment avec Jes verbes signifiant « dire » :
A571 toiaw 8 “Hotierog xrvtordywns Fpy’ &yopedav ; — E 420 rotor 38 pv~
Le DATIF 81
Biv Apye fed yrovydme "Abhyy (cf. © 202, ete...); — Q 729 Haw 9 *Av-
Apoudyn Newetideves Fpys ysao; mais cf. § 95; — A 68 rier 3° dvéory |
Kddyas Geatppling (cf. A 247, ete...).
La valeur de locatif du cas est garantie par les formules constituées
avec la préposition 2v (cf. 1 528, = 45, etc...). Elle est égatement sou-
lignée par Yusage du datif-locatif, lorsque le verbe est composé avec
peta : T 269 dvordc "Apyelon quiontodpows: petnida; —— 5 52 rotor 8”
anorépevos uetepdveev inmta Néotwp ; — A 5B — Il 647- duql pve Takps-
wAov wepuypttav; — 8 154 peyrnuévos dup” OBvoje | pubedyny (cf. « 287,
§ 338, 364, etc...) ; — en particulier pour exprimer objet de Pinquié-
tude, le souci, la.souffrance : I. 157 voifj8? ‘dppl yovarl; — a 48 dup’
"Brat. Satppovr Saletar Frop. - °
_ § 124. La préposition dypl s’observe également avec laccusatif.
Cet accusatif s’explique comme -un accusatif d’extension : B 461
Katorplov éupl dée8px « sur les deux rives du Caystre »; — A 419 dugt
xpntijpx tpandlac te mAnfotoas | xeljieOx « autour du cratére et des
tablés chargées, nous gisions »; —.A 409 duo’ aa « sur le bord de la
mer » (cf. encore, avec mouvement et un compkment de personne,
Z 238). — En impliquant la notion de région : B 499 ot ¢ dup’ “Agu’
évévavto uct Etaéaov xat Epufeds (ef. B 754, ete...).
*Auol s’emploie également & propos du corps on d’une partie du
corps : E 344 aul &° dv elroy vidv zyebato mhyse Aeuxd ; — 0 588 dui 8¢
uty papog Bdaoy (cf. x 365); — Tl 484 80" dpa te pptves Upyatar dug’
ddwdv xiip.
Avec un nom de persome, le compliment désigne ie personage
souvent important que d’autres entourent : 2% 435 of Bproros.| dup”
Alavre 880 ; cf B 445, A 295, I 81,'M 139 — Avec Particle, Pexpres-
sion ot 8 dual Hlayov signifie déja chez Homére « Priam et ses com-
pagnons », cf. I 146; de méme x 281 tol & dup’ "Odvoia « Ulysse et.
ses compagnons », — Notér w 496-497 of 8° dpyvro xat dv rebyeco -
Biovro | téoapes &up” "O8ve%(x) « Ulysse et ses trois compagnons ».
Tl n’est pas sir que le sens figuré de dul avec l’accusatif soit ho-
mérique : £ 339 dupi 8 ot Tpwot xat AzpBavidss BaOtxodmor | — E177 xi-
Em dive oxodénesct ; — & 352 ebbe... dvd Papydpw depp 3 — © 441 ay Bu
potet tide; of. encore O 152, 4 128, 4 275, a 8. Cette syntaxe, qui se re-
trouve exceptionnellement chez Pindare et chez les tragiques, est
ignorée de la prose attique.
Le cas usvellement employé avec 4v& est l’accusatif d’extension.
Il se trouve attesté au sens de « au haut de », avec mouvement :
x 176 ulov’ av’ Sdmary épdaa; — K 466 delpac Gixev dvd wupbeny; —
7 492, etc... dvd 0” dpuara.., Bavov; — x 239 dvd peyepor uéradpov |
Ker? dvathaca ; — E 278 otyodyel &u mbpyoug « prenons position au
haut des remparts »; — If 349 +d 8° dv& ordpa xat xurk pivac | mpfice
«il rend le sang qui monte par la bouche et descend par le nez » (cf.
X 452). Pour dv’ dpcoOspyy, x 132, qui suppose que le mégaron était en
contre-bas, v. Palmer, Tr. Phil. Soc., 1948, p. 103.
Avec l’accusatif d’extension « a travers » : N 547 dvd vita Ofovea
Siaumepte aiyév’ bedver « (la veine) qui, remontant le long du dos... »
méme sans l’idée d’un mouvement, de bas en haut : K’339, etc... 8%
8 do’ 684) + — Z 505 ceborr’ kere’ dvd Hoty... ; — E 87 Give... Ap redtov 3 —
T 305 etoty dv’ “FandSa ; — ¢ 234 gtpav dvd Suara; —T1 456 maysag dvr
“aiag ; — M 333 naxryvev 8° dvd mipyov « il a parcouru le rempart des
yeux », etc... Fréquentes sont les expressions évk dotu, ap nibwv, dud
Scdpata, dv’ 636v, dv’ “EAAdx, avec OU sans mouvement.
° Ava s’émploie de Ja méme fagon, surtout dans |’ [liade, avec des plu-
riels ou des collectifs désignant un rassemblement de personnes avec
ov sans mouvement : A 10, ete... avd orpatdv; — 1 449, ete... a’
Spthov; — E 824, etc... ueyny avi; — K 298 au odvov, dv véxvag « a
travers le carnage, 4 travers les morts »; — avec des termes nette-
ment abstraits : N 239, etc... a mévov ; — O 584 dvd dotiira,
La préposition s’observe avec le substantif 6vpé¢ : B 36, © 4, etc...
dive Oupdv « dans esprit »; — d’ot Pemploi figuré de ava ovépa : B 250
Pacrdijac ave otdy’ tyov « ayant toujours les rois 4 la bouche ».
Remarque. — Un exemple du sens temporel : © 80 dvd vixra « du-
rant Ja nuit ».
Le sens distributif n’est pas homérique et ne figure que dans vn
vers suspect : I 383 Sinxéarot 8° dv’ éxdatac « deux cents par porte ».
§ 130. La préposition? avi, dont l’étymologie indo-européenne est.
assurée par la correspondance de skr. anti, de lat. ante et got. and,
41, Schwyzer-Debrunner, p. 441 sqq., et Bolling, Language, 27 (1951), p. 223-239.
‘e CHAPITRE VII
est apparentée & dvr, dvaved; &c Evra, formes d’accusatif répondant
au locatif &vtt. Elle « se construit » uniquement avec le génitif, un
génitif véritable, plutét qu’un ancien ablatif. Le sens originel en est
«en face de ».
Un fait-remarquable est que l’emploi de évet comme préverbe est
tout a fait exceptionnel chez Homére. On peut. citer dvngépecdar
« s opposer 4 » (A 589, E 704, etc...), avec le dérivé avrigepltw (0 357,
488); pour dvrloyeabe (x 74), évetam (Y 70, 72), dvOletevto, on pour-
rait_lire avr’ (’adverbe &vza élidé) ; en © 163, la tradition hésite entre
yovainds,.. dvrerérubo et yovands... dvel tér£o; enfin, dvmborteo et dvtt-
topéw sont, en fait, des dénominatifs de *dvtiGorog et de *dvtitopoc 1.
Dans l'emploi prépositionnel, le sens originel de « en face de », net
dans dvripépeatn, dvréom, n’est pas attesté de facgon certaine chez Ho-
mére : en ® 481, la lecon carrecte est dvrl(a)’ dueto ; &v6" (@ 233) et
vr’ (O 415) sont des formes élidées de-divra.
Das I’époque homérique, évzl signifie « équivalent & », Ge sens pro-
venant peut-étre de l'image de la balance of s’équilibrent l'un en. face
de l’autre deux objets : 1146 dvrt w rodddv | dudv éorw avip « ’homme
vaut une foule de guerriers »; — 6 546 dvtl xaoryvitov Eeivéc & ixétys te
Tétxtat « Phéte et le suppliant sont comme des fréres »; — © 75
dvil rol el” beétao « je suis pour toi comme un suppliant »;— © 163
‘yovaixds,.. dvel « comme une femme ».
D’oi le sens de « au lieu de » : O 254 "Beropoc... dirk... mepdobar; —
v 307 dvrt yduoto tkpov « au liéu de noces, des funérailles » (cf. N 447,
= 471). — D’ow « en échange de » : ¥ 650 aot 88 Geol rav8" duet ydow ws
Yoelxea Soiev « puissent les dieux, en échange, taccorder leurs douces
faveurs »; of. x 290,
Les exemples de la préposition évzt sont au nombre de dix chez
Homére.
§ 131. *Ané#, qui correspond au latin ab, au skr. apa, etc..., exprim
Je point de départ, la aéparation, mais sans comporter comme é
Didée de sortie.
“Aro a pu-se trouver au sens fort dans des phrases nominales (cf
Schwyzer-Debrunner, p. 423, 4), mais cet emploi n'est pas attesté chez
Homére. Les exemples ‘oi le « préverbe » est disjoint du verbe sont
asgez nombreux : A146 yetpac dnd Eigpet mrikac dnd 1° adytva das; —
E 466 and 8 dpe xépoe tévovre; — M 195 rede évdpitov én’ Even; —"
B 261 and... etyata thee (cf. E 435, ete...); — IL 545 dm tebye’ Dav-
4, “Avera (2213, p St, 61) doit reposer sur évsiira (Hesychius), mais le verbe
avtitlvw n’apparait que chez Théognis.
2, Schwyzer-Debrunner, p. 444.
PREPOSFFIONS- ET PREVERBES - 93
sau; — IL 82 ptiar 3° dnd voorov Bdovrar; — N 587 amb 8toerdto... bd
2h¢5 — AGT auiv amd rovydv dutiver ; — © 90, etc... dnd Ouuiv Sssoev ; —
T 254 dnd rplxac dpbéuevoc. En'général, éxd exprime dans ces exemples
Yidée de séparation.
La ménte valeur du préverbe s’observe dans les verbes omposés
proprement dits >dmepi « étre loin » (¥ 7, etc...)5 dneyse « s’en aller »
(0 593, etc...}; dplorapan (¥ 517) 5 dxoribnur (TL 254); dmordbeo (L249) ;
drtcoupar (Z 390); dnotéyvw (0-87); dmépyopar « couper pour les pré-
mices » (6 422, cf. T 254) ; — de méme encore : énapiveo (I 597) ; damipa
(Z 17, ete...) ; amociew (I 406,-variante) ; énépwoya (E 105); driogépo
(rm 360); aroysSopm (A 95); etc... — Certains développements se sont
produits : le préverbe a été utilisé pour exprimer D’idée de retour dans
drovostées (A 60) ; droBBept (A 478) ; etc. — Exprimant l’éloignement,
il a pu prendre un sens proche du gens négatif : &nvetrov « j’ai refusé »
(A545, etc...), eb aussi « j’ai renoncé a » (T 35) ; dgav8dver (x 387) y éxo-
xeqdfoavre (¥ 413) « manquer d’ardeur ». — Enfin pour exprimér la réa-
lisation de Yaction, en. particulier avec des verbes signifiant « cesser, _
terminer, mourir », eté..; : dm&yyw (+ 230); drxarOfaeafov (@ 419); dna-
Rode (A 522) ; dnavie ( 326); dnapéoxopar (T 183) ; dwanyder (N 113);
dmevaplteo ; dmeydatpw (I' 415) et dmeyBdvoum. (5 202); dmofpitea ( 151);
dmoeinely « déclarer » (1-809, etc...) ; étoBaipate (f 49); anofvioxa, plus
rare ‘que xatatehoxe (K 432, etc...); dnoxpiata (Z 465); dnoxtelvor
{E 675, etc...}; émodsyo (H 263); drounvin « s’obstiner dans sa ran-"
cane » (B 772); dmorate (A 422); dmdenut (H 362); anctpbieo (0 268,
ef¢...).
§ 132, Le génitif (ablatif) a été volontiers associé a and pour expri-
mer lorigine. La naissance de ce tour se voit dans quelques exemples
ou le génitif se trouve disjoint de la particule : E 416. dr’ tyS yerpdg
bpépyw; — 8 198 Bartew 7 dnd Béxpy ape; — © 50B dnd yards
Spouce | Binuévou; etc..
Avec des verbes qui expriment plus ou moins nettement Vidée' de
séparation, l’emploi de dmd est {réquent : B 208 éneaaevovto veiiy tixa
rat redgov; —.K-B75 vipev dnd ypords ; — A SOB:amd xpntijaes dpte-
cw (mais ef. 1 9); -—-B-838-839 fy ’Aplofnfev gtpov frp: |... mrayod
4nd Eerxhevrog « que, des coursier’’ aménent d’Arisbé, des. bords du
Selldis! » ; — 8.114 Sdacpe 8° dnd Brepdpov.., Bike; — A 580 alvueo exiye’,
” &r? diye ; —IL 304 ga6éovre peradov dm yndv ; — 0 492 dnd TeolnGaw
lyre; — O 386 of pay dg’ trnay, | of 8 dnd vndv... udyovto (cf. « 49); —
11725 ax’ aléwog véog dio; etc... — Avec un verbe signifiant « sus-
1, ‘Toutetois, Schwyzer-Debrunner, p. 446, rapporte le complément a tenet et
comprend « des chevaux issus des rives du Selléis ». :
94 CHAPITRE vil
pendre » ( 278), mais éx est plus fréquent. — En parlant d’une lueur,
dun son : © 244 dnd xeqaaijc... obdag... tkavev; — v 103 dipdvenoev an’
atyAhevroc "Odbumov ; eft... .
*And peut exprimer lidée de « A l’écart de », sans verbe de mouve-
ment : B 292 pévav dmd fc dddyoro ; —~ b 140 xexpuppéva... dex’ Bav 3 —
« 49 gidtav dro mhuxta mioye (cf. encore 0 16). — De méme ¥ 53 an’
dpOadrudv « hors de vue »; — EX 272 én’ obatos... yévorro « puissent de
tele: mots demeurer loin de mes oreilles ». — D’ot, par métaphore :
A 562 dnd Oozod | u@dAov évol Eceat «tu seras plus loin de mon ccour »;
— K 324 dmb 36&q¢ « qui décevra ton attente’»; — A 344 od... dxd
oxonod of8’ dnd 86En¢ «ce n’est pas en manquant le but ni contre notre
attente ».
Remarques. — 1. Pour marquer V’éleignement, éxd s'est volontiers
joint, chez Homére, & des adverbes : ¥ 880, ete... s7jAe &md.,.; E322,
ete... vosgu dnd...; — K 154 dure dnd...
II, Le complément précédé de dnt a pris parfois un sens proche
du sens partitif : « 40 = v 138 Aaydv dad AylBog aloav « obtenant
une part du butin ».
§ 133. La, préposition ax sert a exprimer Porigine de facon assez
souple : x 350 ytyvovra: & dpa tat 7° & te xpnvéwv andr’ daaéov (noter
la variation entre é& et 4xé qui répondent bien respectivement aux
substantifs xphvq et dco); — + 163 0b yap &md Spvdc gam nadarpétov |
088° daxd mézpng (cf. X 126). —- De méme :f 18 Xaptravy dro xddi0g Exousas ;
— C12 Oséiv dsro ufSea elSa¢. — A propos d’un instrument ou d’une
partie du corps : Q 605 én’ dpyuptoro Bute (ef. @ 279); — K 371 eutic
amd yerpéc (cf. A 675); — F714 senplyee 8° Sou véta Opnoctdav dnd
yerpav | Pxdpeva otepedic : dnd yewpdv se rattache A verplyet, non & &-
xéueve, — Avec un substantif abstrait : H 359 = M 233 el & éréov 5h
robrov dxd amovdiic &yopeteic « si c'est bien sérieusement que tu tiens ce
propos », — Le sens temporel de &rd « depuis » est presque inconnu
chez Homére.,Un seul exemple © 54 : dx 8 adrod Owphscovro « aussitét
aprés:le repas ils s’armaient ».
La préposition ¢nd s’est trouvée proche de éx (ef. A 598, cité plus
haut, et : 9). Elles s’observent parfois cdte a céte, cf. plus haut x 350.
Noter ericore @ 2413 scov éx vndv démd nbpyou thepog tepye « du cdté des
nefs, tout espace compris entre le mur et le fossé ». Mais le texte est.
douteux. , ,
_ § 134. La préposition! 3a semble apparentée au nom de nombre
deux : reposant sur *Siax, elle répond a Sic, doublet de *dwis- (cf.
4, Schwyzer-Debrunner, p. 448 sqq., et La bibliographie citée.
PREPOSITIONS ET PREVERBES 95
lat. bis, etc...). Elle exprime |’idée de séparation et est passée de la
notion de « séparer » a celle de « traverser » et, enfin, d’ « aller jusqu’au
bout ». .
Elle n’est pas attestée comme adverbe (cf., toutefois, Sanpé, § 217).
Mais, bien entendu, comme préverbe, elle est souvent s¢parée du verbe
auquel elle se rapporte : + 291 Sid peretati taydv; — N 507 did 8 B-
repa yodxds | Hpvae « le bronze alla puiser dans les. entrailles »; —
9 120 81k shppov opting; —T 729 did re rpboaxv ; — 0 322 ded ve Era...
xekooat; — E 157 84 xrow Saréoveo; — P 522 ba thuy dd... ; pour
A 230, ef. § 119, . .
Le sens de séparation apparait bien dans divers composés : dapéo
(U 359); Staprdteo (IT 355); Stapsoaw (= 450, mais en x 110, idée de
« jusqu’au bout ») ; deépye (M 424) ; Séorqxa « se tenir A part » (© 436) ;
StacxlSvyy: (E 526); dadpirte (I 363); Sixcddw (E 216); dieperpta
(T 315); S:arrotw (6 340); Stapale (u 290); dixoylte (IE 316); Serunyo
(® 3). Dans certains de ces composés, le préverbe marque la sépara-
tion et le verbe la maniére dont se fait la séparation.
Le préverbe s’observe avec les verbes exprimant lidée de destruc-
tion : diadrgouar (E 37); Biaxelpwo (O 8); Barkow (I 46); dveropldw
(B 691) ; 3apBelpa (N 625) ; Bdrv~ (8 64).
Le préverbe convient avec les verbes exprimant lidée d’ « arrange-
ment » : 8axplvw (B 475, ete...) ; dtaxcsuéw (B 476); Siénw (B 207),
Pour exprimer l’idée que Yon distingue, avec les verbes dire, voir, .
etc... : Siayryvdoxw (Y 240); StaelSopar (@ 535); Sadeyouar (A 407);
Bimoxomidopar (K 3B8) ; Bagpdtes (E 9); Bietmov (K 425) ; Betpoyar (A 550) ;
Siefepdopon (K 432) ; Stomredo (K 454). :
Avec des verbes de mouvement, et l’idée de « se frayer un che-
min » : O 83 Bénraro; déyo (E 100); dtadépxopar « voir a travers »
(EB 344); Banphoso (A 483, etc...); Simppimra (7 575); Sacetouae
(B 450); Siarplyo (y 177); Siapalvoun (@ 491); Singopds (¢ 333);
Répyouat (¥ 876) ; SteElweven (Z 393) ; dtorccevdeo (r 578) ; ces composés se
sont prétés a prendre te sens d’achtvement du mouvement, de l’ac-
tion : 8ixvéoper « raconter jusqu’au bout » (I 61); dievie « achever »
(e517); Btarchevrden (T 90) ; Bratplbw « 6eraser » (A 847),
§ 135. Comme préposition, S:% s’est associé avec le génitif et Paccu-
satif. Avec le génitif, 84 signifie « 4 travers ». A travers une arme
défensive ou une partie du corps : I 357 &a pév darldoc Fave... | wad
Buk Odprxoc... Aphpeovo ; — M 183 Sovpt Pdrev Adpacov xuvéng Sd; —
A 481 8Y cou yddxcov Eyyos | FANev; — X 327, x 16, 8 adytvos Hrv8"
dxoxh; — E 41, ete... 8d 88 orAbecpw aooe, — En parlant de portes :
T 263 814 Lxadv redloy.d” Eyov dda trrous.
Quand il s’agit d’un mouvement a travers un espace : E 545 8s 7°
%.. | CHAPITRE VII
goad fder TIvalow Bie yalng; — A 754 Enbyecba did omd$os meBloro; —
1 478 gedyov 8° “Enddd0s; — m 163 Bid crab uote pbéydev; — 0 183.h-
im neSlov 3b Buk mtédwg; — EH 288 8: hbpog aidép’ txavev; — K 185,
. BY Speco ; — A 398 d8ivy BE Sid yoods Habe « une douleur a couru.
at travers 3 son corps »; — x 118 tedye Body Bi& Boreoc 5 — pw 335. Ste vijgou
lay ;.ete..
De ce. gens, on est passé enfin au sens de« au milieu de, parmi » :
Z 226, ete... 8” 62000 « au miliew de la presse »; — I 468 &&.proydc
«au milieu de la flamme ». Avec des compléments au pluriel.;
A 495, ete... Bi Bb Sid mpoudyov; — N 755 Bd 88-Todav néver? # a
tmxotpav, — 1 298 rawoodpevas Bid ph rov ‘Gtendu-parmi les mou-
tons »; — a’ ‘ot M 104 éxpene Seo. Bid ndvrey « il se reconnaiésait entre
tous ». .
- €es emplois se retrouvent dans. le gree postérieur, qui y ajonte t Bh
sens temporel et wn sens causal. ~
§ 4136. Lrusage de Paccusatif avec 3d est & peu pres aussi fréquent
que celui du génitif.
Le sens originel « 4 travers » est bien attests, mais Pemploi de V’adcu-
satif, au lieu du génitif, s’explique par le fait, que extension y est
envisagée : H 247 8 8 8a mubyac 4AGe... yadxdc « le bronze a traversé
Pétendue de six peaux »; — A 600 8:6 Shyam notmwovra ; — A 148 (cf.
YW 122, etc...) Hike dua Spuua.. ++ walk Day; — M 62 8d rappdv Bhadvopey ;
— B 154 tibav Suk @ obdla xat mrdney (of. « 447, X 190); — 4 40 tgi¢buevo
mare Bom Sik apbag; — ¥ B46 méverar 3uk Godc. — Noter 3 94 uilov bv
ob nev... Bid otdpe... &yorre « des paroles. qv(un homme) ne ferait pas
passer ses lévres », ,
D’oa Ie sens de « parmi, au milieu de », sans mouvement : « 400
Gxeov... 3° dxptag «au milieu des falaises »; — A 230 aodtec &id xotge-
véovra (mais cf, § 119) ; — K 375 dpatog ab oe oréya “yiver’ 6Sévrav « au
milieu de sa bouche on‘entend claquer ses dents » i — B 40 8a xpate-
pd Sopting « ay milieu des’ mélées brutales ¥.
‘Ces emplois au sens focal de a a Paccusatit sont ignorés de la prose
ionienne-ettique, et a péu prés propres 4 la langue épique. ~ :
Au sens temporel, seulement avec w«t~, pour exprimer la durée,
dans ’Odyssée et dans Y Iliade, surtout dans. les chants Ket: B57
duBpoatny Sid voxra ; cf. K 44, 142, 0 363, 1 404, o 50; ete...
Cet emploi temporel est également -proprement homérique.
On observe, enfin, un sens causal qui a subsisté en ionien-attique.
‘Avec un complément de personne « grace &.» : 6 520 && peydOvpov
*Ahvny (of. v 124, + 154). .
Avec un complément de chose (volonté, ete... yi O 44.80 duty b6-
"mare; — 0 82 Arde peyddov bd Bouads (cf. K° 497, O-74,.% 276, 437). Et
PREPOSITIONS ET PREVERBES oF
encore : A 72 qv && pavroebvqy; — 2-282 yiuev bv Bid xdadoc ; cf. en-
core : + 523, -67, . t
Ce sens causal, qui a pris une certaine importance en ionien-attique,
n’est attesté chez Homére que dans quelques exemples. ‘
§ 137. La préposition! qui se présente sous la forme éx devant con-
sonne et 2& devant voyelle est.ancienne, ci. lat. ex, etc... La forme
ancienne doit étre 2€, et é est issu de é€ devant une articulation nou-
velle. Ex signifie proprement « hors de », mais se trouve parfois assez
proche de gna « venant de », Si 2€ ne s’emploie pas absolument et ne
seat pas proté A constituer des phrases nominales, |"emploi adverbial
s’observe en X 479 sqq. : mept 8 Gvrvya Bade pacwhy | ... dx & dpydpeov
teopive...«... Uy attache un bavidrier d’argent ».
L'emploi comme préverbe disjoint du verbe est fréquent : A 436
tx & sivas Wadov « ils ont jeté les grappins (hors du vaisseau) »; —
A 438, ate. ;, de 8” txaxbubry Bioav « ils ont fait débarquer Phécatombe
(du vaissequ) »; — E 859, etc... & 88 Sépu ondeey « il a tiré son arme
(bors de le bléssure) »; — N 655, etc... & 8 alua... déev. — Avec les
verbes signifiant « onlever », etc... + 20 é 8 td uijra | eladued’... ; —
doa E 317, etc... & Guzdv Morro « enlever la vie »; — T 27 & 8 ulav
népato. «la vie a été tude ». "Ex, se vidant de son sens concret, s’est
- prété a exprimer l’achévement de l’action : B 164 & aiyéva En (cf.
A475, P 63); — H 360, M 234 2£... ppévag direcuv ; — A 204, 233, ete...
be tor toto ; — A 364, I 398, etc... tnog v Egat’ tv’ dvéuate, dont le
sens originel semble étre « lui parla en Pappelant de tous ses noms »4
A 161 be te vent Spe weret,
Ces significations se retrouvent dans les « composés » ot le préverbe
est goudé au verbe : eget « sortir » (x 374); exéalve (A 107); exgedyo
(p 236) ; derbrerea (O 465); e6drrowar(E 142); ex8iSaur (I 459) ; expeper
(Q 786) ; txyéeo (I 296) ; edyeo (E 353); ex6rpoxa (A 604); exytyvopar
(E637) ; &xBboyme (T 444) 5 &xOpesoneo (I 427) ; éxBdare (E 39) ; &xBéyouee,
(IN 710) ; egedaves (E 324) ; dexadéeo (O 582) ; dquobdes (A 248) ; dendrra -
(¥ 483); txotpége (P 58); derdyva (A 460) ; dxri@nur (p 179) ; etc... —
Avee les verbes signifiant « dire » : ayopeia (A 234); eEetmov (I 61) >
KwvBde (A 363) ; Lovopaives (I 166) ; excyerdea (mw 354) ; Expatve (A 468) ;
Geqnur (x 246).
Le préverbe a pris Je sens de « complétement, jusqu’an bout ». Cet
usage est trés ancien dans un mot comme éxménota: (x 56). De méme
eepéw (& 375); eBepselvw (u 259). Il est ainsi devenu apte a exprimer
le terme du procés : &x6vioxa ( 100); dxxabalpa (B 153); eeddfovro
(IT 602); éxnépbw (A 19); tumdfjoow (Z 225); excadw (A 12); axtertea
1, Schwyzer-Debrunner, p. 461 sq.
98 . CHAPITRE VIII
{I 493) ; dxpOlve (, 163) ; tBarcdopan (A 36) ;8Earade (2 103) ; eEaramd en
{A 40); eenda (© 370); aanaptone (E379) ; aetdov (Y 342); eOive
(O 440) ; eEuevéowor (1 479) ; 266220p1 (p 597); — pour souligner Pidée
verbale ; éayyéxe (E 390) « livrer un secret »; éevploxe (E 322)
«découvrir »; e€olyous (Z 379) ; sooédw « accrottre & Pexcas » (o 18) ;
decade (A 844, eto...) ; evaplto (N 619, Z 30); ete.
Pour l’emploi de éx associé 4 un autre préverbe, ef. § 245.
§ 138. Le génitif, qui peut reposer soit sur le génitif partitif, soit
plutét sur le génitif-ablatif, s’est associé a la préposition é&. Dans
quelques cas ou la préposition se trouve disjointe du substantif, la
construction prépositionnelle n’est pas encore nettement constituée :
A 346 ax 8 dyeryev talng ; — K 140 dx 8° HAVe xrraing, etc...; — E311
éx yap apewy ppdvas efeto : ogewy pourrait étre également complément
déterminatif de ppévac.
Soit au sens de « hors de », soit au sens de « venant de »: A 194
Bxeto 3° &x xodeoio wea: Elpoc; — T 273 dpvav éx xepadgey tdve tplyac ;
— A 269 2x Tivdov en0dy | tyrdbev 26 axing yaine ; — B 557 &e Ladayivos
&yev; — P 207 uayiic ex; — E 409 én0dvr’ éx modduoro « venant de la
bataille »; — E 494 && dygev obv redyecr Xto youdte; — Z 377 %n...
dx peydporo ; — I 142 dpudiv’ &x Oodrduoro ; — 1 344, etc... & yerpdv...
ethero ; — N 529 dx 8 dpa yeupds | ... Bopénce necotca ; — IT 504 éx ypods
Dxe ; — 2 288 otxad" Indaba | Zp &¢ Suopevéav év8pav ; — H 75 debe’ tro
éx mévtev mpbyog txpevar (&x mévewv doit dépendre de trw). — Dans des
" sens plus ou moins dérivés : ¥ 595 éx Gvyod mesdew « me sentir loin de
ton coeur »; — I 343 éx Ovpod elrcov « je l’aimais de tout coeur »; —
B 4A &ypero 3° 26 Smvob.
Remarques. — 1. Dans quelques exemples marquant l’origine, le génitif
est certainement un ancien génitif partitif, lorsqu’il signifie « de
chez »: 6 299 éx... TeradvBporo « de chez Pisandre »; — ¥° 76 vicouat
28 ’AlSao (cf. 1 625, 635, » 17, et voir Pemploi du génitif avec &v
ou etc, § 149).
II. Le complsment peut dépendre d’un substantif : [ 622 éx xdoing
véotow « le retour de la baraque »; — p 231 opére av8pav ex nada-
udev « Jes escabelles venant des mains... ».
§ 139. La préposition éx, marquant |’origine, s’emploie avec des
verbes qui n’expriment pas proprement un mouvement : E 4 8até of
2x 2x6pu0dg Te xal doridog axduatov nip «de son casque et, de son bouclier,
elle faisait jaillir le feu infatigable »; — ¢ 224 && motapod ypu vitero
«il se lavait aux eaux du fleuve ». — Avec des verbes signifiant
« pendre » ou « attacher » : @ 419 ceipiy... 26 odpavdley xpeudoavres ; —
0 67 xd8 8° de maccadspr xpéuacey pbpyryya: deyeiow; — ws 51 de 8° adtod
PREPOSITIONS ET PREVERBES 99
relpar? dvig0e; — E598 payalpas | elyov ypucelug & doyuptay tekaydvav
«ils avaient des épées d’or suspendues A des baudriers en argent », —
Autres verbes oti ’idée de mouvement est impliquée : N 301 & Opfyns
*Eqdpovg utta Qwphaseadov « ils s’arment et partent de Thrace... »; —
EB 153 elacide... dq0arpotar | orto’ 26 Odrsyroo « elle V’apergut de
POlympe ov elle s’était postée » (28 OvdAdurowo porte a la fois sur
eloeide et sur otticx); — 420 wiréGev ex Sgpoto « sans bouger de son
sitge, assis »; — T 76 peréernev... | adrddev 2& Sono « ... sans bouger
de son siége, assis »; — T 375 dr’ dy &e movrow cbhag vabryor gavin
« lorsque de la mer apparait aux marins une lueur », — Avec le yerbe
elu, pour indiquer le pays d’origine : « 417 Eetvos... & Tdpov éaciv ;
— 0 425 &x pty Lw8Svog woruyadxod etyouon elvan.
Dans la langue épique, é« signifie parfois « 4 Pécart de » : & 130
abrot yey exdbucba Sytotijrog | éx Bedtwy « tenons-nous loin du carnage
(Snuorhitog « dépend » de eydyeda, of. § 79), & Vabri des traits », —
TI 667 xedatveges alua xdOneov | erOdv 2x Bektwv LaprySove « va, lave sur
Sarpédon le sang noir, 4 l’abri des traits » (éx Beddwv ne « dépend » pas
de é0cv, mais de xd0npov); —— + 7 bx xunved xaréBnxa « je les ai mis a
Vabri de la fumée »; — 0 272 olite ror xal éydv éx natpl8og « moi aussi
je suis loin de ma patrie »; — © 209-2410 xplvavra "Apr | kateag bx
ogerépov « combattent loin de leur patrie », Pour distinguer quelqu’un
ou quelque chose d’un ensemble, é s’associe avec un génitif (qui
pourrait étre partitif) : O 680 éx morgav micupac « quatre sur un grand
nombre »; — & 434 tol & nastay « 4 moi entre toutes »; — A 96 &
ndvrov 88 pddrota "AreEdv8oe Bactrfit.
Sens temporel de é& « depuis » : « 188, etc... 2 dpyie « depuis le
début »; — B 86 éx vedryroc... xal &¢ yijeag; — Q 535 ex yeveriig; —
& toto (A 493, O 31) ; — éx rod (O 296, etc...) ; — g& 05 « depuis que »
(a 188, ete...). — En p 286 éx vuxtiov 3° dvepor... yiyvovrat, le sens est « A
ja suite de la venue de la nuit ». .
’Ex a pris dés l’époque homérique le sens d’origine : 11 364-365 én’
Odasyrov vépos Epyetat.,. | alBépog ex Bing « une nude issue de l’éther
divin monte de ’Olympe! »; — T 290 Béyerar xaxdv éx xax08 « un mal-
heur succéde a un malheur ». — Pour exprimer la naissance : 2 206
bx 108 gnu yevdatar ; — 896 bx yap duet rig goat; — T 105 atuaros 2&
dyed elon (le génitif aluaroc est précisé par a gues); — T 111 ofc & at-
wards elor yevéOays est paralléle et 26 porte sur yevébAng.
§ 140. Avec un nom de personne qui désigne l’auteur : A 63 dvap
& Ards Eorw « le songe vient de Zeus » (cf, B 197, « 33); — m 447
Odvarov... Ex ye uvyeripov; — a 40 &x yap ‘Optarao tloig tooerm; ef.
4, Sur cette phrase, of. Pédition Leaf, t. II, appendice H.
400 CHAPITRE VIII
X 280, 2 617; — et avec xetpec, «512 yerpdv 2E *OBucios duaprhceobar
dronic.
Avec un passif, le complément précédé de éx équivaut, en défini-
tive, & un complément d’agent : B 32, 69 xfhde’ epimta | ex Arde (cf.
® 543); — B75 terérearar | &x Aids; — B 669 eplrnfer | de Audg; —
noter 7 69-70 tertuntal te, xat Kor, | kx te play nalSav... — Avec le
verbe nécyw : 8 134 ex yep tot marpbs xaxd metcoua; — avec erry :
E 384 morol yap 3) thier... | 2 dvdedv (cf. encore E 652, ¢ 197, 2 346).
Cette syntaxe, que l’on observe chez Hérodote et les tragiques, n’a
pas subsisté en prose attique.
Avec un complément qui exprime la cause : H 114 yn” 86cr’ 26 kp.
Bog ced duelvove peott wdyenton ; — 1 566 2 dpdov puntos xexodoudvos 3 —
135 phos 8 Bdotlg; — 0 197 bx narkpov pudsrnros (ef. « 388).
°Ex a fourni 4 l’attique des périphrases de valeur adverbiale : un
tel tour s’observe en Q 352 2£ dyyysddoro « de prés ».
§ 444. Le grec a hérité de l’indo-européen une partictile? & ou dt
(cf. lat. in, ete...), qui signifie « & l’intérieur de ». Certains dialectes
(arcadien, cypriote, thessalien, béotien, grec du Nord-Ouest, éléen),
Vemploient, qu’il s’agisse d’un mouvement dirigé (avec l’accusatif) ou
non. Les autres dialectes ont distingué une préposition de ’immobilité
4 (avec le datif locatif) et une préposition du mouvement dirigé év<,
els. Toutefois, méme dans le domaine de vg, subsistent des restes de
Yemploi de é avec mouvement, soit dans la composition : Homére
efaploie a la fois vara (O 320) et eg dna (T’ 158, O 147, ete...), noter
aussi év8éEw (A 597, etc...); — soit dans l'usage du préverbe (cf. plus
loin, § 142). .
*Ey, sous la forme &, se trouve dans des phrases nominales : Y 248
modes 3° ty u5O0r « et il s’y trouve des propos de toutes sortes »; cf.
5 141, 216, 2 53, et voir § 3.
Le sens adverbial est également bien attesté pour év employé sans
verbe : E 740 év 8 &puc, év 8° dduch, ev 88... box ; — o 136 bv 8b Av; —
132 &v pedv yap Aewmdves, etc...
Dans une phrase verbale : 1154 &y 8 dv8peq vaiouss ; — I 359 sqq.
Shean... | vag Bude, bv 8 dvBpuc epecotuevar pepndsrag; — t 292 ey BE
xphyy vd; —e 118 & 8 alyes... yeydaow ; — v 244 sq, ev udy ydp ol aitog
abbapares, bv BE te ols | ylvetar, puis v 247 &y 8 dpBuol &aryetavel maphaas 5
— © 535 év 8 prc, dy 88 xvdousd¢ dulrcov, év 8 bron xhp. Avec des verbes
impliquant un mouvement : I 207 & 8 &pa varov tOyx’... | bv 88 avd¢
audaowo Baye; — E730 ay 8 Ménadver | .., Bbadev ; — 0 326 av dp "Anda
reow | ee pé6ov ; —¥ 347 bv 8 dp? GSap Eyeav.
4. La fin du vers 69 est peut-stre gatées cf. l’édition Von der Mihil.
2. Voir Schwyzer-Debrunner, p. 454.
PREPOSITIONS ET PREVERBES 40
§ 142. Lorsqu‘un datif se trouve employé auprés du verbe, il arrive
souvent qu’il ne « dépende » pas de la préposition : © 335 Tpdecaw ev
*Onbumog usvog dpaev; — 8 761, ete... ev 8 Ler’ odroybrac xoveep ; —
Th 276 by B Eneaoy Tpdston,
Il peut y avoir deux datifs, l'un locatif, Pautre d’intérét, dont au-
cun ne doit étre mis en rapport direct avec év : A 188 év &€ of Frop | oth-
Geom... wepurprier; — E A0 npdta yao orpeofévn (datif d’intérdt) were
eptvp tv Sépu wiEev. L’indépendance de chaque élément apparait bien
dans ces constructions,
Les emplois comme préverbe associé a un verbe apparaissent déja
bien chez Homére : avec des verbes d’immobilité Ae: (B 490); tu-
Guotdedw (0 443) ; éyyeydam (Z 493, etc...) ; Euan (8 272) ; Enabw (0 557),
etc... Avec des verbes qui impliquent un mouvement : éyxararlOnus
(249); evelOnus (@ 124, ete...) 5 entdwo (F141); eubelveo (B 619); eu-
6érrw (B 258); evdbva (B 42); evOp@oxw (@ 233); Evy (B 134); ép-
mlrhyue (t 242) ; gurtrtw (A 217) ; ete...
§ 143. Les exemples de la préposition év avec le datif (locatif) sans
mouvement sont innombrables : X 404 év narpt& -yatn ; — « 237, etc...
Tpdwv bt Bie ; — B 340 ev mpl... yevolaro; — a 50 viow by anorpten 5
— Z 221 ev despac’ ductow; — A 777 wt mpobdpo « dans lentrée »;
— « 51, etc... dropiluny vt révtq ; —~ M 16 év vyvol « dans leurs nefs »;
— X 426 bv yepaiv tufjaw « dans mes bras »; — 4 287 éy poor... o-
Bov ; — O 192 obpavdy edpby ev albépr xal vepéAnot ; — m 331 evi Oops ; —
n 218 br peat,
Au sens local, év s’emploie assez librement sans signifier avec pré-
cision « au milieu de » : © 524, ¢ 466 év moray « gur les bords d’un
fleuve »; — © 463 vevphy év dpipow r6E@ | sfEe; — 1 205 dc 8 yedv...
by... Speco 5 — B 456 oilpeos év xogugiic ; etc...
La préposition s’emploie avec des noms de pays : & 275 év Atyinze ;
— ou avec des noms de cités : A 252 2y Ilda@ « A Pylos »; — B 549
dy *ABhyys « A Athdnes » ; — év Teoty signifie soit « en Troade » (B 162,
etc...), 8oit, parfois, « A Troie » (N 433), cf.-4 459, 460, TF 244, ete...
Un emploi fréquent est la construction de év avec un pluriel dési-
gnant des personnes au sens de « au nombre de, parmi »: A 109 &
Aavaotat... &yopeterg; — I 34 év mpoudyoust pavévex; — H 384 onic &v
pésco.aw ; — 2 383 Ev vextesor paeivw ; — A 398, eto... &y dBordrorew, —
Avec le verbe &pyew : N 689 év 3° dpa rotaw | Fpy’... MeveoBets «eb A
leur téte marchait Menesthée »; — avec dvécow : n 62 &¢ év PalnEw
Syaaoe (cf. + 140). — Avec des pronoms : [ 121, 528, K 445 dv tyiv
« devant vous » ; — B 194, 378 év na « devant tous »; etc...
*Ey avec le datif s’observe avec des verbes qui impliquent propre-
ment un mouvement : @ 422 xaflifov év Sdypoior Opdvorow ; — A 482
102 CHAPITRE Vit
tv xovinor yauat néve ; —- E588 Badov év xovinas ; —- K 570 vnt 8” vl npuuvs
apa... One; —- A 44, ete... dv yepot HO; — E574 puadeny dv yerot ;
— E 513 &y orffeoot usw Béde; — ¥ 134 &v tebyccow eBuvov; — v 261
dyevey | ev Sénat ypvotm; — ¥ 132 av 8 kav dy Aiggoun ; — IT 258 &
Towsl... bpoveay ; —- F161 v Bovol Gopdv.
§ 144. Au sens de « au pouvoir de » : H 102 vinng melpar’ Eyovrat év
kOavdrorst Scots: « entre les mains des dieux immortels »; —- {1 630
tv yap yepal tédog noAguov ; — noter la formule religieuse traditionnelle :
P 514, ete... Oedv év yosvact xcizar™. Cet emploi de ev s'est développé
en ionien-attique.
Des I’époque homérique, év s'est. prété A exprimer la notion de cir-
constance : A 258 oe clo... Hud evi wroddu@... 79" dv dactl « que ce soit &
la guerre... ov au festin »; — N 314 dyads 38 xal iv aradly bontyg ; —
Y 671 iv névreco’ Epyoicr Sapove « expert en toute besogne »; —~
K 245, 279 tv mivteao: mévoir. —- Avec des substantifs abstraits :
2. 568 ev aryear; — 1 143, 285 tpéperar Barly evt noary; — 1 494 ev wy-
miéy,; — 1 319 év 8 if 2% « dans la méme estime »; — v 23 év neloy
xpadiy weve « Son Cour restait obéissant »; —- 2 237 naparéFoucs ev r-
2éryu; — 8 313 xadedderov gv giddrmm; — 1 230 ev doy 88 « nous
sommes dans |’incertitude »; — T 186, x 54 év polpy « comme il faut »;
— X 61 aloy & dpyadty,; — noter I 378 sho dé piv ev xupdc atop « de
lui je fais cas comme d’un fétu ». Dans I’Jliade, cet emploi s’observe
surtout dans certains chants (en particulier le chant 1).
Certaines expressions fournissent l’amorce de ’emploi instrumen-
tal qui se développera plus tard, mais chez Homeére l’interprétation
locale ost toujours possible : H 429 év 88 mpi mphaowtes ; — E 386 34-
cay xpatepg evi Séoue (cf. u 54, etc...) ; —— noter les expressions avec le
verbe yuir : £° 306 ev dq 9aruotaw Spaabax ; — x 385 bv dpMarpotay SsoOar ;
ete...
Au sens temporel : IT 643, etc... dy év clap (mais ef. I, p. 128);
~ p 176 ev den Betmov trod; — A173, ete... ev voxrds aporyd ; —
. 76 ot’ dv Béper ott’ ev Sxapy-
Remarque. — Sur l'emploi de év avec ie génitif, voir § 149.
§ (45. La préposition éc ou elc siguifie « dans » avee mouvement et
est toujours suivie de l’accusatif. Par rapport 4 év, elle constitue une
innovation, elle joue un réle plus restreint, surtout comme préverbe.
‘Es ne s'est pas prété comme évi a constituer des. phrases nomi-
nales. Comme préverbe séparé du verbe, é¢ s'observe assez rarement :
A 646, 778 éc 8° Hye (of. 8 36) ; — O. 447, 458, 8c 8 &yeye (of. 2577); —
4. Cf. B, Schwyzer, Festschrift Wackernagel, p. 283-293.
PREPOSITIONS ET PREVERBES 103
M 335, © 527 é¢ 8° événoe ; — 2.193 éc 8 Groyov... exakécaarto, etc... Deux
verbes présentent des variantes sur ce point : A 142 é 3° épérac...
dyelpouev, &¢ 8° dxavoubiy | Oelopev (mais Aristarque : bv 3° eperac); —
A 309 ec 8 apérag Expivev... 2¢ 8 sxardudny | Bhoe (mais Aristarque : év
8 tpérac).
Dans la composition du verbe, le préverbe é¢ ou elg est. postérieur
a & et se trouve surtout avec des verbes qui expriment nettement Je
rnouvement : eiodiopar (M 438, IT 558); eladyew (Z 252, x 233, etc...) ;
eloavabatvea (@ 291) ; etoxyetpouar (O 240) ; elocddev (x 83) ; eloerue (0 463) ;
— avec des verbes exprimant une opération des sens : eloxOpéw (I 450) ;
saxobe (@ 97); elovoew (Q. 700) ; eloopdaw (M 312). — Le composé avec
sig se trouve parfois en concurrence avec un composé avec & : elofCoyat
(N 285) ; elotnus (x 470); elofalves (1 103); BeStouar (4° 622); elodppores
(M 462) ; elexéw (@ 610)".
§ 146. Comme préposition, avec le sens local, cic signifie « dans »
avec mouvement, « vers » : B 140, etc... pebywpev... &¢ natptSa yatav ; —
a 284 & Tidnov 2086; — A 366 dyed? éc OF6ny ; — 326 mourijes Eoovran |
do AaxeBalyove ; — ¢ 298 Daufxay tuev és néaw; — y 174 nédayos wtoov
elg Eiouay | teuvew ; — 7 128-Fv 6855 &g Andon ; — Q 204 enfepev.., dvdpbe
&¢ dofadpots ; — noter x 351, etc... cic dade mpoptover... — Pour indi-
quer une distance : ¥ 523 & Sicxoupa AéAetrvo « il était a une por-
tée de disque ».
Le sens de « dans, a l’intérieur de » est parfois net : © 85 Bédoc 8
alg Eyxégadov 83; — KX 12 cig Kory drev; — B 52 narpdc... é¢ olmov...
véesbor; — A 220 a xotdeov doe; — 8 48 & 6’ doupivdoug Bdvtes; —
3 220 cig olvov Rare pdppaxov.
On remarque certaines formules comme @ 115 ets... dpuara Bhrqy« sont
montés dans le char »; — © 287 ele éharqy dvabds « monté sur un pin ».
Eig s’oppose parfois a & : X 397 && opopdv &e mrépvnc; — E 353,
Y 169 é¢ wddag tx xepariig; — V 137 ex mékrov é¢ cxonvfy « Join des en-
droits battus, sur une guette »; — 7 87 & puydy 26 o6800 « du seuil
jusqu’au fond ».
‘Les verbes signifiant « voir » se sont prétés A se construire avec cig:
T 364 idv el odpavdv sboplv; — I 373, etc... etc dia iStoGu « regarder en
face », avec Vaccusatif dna, d’un vieux nom-racine dont il ne reste
guére d’autre trace; d’oi, avec le parfait oxo : F158, ebc... dOaverqor
Osfig elg coma Lorxev « elle ressemble, quand on la regarde en face, aux
déesses immortelles »,
§ 147. Une des originalités de la syntaxe homérique est l’emploi de
1. Sur tout ce probléme, Chantrdine, Rev, de Phil. 68 (1942), p. 115,
£04 GHAPITRE “VIII
eic avec des noms de personne (1a ot: l’attique emploie d¢, xpSc, mapa) :
£327 ag Dainxac ptrov edeiv; — H 312 ele Ayapéuvove: Stov dyov; —
O 402 onescoua el Aynia; — E 127.r8dy be Bearonev auf; — x 202
Bimay elc OSvaia Satppova; — IE 574 ec Uyai ixéreoue nad bg Okt dp-
‘yopénetav « il est venu en suppliant auprés de Pélée et de Thétis aux
pieds d'argent »; — © 176 a8... & mpdrny bedpny.
Avee Jes verbes signifiant « placer, s’asseoir », on trouve parfois elc
et Paccusatif’ (cf., au contraire, § 143) : v 96 & péyapov xaréOnxev exh
Opdvov 3 — 8 54 Uc bux Opdvous Eoveo ; — O 275 epdvn Ale Huréverog | ele d86v.
§ 148. "Ec s’emploie au sens temporel pour marquer une Limite de
temps 1d 375, etc...8 HO; — e 164, etc... de Aorov xaradives i jus-
qu’au coucher du soleil » (mais exceptionnellement y 138 « au coucher
du soleil »); — & 86 d& vobrnsoc és yipus; — T 32, § 456 ale, tnavtiv
«dans un an » (2wavréc exprimant lachévement du cycle de |’année).
— Avec des pronoms : E 465 éc st... ; « jusques & quand? ». D’ot la
création de la locution fréquente els § xev « jusqu’a ce que » (cf. § 390).
" Avec des substantifs exprimant la durée : «135 els Spas « pendant
Pété »; — £ 384 ¥ bc Oépoc &c dmchpyy « Ou au cours de I’été ou au
cours de l’automne ». -
La préposition elc au sens temporel s’est associée dés Pépoque ho-
mérique avec des adverbes ou des conjonctions : B 99 = + 144, w-134-
sig éte (seul exemple homérique); — yu 126 éc Sarepov (vers athétisé) ;
— © 538, » 3418, a 354 é¢ atprov (passages « récents »); — v 199 & mp
rican,
Lea emplois dérivés de e& pour exprimer le but sont rares chez
Homére. On trouve une amorce du sens final dans des tours comme
TAL ele &yopiy xudyoxéuev; — TI 728 trnouc &¢ nédepov memdyyeuev; —
E 787, ete... & mbrepov Ouphocero ; — O 340 gophuevar bc pébov dvBodiv,
Le sens final est net dans les expressions suivantes ; I 102 etmety elc
éyadv... « parler pour le bien de tous » (cf. A 789, ¥ 305); — p 372
elg &rqv xowhoute « vous m’avez fait dormir pour mon malheur », —
Noter B 126 & dexddag « pour constituer des groupes de dix », amorce
du sens distributif.
Sur la construction de eis avec le génitif, voir § 149,
§ 149. Les prépositions é et elc ont-pu, a lorigine, étre associées
4 des génitifs partitifs, comme le montre l’adverbe éymo8dv. Ainsi
doivent s’éxpliquer certaines tournures? toutes faites, surtout avec
des noms propres, qui désignent la maison d’une personhe, le temple
dun dieu. De bonne heure, on a eu le sentiment qu’un substantif
olxm ou lee était sous-entendu, mais telle mest pas la valeur origi-
4, Opinion contraire de Schwyzer-Debrunner, p. 120.
PREPOSITIONS BT PREVERRES 105
nelle du tour : 9 133 & ‘Adodvoso ; — Z 47 ev dqverad marpdc (cf. 2414) ; —
X 389, 2 211. ely *AlSa0 ; — 0 593 elv “Awdos,
Les exempies du méme tour avec ei¢ sont, plus nombreux : en par-
ticulier on 4464, 2 277, 4 425, » 383, © 367, ® 48, XK 213 ele *AiBa0;
x 502; N-4f5 ele “Awog; — avec des noms de personnes : 0 418 és
*Adalvoro (ef. x 327, 2 160); — pour désigner le temple d’une divi-
nits : Z 379, 384 t ’A@nvatns; — aveo un nom commun : Z 378, 383
& yardav ; — 0 482 avBpbe de dpveot; — B 195 by munpdc.
Deux exemples semblent confirmer qu’il n’y a pas lieu de sous-
entendre le mot olxov ou Sapa : & 309 : é¢ ’Ayeddijoc... EADstv « aller
chez Achille » :'s’il fallait sous-entendre un mot, ce serait «inv,
mais il est trop particulier pour que cette construction soit vraisem-
blable ; — et ‘surtout 3 584 elg Atytrrow Bumettos morapote | atijow vijas
« j'ai ramiené ma flotte dans les eaux de l’Egyptos, fleuve qui vient
de Zeus » : il est impossible de rien sous-entendre. |
Remarque. — L'expression tv ou-elg jyeré¢pou ne semble pas pouvoir
s’expliquer directement, mais étre un substitut de elg quay, év hyd,
ate... "Ev huetépou se lit chez Hérodote I 35, et elg }perépov en B 55 =
p 534, et 7 304, mais toujours avec la variante qpérepov (SHye 8. 0.),
qui peut étre plus ancienne.
§ 150. — La préposition ént (cf. skr. api, SmOev, ‘peut-étre mito,
etc...) est une des plus employées. Elle signifie « prés de, contre »,
ov « sur, aprés? ». L’emploi absolu est fréquent ; A 515 of to. #rt
Skog « tu n’as, toi, rien A craindre »; — I’ 45 xaddv | elBog én’ « la beauté
est répandue sur ses membres »; — 7 315 od yap Em pads; — B58
ob yap'tn’ dvhp (of. 2.367, N 104, ® 110 et § 3).
Le sens adverbial est également bien attesté : A 462 éni 8° adore
olvoy | Xetée « dessus elle répandait le vin couleur de feu »; — N 799
abtép én’ &a « d’autres apras »; — a 273 Geok 8’ Ent wdorugar tatu « et
que Jes dieux en soient ici témoins » ; — « 443 éml oxénac fy dvéumo «il y
avait la un abri contre le vent »; — £529 xretvov 8 emt pyroboriipac
« ils tuaient en méme temps » (ou « sur place ») les bergers »; —
A 233 ént péyav dpxov duodza: « en confirmation je préterai un grand
serment »,
On entrevoit parfois ’amorce du « verbe composé » : A 640 éni 8°
Ergita devxd mide; — Z 419 emi fu? tyeev; — A 25, eto... tnt wo
Gov #reddev « il donnait un ordre »; — ¥ 840 yédasav § ent équivaut A
emyédasay ; — A294, etc... ext Tocev ottyes HAv00v; — 7 176 dpro &
4. Schwyzer-Debrunner, p. 465, et la bibliographic citée, et notamment La Roche,
Zeitschrift fur dsterr, Gymn. 24 (1870), p. 81; 23 (1872), p. 61, 483, 641; A. Funck,
User den Gebrauch der Prap. éx\ bei Homer, Programm, Friedland, 1880; H, Skerlo,
Uber den Gebrauch von ent bei Homer, Leipzig, 1910.
106 CHAPITRE VIET
5 — — 104 ént... dpovea. En A 572 énl Apa oépwv, ént porte sur
pépev.
§ 151. L’emploi de éni associé & un verbe est extrémement fré-
quent. Au sens de « sur » : ém6atvo « mettre le pied sur, débarquer.»
(c 83, etc...); émmaém « naviguer sur la mer » (A 312, etc...) ; requ
« étre sur » (B 259, etc...) : de ces trois verbes, le premier est accom-
pagné du génitif, le second de l’accusatif, le troisitme du datif. De
méme : égectadres « debout sur » (M 52, etc...) ; émriOyue « mettre sur »
(a 140, ete...) ; ete...
Sens local de « contre » dans énixeyzn (¢ 19, en parlant de portes
fermées),
Le préverbe s’est volontiers accolé 4 des verbes de mouvement :
énotyouat « passer en revue » (O 279, ete...) ; émmuodgopat (I' 196), méme
sens ; énaddowat « errer » (8 81); emuvpéyew « couvrir une distance a la
course » (¥ 433, etc...). Dune maniére générale, éxt marque Pabou-
tissement d’un mouvement ou d’une action : énepelS « appuyer sur »
(E 856) ; éxépyopat « survenir » (A 535, etc...) ; émkpyouot « verser pour
une libation » (A 471, etc...); émOpdoxw « sauter sur » (@ 515); éna-
paploxw «adapter » (E 167, etc...) ; enaloow «s’élancer » (E 98) ; érapetbe
« échanger » (Z 230) ; émoréyevor « suivant, obéissant » (y 215) ; énarpdve
« exciter » (Z 439) ; Eneyelpw « éveiller » (x 431) ; éracxde « pourvoir de »
(p 266).
Un certain nombre de verbes expriment l’idée dé « secourir » :
énaphyo (Y 783) ; énakéfw (@ 365) ; exapive (Z 361) ; énapxéo (B 873),
Avec des verbes qui concernent les sens, la pensée, etc... : éxaxoto
« écouter » (C277); apopdo (I' 277); emwvebo « approuver » (O 75);
énawéw (B 335) ; émevpnuéw « approuver » (A 22, etc...) ; enéowe « con-
venir » (A 126); énésdny « se résigner » (¥ 591); émdevoum « désirer,
manquer de » (B 229, etc...) ; énéyvvyut « ajouter un sermenl 4 une
parole ».(o 437, ete...).
Dans quelques cas, éxt souligne le sentiment qui provient de tel
ou tel événement : énaydarouar (IT 91); erayAat{ouar (EZ 133) ; emyerda
(of. § 150, ¥ 840).
Remarques. — 1. On a montré qu’un méme composé avec éxt peut avoir
des sens trés divers : énéyw peut signifier « mettre sur » (Z 244),
« offrir » (F 489), « attaquer » (+ 74), «retenir » (@ 244) ; au passif peut
étre éxdyaro « étre fermé » (M 340; cf. I, p. 432}. Toutefais, pour ce
dernier cas, Wackernagel lit éx@yaro (de otyvope), en attribuant &
éni la valeur de« fermer » (Gétting. Nachr., 1902, p. 737-747, 756).
I]. Emtopxéw (T 188) est un dénominatif de émlopxoc : voir, sur ce
groupe, Benveniste, Rev. de l'histoire des religions, 1948, p. 81 sqq.,
et ci-dessus, § 118.
PREPOSITIONS ET PREVERBES 107
§ 152. Comme préposition, én s’emploie avec le génitif, le datif
et Paccusatif.
Avec le génitif, éxt s’emploie au sens local, ce eas se prétant a expri-
mer la notion de contact: (cf. § 63). On peut comparer E 309 épet-
gato... yalyg A X 225 énl wertnc... eperaGelg; cf. encore 4 27 H Bde H él
vis.
Sans mouvement : N 12 foto... | wpod én’ dxporérys xopupiis ; — Y 345
xeltar ént yOovéc. En particulier dans des expressions toutes faites :
ént yépoov « sur la terre ferme » (x 459, etc...); én’ hmelpov « sur le
vivage » (a 162, etc...) ; én’ &ypod « aux ehamps » (7 330). .
Dans des formules ot le substantif désigne un objet (voiture, na-
vire) : ént vnég « & bord du navire » (3 489, ete...); ént-vndv « & bord
des navires » (E 550, etc.,.), qui se distingue nettement de ért vquat
« prés des vaisseaux » (cf. § 153); én dmhvyg (6 252); ep” trnev « sur
leur char » (M 82, Q 356). Cf. E 249 yaXdys6” ép” trav « reculons sur
notre char! », — Encore au sens de « sur»: A 46 &xdayEav & ap” biarol
én’ duav; etc...
Avec des verbes qui supposent un mouvement comme « s’asseoir,
placer », etc... : @ 522 éeu emt Opévov; — x 62 én’ od805 | eoyeba ; —
TL 223 Of’ ent vijog; — C252 tier én™ dmpvng; — IL 700 ent mipyou |
for; — K 80 bpOabels 8 tip’ En’ d&yudsvos ; — A 485 én’ Freelpowo tpusaay |
bpd Ext Paudfors, avec le datif employé a cété du génitif, celui-ei ex-
primant mieux la direction que celui-la.
Avec des verbes qui expriment nettement le mouvement : N 665
ent vndc tbawvev; — x 56 én’ Amelpov Biyev; — XK 45 nepvig vow ént
syacSandwy ; — EZ 534 ép’ trmov | Pévtes « montant sur leurs chars »;
— 1 588 ént mpyav | Baivoy (4 opposer a Z 386 aa’ Ext mipyov E6y).
Du sens de « sur », #wi est passé au sens plus rare de « vers, pres de ».
Sans mouvement : X 153 én’ adtdéov mhuwoi apes eyyts Exot « prés
d’elles sont de vastes lavoirs... »; — noter expression én’ éoyarryg
« au fond de, & l’extrémité de » (e 489, « 280, « 358, avec une variante
én’ doyattf qui est parfois mieux attestée) ; cf. x 96.
Avec des verbes de mouvement : [5 métoyra: én’ "OQheavod fodav;
— E 700 mpotpérovro... ét vndv « tournaient le dos pour rejoindre les
nefs »; — y 174 veolpeda... vagou Em Vuping ; — A 546 totcae 8 mamrhvas
bg” duthov; — ¥ 374 tércov Bpduov... | Rp eg” ards.
Le génitif avec én) a fourni quelques compléments de temps :
B 797, etc... én’ elptyac; — E 637, etc.., énl mportpav dvipdmev « aux
temps des anciens hommes ». Les emplois dérivés sont rares : H 195
eiyeo0e... | ovyf 29” duetwy « priez, sans ouvrir la bouche, pour vous »;
4. Ou vers notre char? Voir la note de Leaf, et Bolling, Cl. Ph. 26 (1934), p. 313.
Selon Aristonicus, le vers était condamné par Aristarque.
#08 CHAPITRE VIII
— B197 = a 278 S000 tome plays ent moiSdg Eneobar « las cadeaux que
Yon a coutume d’offrir pour obtenir une fille! »,
§ 153, L’emploi de ént avec le datif (locatif) est fréquent, mais dans
des formules et généralement avec des substantifs différents : Z 400
tat’ Enh xéarep tyovox ; — 1 490 xarkBevous int orhGeast yrcdva ; — A 420
Boaye youdg nt orfecow; — 2 607 tyov xal énl veupfigw dtordv.; —
B 312 beav... | ip ex? dxpordty ; — I 153 fue’ ent mbpye; — ¥ 776 ofc
dnt Tlaspéxrg trepvev « qu'il a tués sur le corps de Patrocle, en son
honneur »; — A 504, etc... dpdBnoe 8% tedye’ én’ abté « ses armes ré-
sonnérent sur lui »; — A 261 roto 8 én’ "Iqidduavn xdpn dxéxowe « il
lui trancha Je tate sur Iphidamas méme »; — noter E 154 vidy 8 od
aéxer’ Bov ent xredrecot Anéofle: « i] n’a donné le jour a aucun autre
Ais qu’il puisse laisser sur ses biens »; etc...
Avec des verbes impliquant un mouvement : E 458, etc... ofrace
yeip! trl xapn ; — X97 mbpye Em... dpeloas ; — A55 emt ppeot OFxe « ... lui
a mie au ceeur cette pensée »; — Z 92 Getvar... ent youwaot ; — T° 114 xa-
séGevy’ tnt yoln ; — ¥ 852 sqq. lordv 8” Lornoev... | tyod ext papdBors 5 —
6 499 bx... Baivoy dnt pyyutve Oaddaang; — B89 nésovens én? AvBeaw 3 etc...
Ces emplois ne différent pas sensiblement de ceux que nous avons
observés avec le génitif. Peut-étre le datif peutsil désigner un point
moins précis que le génitif. Pour exprimer lidée générale de « sur
terre », le datif est employé : A 88, x 439, etc... 08 m1 Eyed Cavrog xal
trl xGovi Bepxouévoro. Ailleurs, des formules avec le génitif et le datif
semblent bien équivalentes : I 293 rods udy xatéOnxev él yBovds do-
walpovres, mais Z 473 xal, thy piv xarééyxey ent xBovi naypavdacay ; — de
méme Y 345 tyyog wév é8e vetron ext yGovdc, mais L 461 6 St xetrar ent
xOovt Oupdy dyebov.
Avec le datif, énl a pris le sens de « auprés de » : Z 506 dxoorhoas
tnt pdevy ; — v 408 nap Képanos rézen ext ce xphvn ’Apebodon ; — B 788,
etc... éni Lpidporo Opnor ; — 4 160 hou an’ eoyden ey xoviner... « prés
du foyer »; »; — avec des noms de riviéres :' H 133 én’ dxupde KerdSovet ;
—AT12 iw ‘Adperg ; etc... Au sens de « vers » aprés un verbe de mou-
vement : T 53 Oéwv én Kadduxorayy.
Les compléments qui comportent le nom du navire méritent d’étre
examinés. A la différence de ént vydv « & bord », éxt vquoi signifie
« pres des nefs » : A 559 ddéayg 8 nodéag Emi vavalv’ Ayaudiv ; — © 259 end
vapolv labav « passant la nuit prés des nefs » et non « a bord des nefs »;
ete... Aprés un verbe de mouvement : E 327 vyvaiv em... thavvépev
« pousser les chevaux vers les nefs » ; — X 392 vqualy Em... vecssabe: ; etc...
Remarque. — Au datif singulier, le sens est moins fixé. @ 222 — A5
1, Le sens est, én somme, celui du but, Méme syntaxe I 602, sion litéxt dupwv.
PREPOSITIONS ET PREVERBES {09
oti 8 én’ OBvatjos peywetret vyl « il s’est arrété sur la nef d’Ulysse » ;
—de mame A 600 Ent roupyij... val doit signifier « sur Ja poupe ».
Le sens de proximité a entrainé certains développements de tnt
avec le datif : © 501 [eotyy emi lotop: meipap Héofor « pour avoir une
décision auprés d’un juge » (le complément semble se rapporter & la
foig’A Wéotmy et A féoGar). Plus important est l’emploi de éxt pour dési-
gner les bétes que l’on garde : v 209 dc p’ Ent Bousty { eles ; — v 221 Bov-
alv éx’ dorpinor xaOiuevov; — Z 424 xartmepve... | Boucty ex’ sbund-
Secor; — A 106 nowalvovr’ én’ Beco. .
Avec des verbes de mouvement et des noms de personnes au sens
de « vers »: A 251 4a0e 8 éxt Korjrecor. — Le plus souvent avec une
nuance d’hostilité : F 15, E 14, etc... én? ddafpouw lévieg; — O 582
&mi col... Ope ; — O 726 En’ Apystorory Spovecy ; — IT 751 Ent Kebprévy. owt
Pebfeer; — E 124, ote... trt Tpdeom udzeaBat.-
Le sens tempore, a o6té du sens local, ne s’observé que dans
quelques expressions : © 529 él west « pour la nuit »; — N 234 én’
Jpan thBe « pour ce jour-ci »; — K 48 én’ Hyon « pour un jour.»; —
€ 105 altel... én’ quate « pour chaque jour ».
§ 154. Déja chez Homére, émi s’est prété A prendre des sens figurés.
Ainsi, @aprés des tours comme A 106 mowalvovt’ én’ bso, On a em-
ployé éxt pour exprimer la surveillance, lautorité : 0 89 oSpqv... xa-
rbdeumov ert xredtecot « pour surveiller mes biens »; — x 427 onualve:..
énl Spasar yovarkty « commander aux servantes ».
Pour exprimer Paccumulation : » 120 byyyn én’ Byxyn « poire sur
poire, poire aprés poire »; — p 454 adx dpa aol y" éml el8er xal ppives
« avec ta beauté, tu n’as pas de coeur »; — I 639 dda te wodKe axl
ior « et bien d’autres choses en plus » (cf. encore N 485, Q 234. = w 277,
x 264). Cet emploi a pris dans le grec postérieur une grande tmpor-
tance.
On s’explique que ént ait pris le sens de « a propos de, quand il
s'agit de, pour ». Avec un complément de personne : T 181... 0) &
SErevva Sexondtepog xol ex’ Kr | Socext « méme a Pégard d’un autre »;
— A 162 & Em 60? tuoyhox; — I 492 emi ol pdra ndW2’ Enaflov « que
pour toi j’ai souffert ». A propos de Troie : ® 585 rods teredEerar dye”
x’ adcfj « il vous faudra pour elle supporter bien d’autres miséres ».
En outre, A 235 énl yed8eacr... dpwyds « prétant secours A la félonie »;
— A 258 dddoly Ent,goye « pour toute autre tache » (cf. A 175), —
A 178 Ent nao: « en toute occasion »; —-o 44 Ent Sépnq « pour le
repas du soir »; — ¥ 574 én’ 4pwyij « pour favoriser l’un des deux »;
— o 444 ert Syfive Suxot « pour des choses justes que l’on vous a
dites ».
C’est a ces emplois que l’on peut rattacher le sens de « en ’hoaneur
410 CHAPITRE VII
de » : cf. ¥ 274 et wav viv él Dr dOrevorsev « si c’était en Phonneur
d'un autre que nous célébrions des jeux... ».
Avec un sens final, éni, avec le datif, s’est prété 4 exprimer la ré-
compense ou le prix pour lequel on combat : K 304 ddpe ent peydro
« pour une belle récompense »; — 9 445 wrod éni dard ; — I 602 ent
Scporg | Epyeo « marche done pour les présents » (variante Sdpav, cf.
§ 152, note 2).
On observe que les emplois de ént avec le datif sont déja dévelop-
pés chez Homére avec diverses significations dérivées ; toutefois, le
sens de « a la condition de », fréquent en ionien-attique, ne se trouve
pas encore.
§ 155. Avec l’accusatif, éxt peut exprimer la direction avee un verbe
de mouvement : I 265 amo€dvteg érl yOdva « descendant de leurs chars
sur la terre »; — A 78 ént yO6vo srEev « s'est élancé sur la terre »; —
Z 386 ént xdpyov &6y (mais le génitif en 1 588); — M 375 én’ Endater
BBauvov} — x 2 Haro & ent péyav od86v; — ¥ 393 ent yatav edon ; —
2.590 Heipav... én? dmivay; — © 442 emi Opivov... lero; — noter E 58
xneoe... Ext Bocypdv te xa Syoug « il est tombé sur le sommet di
crane et sur les épaules » (cf. Z 43).
Au sens de « vers, a» plutét que « sur » : © 198 ént téqpov kev « allant
jusqu’au fossé »; — X 208 éml xpotvoug dptxovro ; — € 236 rudy ext OTva
aardaors « vers la greve »; — A 12 Abe Bode ent vijac « vers les nefs »;
— A 440 éxi Bopdy « vers ’autel » (et non pas « sur ») ; — 5565 drapmirdg
ev be’ abthy; — M 443 ovaay ént setyos, — Noter B 248 ent ariiQ0¢ avvo-
xaxére « ramassées' sur la poitrine ».
Assez rarement avec des noms de personnes et presque uniquement
dans PJliade : B 18 Bx 8 ap’ én’ "Axpety *Ayapépvove (ef. E 590, K 18,
54, 95, 150, A 343, 805, M 342, N94, 459, 2 24, 11 535, © 149). Parfois
avec un sens hostile : E 590 dipro 8° én’ adroig (cf. avec le complément
véag N 104, ete...).
Le sens de direction apparait bien dans certaines expressions quasi
adverbiales comme ént de&td et tx’ dpsrepd : H 238 old” ent dckétd, 018?
tn’ dprotepd veo Fout Sav « je sais mouvoir mon bouelier a dreite et a
gauche »; — E 355 edpey tmerra payne x’ dprotept.
§ 156. L’accusatif avec ént s’emploie. également pour exprimer |’ex-
tension : H 88, ete... wAéwv tml olvona mévrov; — N 27 tide ent xd-
para; — K 27 rovriv dp’ dypiv | HAvdov; — B 159 geskovrar én’ edpéa
vara addoons; — A 350 Spduw ont olvera névrov; — Y 227 dixpov én...
xapmdyv Stov « elles couraient sur la pointe des épis »; — @ 1 éxis-
varo T&oay ex’ alav; — P 447 bean te yaiay Ext revelet te xal gomer. — Avec
un verbe signifiant « partager » et un complément de personne : 7 385 °
PREPOSITIONS ET PREVERBES — 1
Sasoduevor xatd potpav tp* hutac. — Avec pbdvm : 1 506 qbdver 8¢ te mi-
aay én’ alav | GAdtrous’ dvOpdrrous « elle va la premiere sur toute la terre
faire du mal aux humains ».
Cet emploi n’est pas nécessairement lié 4 un verbe de mouvement.
Avec un adjectif : B 308 Spdxav nl vita dapowéc, Avec un verbe qui
n’implique pas un mouvement : 4 577 6 8 én’ éwéa xetro néreOpa ; —
@ 370 néveov én’ dxpyerov xaxd mdoyew ; — 1 107 en’ &relpova yatav | ver-
xéou 3 — 9 332 én’... &povpav... wos ely; — Y B74 dog Fev ent xObva ; —
avec, comme complément, dvOpdroug : « 299 xAtog Barabe... | mavrag ax’
avWOpdnoug ; — } 125 dptaryy | uit én’ dvOpdmoug ode” Eupevar; — w 201
oruyeph 84 7 dowd), | kooer” én’ dvOpehrovg; — K 242 xArdog ety | ndvrag én?
dvOpdiroug (ef. @ 202, 535).
Pour exprimer la distance, on reléve un certain nombre d’exemples
de V’accusatif neutre d’un pronom : ¥ 320 énl moddov éxtocera: ; etc... 5
— cest probablement d’aprés de tels tours qu’a été -constituée l’ex-
pression figurée : M 436 = O 413 ént toa pdyn tétato « la bataille
s’équilibrait ». — Le tour est surtout fréquent avec le relatif éc0v ou
Boov te : T 12 réacov thc +” Emtdedooe: Sacov 1° érl Adav Tyo: « on ne voit.
pas plus loin que le jet d'une pierre »; — B 6416 Sca0v #9’ « toute
Vétendue que »; — ® 251 dcov v’ ent Boupdc eowh « & une portée
de lance »; — K 354 Scaov + aml odpa nédovra | fyrdvev « une dis-
tance égale a celle que mesure l’effort d’une mule au labour » (cf.
8 124),
_ Au sens temporel, én et Paccusatif expriment la durée. Au sens
de « jusque » : 7 288 én’ 4& xad péoov Fuap ; — 8 226 ob8 éxl yiipas |
txeto, — Au sens de « pendant » : p 407 moxadv Eni ypdvov; — B 299
uetvar’ éxd ypdvov ; — 1 445 nt Snpdv 3¢ yor ala | Fooerae,
§ 157. Certains emplois fournissent l'amorce d’un sens figuré de
but. Il est parfois proche encore du sens originel : T 422 (ef. 8 122)
tnt Eye tp&movto « 8e sont mis a leur ouvrage »; — B 808 ént tedyex
8 boceboveo « on courait aux armes »; — B 384 Epyeat’ ent Setxvov ; —
439 nl Séprov... dvéorq. — Exemples ow le sens a évolué davantage :
A 384 dyyedtny Em « pour rapporter des nouvelles »; — Z 79 (cf. 8 434)
nasav ix’ iby « pour toute entreprise ». Avec l’objet que l’on recherche :
‘7 421 Em Botv fro « pour chercher une vache.
Certaines expressions sont devenues quasi adverbiales : nl otlyac
«en lignes, sur les lignes » (113, © 602) ; — emi oté6unv « au cordeau »
(e 245, p 341, 9 44, 124, $ 197).
L’ensemble des emplois de ém présente une grande variété. Avec
le nom du vaisseau, éxt vydv signifie « 4 bord des nefs », émt vyvelv
« prés des nefs », éxt viac « vers les nefs », mais il est parfois malaisé de
distinguer entre Vaccusatif’ et le datif : X 392 vnuelv Em... vedueba et
112 CHAPITRE VII
N 101 dp” fuctépas lever véac. De méme avec xGav, la distinction entre le
datif, Paccusatif et le génitif n’apparait pas toujours facile.
§ 158. On rapproche généralement xatk? de gallois cant, peut étre
hittite Aatia. Du point de vue grec, xaré fait couple avec 4vé en s'y
opposant. Le mot signifie « en descendant de », « en se conformant a »,
« complétement ». Comme adverbe, il est concurrencé par xétw et ne
s’emploie pas dans une phrase nominale. Mais les exemples ob xatk
« préverhe » se trouve disjoint du verbe sont innombrables. Au sens
de « du haut en bas »: A 413, etc... xara Sdxpv yéousa ; —- A 68, etc...
ar’ dig’ Keto ; — F125 xx8 3° Bp... BaMov; — ¥ 727, ete... x&d 8° Eres’ ;
— F715 xaré 88... péev ; —O 441 xara Kita metkoous ; — au sens de « tout
a fait »: A 464, etc... xaté pijp* éxdn; — T 334 nord méurmay | cetivetyer 5
—~ A 436 xard 8& mpuuvfor ESyoav; — B 160 a8 3 xev Atmorey « ils aban?
donneraient (4 Priam)... ». — Noter encore TI 410 x33 3’ &’ ért orby’”
Baas; —-& 349 xepudy 88 xatd ddixog dupneartyas.
Le préverbe suit parfois immédiatement le verbe sur lequel il porte :
cf. B 699, P 91, 1 6, 6 257.
I existe également un grand nombre de formes verbales propre-
ment composées. Au sens de « sur, sur }’étendue de » : xd0qumx (B 191,
ete...) 3 xaO(Go (F426); xardxeysat (Q 527); xablornut (I 202); xeras-
topvuut (Q 798) ; xatxcxvkw (u 436) « couvrir d’ombre »; etc... — Pour
exprimer l’idée de « descendre, diriger vers le bas »: xatx6aivw (A 184,
etc...) 3 xcreyse (A 475) ; xainur (2 642) 5 rxearaBdarw (C172); xarappéto
(A 361); xorappéa (A 149); xarérexvo (1 662); xaraninte (II 641);
xarariza (E 560) ; xxtarrioow (@ 136) ; xaradbouat (A 475) ; xatadépxo-
yar (2 16); xxBopde (A 337); xxtavedo « baisser la téte, dire oui »
(A 544, eto...).
Vidé de son sens concret, le préverbe a exprimé, dés la langue
homérique, la notion de « complétement » et l’aboutissement du
proces : xatadéyw « énumeérer, raconter » (K 443); xataynpéaxw (+ 360) 5
xaralvpoxes (X 355) ; xarag8lves (X 288) ; xxraxotshe (B 355) ; xaranctelves
(Z 204) ; xarémepvov (Z 186); xareptne (Z 5418) ; xatarh0e (X 389) 5 xa-
tty (O 186) ; xxté&yvoun (N 257, ete...) ; ete...
Le sens « hostile » de xaré, qui se rattache 4 ces emplois et a certains
usages de la préposition, est exceptionnel chez Homére : + 372 &¢
aOev at xives al8e xxBeusevta « te méprisent ». '
§ 159. Comme préposition, xerd se trouve associé au génitif et a
Paccusatif. .
Avec un génitif marquant l’origine (genitif-ablatif) « du haut de »:
X 187, ete... 8% 8 xa” Oddiunoo xaphvov dEaoa « d'un bond, elle est
4. Schwyzer-Debrunner, p. 474, avec la bibliographie
PREPOSITIONS ET PREVERBES . 4113
descendue des hauteurs de ’Olympe »; — Z 128 nav’ obpavod elhrov-
Gag ; — II 677 By 38 xax’ "TSatev dptov; — & 399 Barter... xank nézpns;
— 7 232 usd’ trrov dtEavee « sautant du haut de leur char »; — A 452
movapol xaz' 3peage Alovres ; — P 438 Bdxpua... xark Brepdpav yauddic Abe
« des larmes coulaient de ses yeux a terre ».
*Remarque. — Certaines locutions sont devenues quasi adverbiales :
+ nat’ dxpy¢ «du haut en bas, de fond en comble? » : en parlant d’ Ilion :
X 444 mupl opiyorto xr? axons; — Q 728 xa” Seng | népoerar ; —
0 557 xaz’ kxgng | "Dov... Edgew ; —N 772 Shere... xarx’ dep | “Thtog
« c’en est fait de la haute Hion jusqu’en ses fondements »; — dans
un contexte différent : © 313 fAaoev... xdua xar” &xeng:« la vague le
fit capoter » (I’expression est adverbiale et xax’ dxpyg ne peut se rap-
porter & oyedin¢ sous-entendu}.
Sur xav’ dxpng a été constituée une locution xaz’ + dupnbev, qui, par
rapprochement avec le nom de la « téte », est devenue xat& xpiOev
{Aristarque}, qui évoque V’idée de « de la téte aux pieds » : IT 548
.. Kare xpHOev AdGe névOac « la douleur s’empare (des Troyens) de la-
téte aux pieds »; — en A 588 (passage « récent ») Sévdpea... ard
xpiidev yée xxpnév peut signifier « des arbres de leur cime laissaient
pendre leurs fruits » ; cf. Hymne 4-Déméter 182 ; Hésiode, Théog. 574%
(mais voir aussi § 160).
§ 160. Keré, suivi du génitif de but, désigne le point atteint par un
mouvement de haut en bas et se traduit par «vers, sur» : I 217 xark
Oovds Bupara mhEag « les yeux fixés a terre »; — E 696 xara 8° Sp6x-
pdy xéyur’ deydbg ; — N 580 tdv 88 xox’ dp Oadudiv... WE Exdduev ; — x 362
xatk xparés ve xal Suov «en inondant la téte et les épaules »; — + 330
(xénpoc) xara oneloug xéyuvo «... était répandu sur le sol de la caverne »;
— E24 xébwv.., yeiaro xin xepariic (= w B17, of. | 156),
Avec le génitif, xaré signifie également « dans, sous », avec un mou-
vement de haut en bas : N 504 alyyd... xatk yatns | Syero « la javeline
allait se perdre dans le go] »; — @ 172 BOnxe xaz’ by8ye petdwov Eyyos ;
— T 39 ordée xard givéiv « elle a instillé dans les narines »; — 4 03 xar&
oneloug,.. 3é3uxe; — F100 dud xark ybovds... yeto « ame s’en allait
sous terre ».
Remarque. — Certains passages sont ambigus. En 6.85 (pipoc) xdxe xe-
paris elpuoce peut signifier « il tira sur sa téte » ou, plutét,« il tirade
sa téte » (sur son front) génitif-ablatif (ef. Hymne & Déméter 182) ; —
en 3 680, xa’ ob80% Bévra peut équivaloir A én’ S80 Bavea « met-
tant le pied sur le seuil >, ou signifier « descendant du seuil ». —
En 2 588 cité au paragraphe précédent, on traduit souvent xavd
xpidev xée xaprév « laissaient pendre leurs fruits sur sa téte ».
1. Voir, sur ce probléme, Lejeune, Les adverbes grecs en -Gev, p. 81 sqq.,et M. Leu-
mann, Homerische Worter, p. 57 sqq.
M4 CHAPITRE VIII
§ 164. Les emplois de x«ré avec lV’accusatif sont 'variés, Un sens
ancien est celui d’un mouvément de haut en bas : T 209 xard Aaudv
letn; — M 33, & 254, ete... xat&d péov « en suivant le courant! »; —
7.136 Sioc8? dhdg xacd xSua ; — D 559 xard se dome bo ; —- IE 349 70
8 dvd orbua xal xork dtvac | npfjice «il rend le sang qui remonte par la
bouche et descend par le nez » (mais T 39 xat& frvéiv). .
Avec ou sans mouvement, xatd s’emploie chez Homére au sens de
«a travers, vers, dans » : B 47, 187, etc... 86 xar& vijac « vers les nefs »;
—19 bra Exacta novnodwevor xat& via « sur-le vaisseau »; — A 276 ép-
youevoy xate mévtav « qui s’avance sur la mer »; — O 682 Siytat... xa6?
836v « les pouisse par la route »; — I 96 medtov xdta SypidacOar ; —
B 383, w 443 xara mrduv yeto xévry ; — B 803 wondol... xet& dorw... ént-
xoupor (cf. Z 287, = 286, © 225, ete. — « 344, etc... xa6’ ‘Edda
xed pésov “Apyos ; — A770 xar’ ‘AyautSa ; — I 329 xare Tpotyy ; — I 463
xard utyapa oxpepdcbar: — A 386 Sawutvoug xard Sue; — y 428 xatd
Beyer’... daira néveotian; — B 322 Byov xdza Batra névovro; — mw 150
xa’ dypobs | waéleabon; — A 68 xox? Spovpay ; etc...
Avec des collectifs : A 318 mévovro xat& otputty ; — E 84 xard xpate-
phy doulvyy; — E 332 nérepov xéra; — TP 36 xa0” Susrov; — E 159
xara u60ov; tour exceptionnel dans )’Odyssée, qui a pourtant. plus
une fois xard diuov, B 101, etc...
On emploie également xara pour désigner lemplacement d’une
blessure : A 108 xara orf0¢ Bde ; — [I 465 Bdde velapav xatk yaordpa ;
— E 46 woke... xard... duov; — de méme E615 xatk Cworipa Béke ; —
T 347 Bddev "ArpetBuo xt? dontBa + — A 354 Bidev... dxpny xdic xépuba.
Rarement avec un complément au pluriel désignant des personnes,
« parmi » : N 557 xaz’ adtods | orpeqée ; — P 732 weraotpepOtvre xat’
adrobs | oratnoav ; — E605 edivevoy xard uéssous ; — 0 276 xat” dvOpdsrous
andono0u; —K 117 xard ndvrag dproting noveecOar ; — p 362 xa tivne-
Tijpas dyelpor.
Liaccusatif suivant xaré s'est employé aved les substantifs Guudv et
ephy : T 125 dyog a&) xare ppdva mipe; d’oil Pexpression xar& ppéva xat
xat& Ouzdv « dans mon esprit et dans mon ceeur »: A 163, etc... — No-
ter aussi P 167 xar’ dese iSav « voyant sous ses yeux ».
Une des originalités de la syntaxe de xar& avec l’accusatif est l’em-
ploi au sens distributif que l'ionien attique a conservé : B 362 xpi’
AvBpuc ard pike, xark ptyroac « sépare les hommes par tribu et par
clan »; — B 99,241 éphrode 8& xa" pag « ils restent chacun a sa
place»; — a 145, ete... eavro xatk xduopods te Opdvouc'te; — A 487
oxiSvavio xatk xAtolag te véas te (cf. H 466, © 54, ete...); — T 93 xat’
41, Mais en © 147 xara A607 signifle plutot « dans le courant »,
PREPOSITIONS ET PREVERRES 115
evBpdv xpdarza Batver; — probablement aussi B 305 xard Bapods | ¥p8o-
pev... éxatéubag « sur Pautel de chacun des dieux ». Egalement avec
le sens distributif : B 366 xara opéas yap uoytovrn « ils iront par
groupe & la bataille »; — de méme aussi A 271 xai payduny xar* ty? ab-
zov «et je combattais pour mon propre compte ».
Kara et l’accusatif exprimant souvent un mouvement ont pris le
sens de « pour » en indiquant une intention : y 72 = 1 253 % 1 work
nptitw... 6ano0e « est-ce pour faire des affaires que vous allez... »; —
y 106 wratduevor xer& ant8a « pour faire du butin »; —2 479 #280v Te-
peclao xar& xpos « c'est pour recourir A Tirésias que je suis venu ici ».
Ces exemples sont tous dans l’Odyssée.
§ 162. Au figuré, xart est déja largement employé au sens de
« conformément & », en particulier dans des expressions toutes faites
qui sont quasi adverbiales : A 286, etc... xat& wotpav « comme il con-
vient »; — A 48, etc... xat& xdouov «en bon ordre »; — T 59, ete...
xar’ aloav « A bon droit, comme il faut »; — I 108 od t+ xa’ qusrepdv
ye véov « bien contre notre gré »; — } 645 xatd Supiv... poOhouata
« parler comme je le souhaitais »; — A 136 dpaavres xard Oupdv « l'ac-
commodant a mes désirs ». —- Noter l’expression isolée + 233 pour
exprimer Ja comparaison : ofdv te xpoutoto Aomby xdéta « A la maniére
dune pelure d’oignon » (xazé porte sur Aérov).
Les emplois de xaté accompagné de l’accusatif sont déja fort va-
riés chez Homére. Certaines constructions du type xa0’ “End8a, xar&
otpazdy, etc..., sont surtout homériques. En revanche, l’emploi tem-
porel et certains tours adverbiaux comme xaté& rdyoc, etc..., n’appa-
raissent qu’en ionien-attique.
§ 163. La préposition peté*, qui n'a de correspondants qu’en ger-
manique (allemand mit), semble signifier originellement.’« au milieu
de, parmi » (cf. péxe., péopa, uéaoc, etc...). Elle est concurrencée en
grec par ne8z dans quelques dialectes (Schwyzer-Debrunner, p. 498).
L’emploi adverbial est bien attesté chez Homére, sans y étre d’ail-
leurs tres fréquent. Un seul exemple de phrase nominale : 9 93 od yée
mg péra rotog dvhp év toia8en xéow « il ne se trouve aucun homme pa-
reil parmi tous ces gens », Au sens adverbial, werd peut signifier « au
milieu de, parmi » : B 446 perth 8 yravxdsmic "AOhvy « et parmi enx,
Athéné aux yeux pers » (ci. B 477); — © 545 werd 8 dvégec « et avec
eux des hommes »; — I 131 wera 8 fooetat « et avec elles il y aura... ».
— Au sens de « a la suite de » : @ 231 mpdrog eye, petk 8 Supe, —
4. Schwyzer-Debrunner, p. 481, et la bibliographie citée, notamment Tycho
Mommsen, Beisriige zu der Lehre von den griechischen Pritpositionen, Berlin, 1893.
fi6 CHAPITRE VIII
FY 133 pera 88 végoc elmeto neOv. — Au sens temporel : 0 67 pera 8 vldv
éudv « ef ensuite mon fils »; — 0 400 peta ydp ve xal Hayeq répretan dvip.
$164. Comme préverbe, peré s’associe volontiers 4 certains verbes!.
Par exemple, les verbes signifiant « dire », pour indiquer que !’on parle
dans‘un groupe de personnes : Y 144 orhoaca Geodc pevd piBov Heme
(cf. © 777); dans diverses formules figure un datif pluriel qui peut
étre senti généralement comme indépendant de perd : F303 totor &.
Aap8avidn¢ Lplapog pera pibov tere (cf. x 561, etc...). Le composé est
largement attesté : uetéemey A 73, 253, etc... De méme perépy A 58,
B 411, ete... Les formules distinguent en principe entre werépn, em-
ployé lorsqu’on parle dans un groupe de personnes, et xpostgn, lors-
qu’on s’adrease 4 un interlocuteur. Parmi Jes verbes qui s’associent
volontiers avec perd, il y a npémew : 6 172 gta 58 xpémer dypoptvoran, cf.
o 2 et le composé peréxpens (O 550, etc...) : on reléve encore peréant
(H 227), peBoptreov (A 269), webjzevos (x 118), peretCew (de (Ceo, 362), —
On observe également pera avec des verbes de mouvement pour expri-
mer D’idée de l’aboutissement : u 312 = & 483 werd 8° Kovpo. Babine 3 —
pereddv (E 456, etc...) ; — pereradevoc (N 90); — pend... Bardv (@ 94) ;
— pete 8 drpdines’ (A 199) et peraepémy (A 160) ; — perworpemtiels (A 595) ;
—~ petlorare (E 544) ; — usréuisyov (o 310) ; — an figuré, 6 492 perébnh
« passe 4 un autre sujet ».— De méme avec des verbes exprimant
Pidée que l’on cherche a atteindre, parfois avec Paccusatif : weroyopévy
(+ 24), souvent petatcawy (TI 398), peteaossovte (Z 296), wevextaflov (A 52,
ete...) ; — A 48 perk 8 lov &yxe; mais au sens de « relacher »: K 449
usbSpev; — K 516 "A@qvatyv yerd ToStoc vldv Enovaay et péBene E 329,
© 126, ete... Le préverbe a pu exprimer lidée de « relache » : wetanaud-
pevor « avec des poses » (P 371); — pellere (M 409, ete...)3 — yerod-
atgovee (I 157, ete...); — Pidée d? « interception » : @ 376 wedErcoxe. —
Noter, enfin, le développement qui conduit 4 des expressions (tirées
de Tidée de « changement ») comme A 140 petagpasdueste « nous y
songerons de nouveau »; — e 286 perebodievezy Geol Mac « les dieux
ont changé d’avis ».
Remarque. — Il peut étre malaisé de déterminer si nous avons affaire
4 un préverbe ou & une préposition : 0 460 peta 8 HAdxtporoww Lepto
«do Pambre y était enfilé », 1 semble naturel de rapprocher pstd
de Eepto et de considérer Agxtpoe Comme un instrumental,
$165. Le plus grand nombre des exemples de ueré se trouvent avec
le datif-locatif au sens de « au milieu de, parmi ». Ainsi dans des for-
4. Sur Porigine de certains composés, voir M. Leumann, Homerische Worter,
P. 93.8aq.
PREPOSITIONS ET PREVERBES 447
mules fréquentes et banales comme yert yepol (y 281, ekc...), peve
nooat (N 579}, werk gpest (8 825). — Noter encore werd... yéveaow « au
milieu des mAchoires » (A 416) ; — pent yaunAfion (N 200) ; — ped x5~
pan (7°91); — per’ "Ayatdv vnuol (N 668). — Le verbe principal peut
implquer un mouvement : T 140 rboq pet& nocat yuvenxde (ef. N 579).
Noter des formules expressives : O 118 xetoGat... weO? atyatt xat xo-
vinet ; — © 503 nenredr’ Music Ma werd atpopdrryye roving.
C'est surtout 4 propos de personnes que semploie perk : « 19 yet
olor plrorn ; — A 388 uoivos édv nodtow pers KaSuelorv ; — F536 werd
xpdrrowm udysotat, ef. A 744, ¥ 649, etc...; — A 252 werd tprrdrouow
&vasoe ; — 1 352 usr *Ayausiow nodurtov; — A 64 sqq. dct phy ve pers
npdrorst odveruer | Hote & év muudrota: xekedov; — I 15 Scher... Mnreds
ued MupuiBévecaw ; — + 369 Otrw by minarov Koya pork ole érdpom
« parmi ses compagnons » (et non « ‘apres »).
Avec les verbes signifiant « aller » : + 430 = 437 pert tote. dt Bios
*Odvoceis | Hue.’ — Souvent avec des verbes signifiant « dire », etc... :
K 250 per’ "Apyelors dyopeverc; — p 154 pete 8b pvnoripor teens; —
BAT perk 86 opw dudrmero 5 etc..
A Poccasion, Ie complément est un substantif de valeur collective :
T 50 xa8 8% wert npdry kyoph ovto « ils s'asseyaient au premier rang
de Yassemblée » ; — X 49 el utv Ghovar eta atpatH (cf. 0 156, 4 449).
Mérd se distingue de é en soulignant qu’il s’agit d’un groupe, d’une
troupe. Il y a une intention dans per’ dorpdor (X 28, 347) « dans Vas-
semblée des astres »; — de méme ® 122 xeioo per’ ixObor « dans la so-
ciété des poissons ». — Enfin, « 224 = p 285 perth xai r68¢ totar yevéodo
« (j'ai déja subi bien des épreuves), celle-ci viendra s'ajouter parmi
toutes les autres ». .
Dans un assez grand nombre de formules, uetd. associé a éuporépatat,
exprime l’idée de « entre deux » : y 136 47 fp ‘Atpet8yo per’ dpqe-
séporaw €Onnev ; of. 1 85, A 16, 83, H 66, ete... ‘
Parfois, le complément au datif avec perk est employé « prolepti-
quement » pour marquer l’aboutissement de Yaction ; A 16 irdryra
er’ dpeottpore: Pérope « mettre entre les peuples ine mutuelle ami-
tid » (cf. A 83); —- F188 dyav... pers rotor éréyOny « je fus enrdlé parmi
eux >; Cf. . 335 muntog perd toto taéyuny ; — x 204 dpydy 38 wer’ dugo-
atpotow Sragoa «j'ai donné un chef a chaque bande ».
Ces emplois du datif-locatif avec yeré, fréquents. chez Homére, sont
rares chez les autres podtes et ne sont pas admis en prose.
§ 166. Les sens de werd suivi de l’accusatif s’expliquent générale-
ment par la valeur d’extension et de direction de ce cas.
Mera signifie « parmi » aprés un verbe de mouvement. Avec des
noms de personne au pluriel : 6 294 otyera &¢ Atjvov pers Llvtag ; —
* 418 CHAPITRE VIII
F, 803 sq. *ule... &¢ Ging xoddac perd Kadjelavas; — A 222 BeBtpees |
Bdhuar’ é¢ alybyoro Avds pets Salpovac Hous; — T' 264, etc... Teavro penk
Tpéag xxi Axotoig; — P 460 doce de v alyumds pets vives; — A 292
Bi 88 yer’ &MAovg ; — 7 366 werd Kauxdivag peyaOspoug | elue (dans ces deux
derniers exemples, proche du sens de « vers »). — Noter la double cons-
truction de { 132-433 abrép 6 fousl yetépyetan 7 dtecow | Hb yer’ dypotépag
2dpoug, ce qui met en relief le dernier terme.
Avec des noms de choses : F165 pete vijag dhotvew (of. M 123, ete...) ;
— Z S14 yoive péper pert +’ Hex xal vopdv Inmov « ses genoux l’em-
portent parmi les lieux familiers et les patures »; — avec des subs-
tantifs abstraits : B 376 wer drpixtoug Epidag xal veinex BédA|er « il me
jette parmi des disputes et des querelles vaines ».
Avec un singulier de sens collectif : A 478 dvtyovrto peta otpatév; —
E573 kpuaaw pert daby; — H 115 dav werd 80v0g; — 142 ay fuev Odnop-
nov d8 Gedy ef" Shyu (ef. encore ¥ 47) ; — IT 245 tes petd wSAav “Apnos 5
ete... . :
Avec un singulier qui n’est pas collectif : £552 Sp¢yyara... pet’ by-
ov... nincov Epate... « tombaient a terre au milieu de !andain »,
§ 167. L'accusatif pouvant exprimer /’extension aussi bien que la
direction, on trouve pets avec l’accusatif, au sens de « parmi », dans
quelques exemples oi le verbe n’est pas un verbe de mouvement :
B 142 rotor 8 Oupsy él ovfPeoaw Bpuvev | mim perd whFOvv « chez toua, a
travers la foule »; — J 54 xai Boud# weté mévrag Syiruag Ender kprotag
« parmi tous les gens de ton age » (ef. « 419); — x 352 detadpevos perk
Satzag « pour chanter parmi les festins! »,
Le sens propre de la préposition « au milieu de, parmi » s'est effacé
et elle a servi a désigner la personne que l’on suit ou que !’on recherche :
E 613 dard & poipa | Hy’ exmouphooves perd Motaysy te xat vlag; — p 83
Youey werd noid? Busy :— 0115 coatpay exer’ tppube wer’ duplrodov Bactreua ;
— 0 221 Epyeo viv, pide Boibe, ped’ “Extopa « va trouver Hector (pour Pai-
der) », — Au sens de « marcher contre » : Z 24 87 88 pet” Alonnov xal T4-
Basev (of. E 152, etc...); — ¥ 394 4 88 per’ “ASuhrov vidy xotéousw Be-
Bier ; etc...
On observe souvent la nuance accessoire que l’on va chercher quel-
qe’un ou quelque chose : 7151 xar’.dypots | mradtectar pet’ Exeivov ; —
K 73 adrép 6 BH leva pet& Néstopa « pour aller chercher Nestor ».— Sou-
vent avec un substantif désignant un objet : H 417 sqq. édfovro...
yet” Giny (cf. 420); — @ 184 méav... | ¢ Tepéony werk ywoedv; — v 153
ust’ S8up | Eoyeode xpiyny 86; — N 247 sqq. werk yap Sépu yeedueoy Fer | of-
adpeves ; —— T 346 olyovra: werd Seitov; — YL 329 rbrepov pera Buprs-
}, Autre interprétation par Brugmann, voir Schwyzer-Debrunner, p. 486, n. 2.
PREPOSITIONS ET PREVERBES 445,
vovro; -— p AF Fade perae yoetos « il est venu pour une dette »; —
8B 307-308 tot | &¢ TldAov hyaOény wer’ dyavod natpdc dxouty « pour avoir
des nouvelles de ton pére »; — A 227 werd xAdog txer’ "Ayordy « vers le
bruit que faisaient les Achéens! » (cf. N 364); — v 415 Gyeto mevadue-
wo etd adv xAéog « pour avoir des nouvelles de toi ».
Au sens de « dans la direction de » : A 357 pevé Sobpats dyer’ dpahv
‘« suivait élan de sa javeline »; — N 543 tration ped” Biv Bérog « s’élan-
cer A la suite de son trait » (ef. X 140, etc...) ; — E321 (iis) wer® defense
tyw’ Enevvisv ; — 8 406 6 8 Enevtae wer’ tyme Bative Oeoio.
D’ot au sens de « Ala suite de » : N 492 perk xtihov tower pia 5 —
© 260 ye6? Hytévous xa) duakav | xapradtseng Epyeodon ; — 0 147 code 82 pet?
"Arpetdng tue (ef. ¢ 190, etc...).
§ 168. D’ou, pour indiquer le rang, et parfois aprés un superlatif :
B 674 xddcotos... pete... Tnpretova ; — 3 652 of xatd Shuav dpratedouss
ped’ tuéac; of. H 228, M 104, IF 195, P 280, 351, 6 350, 2 340; — de
méme d 601 rdv 8 pér’ eloevonaa Bixv “Hpoxadneiny.
D’od Yamorce’ du sens tempore] : & 96 wel” "Exropa notyog trotpog ;
— 2.575 peri Tdérpordy ye Oavévea ; — ¥ 354 werd viv 8 Baye xpelov
Evundos (cf. ¥ 227). Tous ces emplois s’observent avec des noms de
personne. Le premier exemple d'un tour comme yer& tabra, qui doit
devenir si courant, apparait Hymne 4 Hermés, 126. ,
Au figuré, pour indiquer que !’on suit l’avis de quelqu’un : O 52
peractphbee véov peta oby xul duby hp v i] changerait davis d’aprés ta
volonté et.la mienne ».
§ 169, L’emploi de yeré avec le génitif est tout a fait exceptionnel
chez Homére : on en reléve en tout cing exemples au sens de « parmi,
avec », le génitif étant un génitil originellement partitif :
N 700 pert Bovwtéy éudyovro (dans un passage qui a peut-étre été in~
séré tardivement pour faire honneur aux Athéniens) 3.
© 458 ob82 wed’ fubov | meip# (dans la Ody wdyy).
2 400 trav wéra moad6zevos xAHP Adyov « tirant au sort parmi eux, j'ai
été désigné ». Le sens partitif du génitif est net. I] existe une va-
Tiante petamaddbpevos, 6orit en un seul mot.
% 320 per’ Bdwv 2éGo Exalpww « couche-toi parmi tes camarades ».
1 140 peta Suchiov 1° evi ofxep | nive « il buvait parmi les serviteurs dans
\a maison »,
1, Autre iaterprétation, Schwyzer-Debrunner, p. 486. .
2. Bt oft le sens est proche de celui de « avec »: «ils combattent on armes, é la tate
des Phthiens, aux cétés des Béotions » (Mazon} ; ef. Schwyzer-Debrunnor, p. 48%.
En A 51, Leaf adopte la variante yet’ et entend « avec les cavaliers », mais, je crois,
a tort. Hn P 149, Zénodote lit 28" pthoo pour pet Bpoov,
420 “CHAPITRE VIIt
Il apparait nettement que l’emploi de werk accompagné du génitif,
qui a connu en attique une si grande fortune, ne fait que débuter chez
Homére dans des conditions trés préceires.
§ 170. La préposition mapé, qui est peut-étre étymologiquement
-apparentée a repl, a joué un grand réle chez Homére et durant tonte.
Vhistoire du grec!. Elle exprime Pidée de proximité et se trouve ainsi
en concurrence avec npés. .
Le sens adverbial est fréquent chez Homére : pour l’emploi dans
des phrases nominales, cf. { 43 mip ror 58¢ et voir § 3. Comme
adverbe de lieu : A 614 Bv0x xaBet3” dvaidc, nape 8% yousdOpoves “Hp ;
of. B 279, T 135, A 634, ¥ 359, 2 720. Il arrive qu'une forme casuelle
se trouve non loin de rap’ et. que le tour adverbial annonce le tour pré-
positionne) : ¥ 160 napé 8° of rayot Kups pevdvrov « que les chefs restent
auprés de nous ».
hapa ’omploie parfois a cété d’un autre adverbe dans Miiade :
463 wap’ abe; — ¥ 147 map’ are,
§ 171. C'est surtout en Jiaigon avec certains verbes que napd 8’em-
ploie volontiers, prenant ainsi la valeur de préverbe : F 440 mipa yep
Grol slo: ; — E 369 raps. 8’ dpBptovov Bdrev elSap ; — en © 504 mapa 83 agit
Birr Badfy, oprol doit étre un datif d'intérét et nepd joint a Bdrer0,
mais on observe ’amorce de la construction prépositionnelle ; — I 470
rapa voxtas lavov (0 vixtag ne dépend pas de napt) ; —- K 75 napa 8° &-
rea mould’ Exerva, — A 517 m&p Bt Mayday | Baive; — T 316 mapd Sein-
voy Honxag; — 138, etc... maph 88 Eeoviy étdvucce tpanetav; — » 82
vija raps yraquphy lhivere (ol via n’est pas complément de rapt).
Le rapport du préverbe avec le-verbe est surtout sensible lorsqu’il
Ten est séparé que par un ow quelques mots : ¥ 50 mapé te oyeiv; —
y 469 nap 8 ... ov; — E112 m&p 88 otic ; etc... Ainsi Se sont constitués
des « composés » : mipsoms (E 80, ete...), mupubarddpevos (1 322), rapéxerro
(2.476), nupaatée (B 189, etc...), mapéOnne (a 139, etc...), maphpevoc (A424,
ete...).
TIupa a pris le sens de « 4 cété, en manquant Ie but »: A233 = N 605
upat 8é of xpéer’ Exyos.
Des l’époque homérique, mae a servi a exprimer l’idée de persuader
et de tromper : & 488 mupd p? Frage Suluav (cf, E 360 napymagev) ; —
de mémé avec des « composés » de neto, napéncicev (H 120, N 788,
W606), mapacrentOnet (y 213); — ou de elwov : mapetry (A 555), nupetrdv
(2 62, H 124, 4793, eto...). — Noter encore avec le génitif (ef. § 476) :
+ 187 mapanddyExox Marndy « quil'a détourné du Malée ».
J, Schwyzer-Debrunner, p. 491; Rau, Curt. Stud, 8 (1870) 4p. 4-98.
‘PREPOSITIONS ET PREVERBES =~ » 424
Avec des’ verbes de mouvement, nap exprime Vidée de « passer,
dépasser » : mapepyopévyy (w 357), raphA0e (6 230, en parlant d’un cou-
Teur qui dépasse un concurrent), naphracav (¥ 638), etc...
§ £72. Comme préposition avec le datif-locatif, nap& a été employé au
gens de « 4 cdté, en compagnie de », aussi bien avec un complément
de chose qu’avec un complément de personne (ce dernier emploi étant.
seul courant dans le grec postérieur).
Noms de personnes : A 358 tut nape nazpl yépove. ; — A 367 map dé
ol tomjxer ; — E195 mupd 8€ agey dxdore Situyes tenor | dovtin ; — 1 556
xetro mapk vyoth ddéxep. —- Au sens de « chez » : 1 427 nap’ duu pévav
xaroncousnOhra; — N 176 vate 88 ndp Tord ; — N 627 dme) pidtecte
rap adth « puisque vous avez été tegus chez elle »; — 489 Gntev€-
pev Earp | devel wap’ doorhe + — 2175 9 ket ndp xetvoraw dudv yepac; —
« 154 > 6” Hts rapt pvyotipat dveyxn « qui chantait devant les pré-
tendants..
Noms de choses : A 26, ete... napd vyval xiyelo ; — B 775 map’ Epye-
ow... Eotacay ; — A 474 aqq. mag? Sx0 now Eyrdevres | yelvato ; — H 345 sqq.
&yoph yéver’... mapa Hprdporo Gipno.; — O 656 abrod 8& maps uoljow
Eyevay, :
Le datif s’observe avec des verbes signifiant « s’arréter » ou « 8’as-
seoir » ; M 353 oti 8 nap’ Aldvrecat xtdv (cf. P 707, ® 547); — A 405
rap Kpovtews xaéero (of. 2 100, etc...) ; — 9 153 8qq. xav’ dp’ Her? En’
eoyden, bv xovinar, | nap mpi; — 0 285 mp 8¢ of adrs | clos Geordspevov. —
En général avec des verbes impliquant un mouvement : © 249 mip d&
Auds Bupa... xdd6are vebpdv; — E411 ndp noot popvavévay dxvdvSero 5 —
N 617 née xooty atpartevta yaad mécov dy xovigaw, Mais Paccusatif 8 Pob-
serve égalenient en ce cas.
On emploie le datif au sens de « le long de » : B 773 map& pyypuiu
Qardoons... tépmovro (cf. § 449, 0 499); — Y 53 ndp Lyssever Gedy. Sur lace
cusatif en cet emploi, voir § 173.
Remarque, — Certains tours figurés qui se sont développés en attique
sont ignorés chez Homére, comme rag’ épol « & mes yeux », etc...
$173. Tlapd peut étre suivi d’un accusatif de direction, soit un nom
de personne, soit un nom de chose : « 285 (2:84) Lmipryy dt napd EavOdy
Mevéiaov ; — 5 143 ele wap’ “Heacatov ; — T° 406 foo nap’ attav lotion «va
prés de lui et assieds-toi » (cf. A 577 et opposer M 353, § 172) ; —H 190
voy pév.mdp 168? bby yapddic fdére.
En particulier avec les verbes signifiant « placer, s’asseoir », etc..
A 314 nap" tu’ loraso ; —~ p 414 ory 88 nap’ *Avehooy (of. 2 169) ; a 333,
etc... orf fa map araBpsv...; — 49 artic’ bcd udv ape tdqpov ; — Z 433
422 CHAPITRE Vill
Rady 88 oviooy map’ tpwwedy ; — 8 54 & far Opdvous eLovro map’ ’ArpetSyy Mevé-
daov; — 0 469 ec Opdvov Le nap’ "Adxtvoov (cf. » 145); — v 372 xaeLo-
weve tepiig mpd muBuev’ Baling; — v 122 nape mOpév' Brains... Ofc.
Nombreux exemples pour indiquer la région du corps ob un guerrier
a té blessé : A 100 mapé od Base Elper; — A525 obta 88 Bovpt map" du
paddy ; — E 146 xdni8a nap’ Syov | wangs «it le frappe & la clavicule pres
de P’épaule » (of. A 480, © 121, M 204, ete...).
* Crest Paccusatif d’extension que l’on observe dans les nombreux
exemples oi mapé exprime la notion d'une extension, d’un mouve-
ment le long de : A 327 B&ryy nape Oiv’ &dds (cf. A 34); — I’expression
fréquente mapé vijag semble toujours signifier « le long des vaisseaux »,
plutét qu’ « auprés des vaisseaux » : cf. © 220, etc... BH 8 lévar apd
te xholag xat yijas “Axoudiv. — Autres exemples : A 558 bvoc map” dpovpay
ty; — M 352 BH 28 Oeew mapd reixos ; — @ 206 of 6 Exe mip morapdy nepo-
Ghare; — A» 21 nupk pbev ‘Qxeavoio | joey (opposer B 773, Y 53, § 172,
ot Pextension est moins nett&ment marquée par le datif-locatif).
§ 174. L’accusatif d’extension s’emploie méme lorsque aucune idée
de mouvement n’est impliquée : A 487 xcirar notapoto nap’ by8a¢ ; —
32 xoyrhoowto napk mpvyvfoix vis; — © 337 SdvOoro nap’ Byaz | Sév-
Spex xaie; — Z 34 vale 36 Larnsevros... mup’ 8x8ae | Uy8xoov; — M 313
rhyewog vepsusata ubya BivBow map’ Bx0ag; — de méme : . 46 more Be
LFfAa | topatev rape Sive (ef. £ 347); — B 522 map rompdv... tvonov; —
T' 272 nap Elpeoc... xotaeov... dopro « était suspendu le long du fourreau ».
Finalement, xapé et laceusatif, méme sans qu’il y ait ni idée de
mouvement ni idée d’extension, a fini par signifier « la proximité » et
s’est ainsi trouvé trés proche de mpd accompagné du datif.
Certains exemples permettent de voir comment cette syntaxe s’est
installée : ¢ 434 mp Opdvov éorhxer « il était debout pres du siége » (« il
était venu se mettre dabout », cf. p 444, ete... § 173); — £523 sol 8
reap’ wbtby | GvSpec xoyshaavto « auprés d’Ulysse ils viennent dormir ».
En quelques formules, l'accusatif semble étre purement et simple-
ment l’équivalent du datif : A 463 = y 460 véor 38 mug’ abrdv Exo meprad-
Gora xepoty « de jeunes hommes prés de lui tenaient dans leurs mains
des broches & cing branches »; — x 127 dxpétetoy 3 nap’ ob8dv Lvate-
tos peytpow | Fv 63%... « prés du seuil ».
Pour exprimer la proximité, le datif et Paccusatif ont été employés,
celui-ci exprimant en particulier soit la direction soit extension.
Mais Paccusatif en tendance 4 s’étendre aux dépens du datif.
§ 175. L'accusatif avec napa s’est employé a l'occasion pour expri-
mer un mouvement qui, dépasse un point donné : A 166-167 of 3 map”
4, Pour A 34, avis différent de Schwyzer-Debrunnor, p. 495,
PREPOSITIONS ET PREVERBES 423
"Thou ofa... | ... map’ epwedv doozdovro « ils dépassaient le tombeau
@’Tlos, le figuier » (cf. X 145); — Z 42 mupé rpbyov Heoniricdy « il a
roulé au dela @» Ja rove »; — Tl 311 ofza Odavre | orépvoy youvabévra
nag’ darlfa « il a bleasé Thoas, dont la poitrine s’est découverte en
dehors du bouclier »,
Remargue. — Linterprétatioa ‘de quelques exemples peut étre incer-
tajne : w 44, il faut probablement entendre « au dela du cours de
POcéan, le rocher de Leucade et lee portes du Soleil », mais on peut
comprendre aussi « le long de ».
Le sens figuré qui connaitra une grande fortune dans le grec pos-
térieur n’est attesté qu’en teux passages : N 787 mdp Bivepw « au-des-
sus de ses forces »; — & 509 napd yotpav « au dela de ce qu’il faut »,
c’est-a-dire contrairement & ce qui se doit (ce seus se retrouve dans
le composé nupaimoc, A 381).
§ 176. Mage s’est également employé avec un génitif-ablatif mar-
quant Vorigine. La préposition se distingue des autres prépositions
marquant l’origine, parce qu'elle signifie non « de », majs « venant. du
cété de » Les formules homériques gui comportent Je géniti{ d’ori-
gine avec nape sont assez peu variées. Toutefois, elles s'emploient aussi
bien avee des compléments de lieu qu’avec des eompléments de per-
sonne (tandis que, dans le gree postérieur. napa et le génitif se trouvent.
presque uniquement attestés avec des noms de personnes).
Le sens originel de la préposition s’observe bien, par exemple. en
A 488 (rxevups) nap" dan(80g tkegadvOy « son cOté est apparu du long
de son bouclier »; — A 500 (@d2e) nap" Irmay dxedev «il Va atteint
avec un trait, du long de son char rapide? », De méme encore ]’ex-
pression assez fréquente (A 190, 11 473, ® 173, + 300, x 126, 294, 324,
439, 535, 2 24, 48, 231) mapé unpod signifie « du long de la cujase »; cf.
A190 4 6 ye edoyavoy 0&8 Epvocdpevas Tapd Uypol...
De ce sens, la préposition est passée & la valeur plus vague de
«-venant du cdté de » : x 197 Apryévere map’ “Qeeovolo podiov | Avjoe dvep-
youévn. — Mais elle finit par équivaloir purement et simplement a « ve-
nant de ». Nombreux exemples de mapa vnéc (y 434, etc...), mapd vndiv
(M 114, ete...); — avec un verbe signifiant « prendre » ; T 143 tpi
raph vndc Ehévtes; — avec un verbe signifiant « crier » : A 603 ofey-
Edueves mapa vnc.
Remarque. — Sur la valeur de génitif de vagy, dans napa vig
(M 225, ete...), of. 1, p. 238.
1, Telle est lexplication de Monro et de la scholie T. Mais on rapproché aussi le
complément de ’AdvddSev, of Yon suppose que se trouvaient des haras : « qui venait
d’Abydos, ot i gardait les cavales rapides » ; cf. scholies A
t24 CHAPITRE ViiT
§ 177. Signifiant « d’auprés de », naps s’est volontiers employé avec
des noms de personnes : A 4 "Habe 3° &x Aeyéwv nag’ &yauci TeBwvoio | de-
voto « Aurore sortant du lit, quittant le glorieux Tithonos... »; — B 596
Olyarlyfer lévra nap’ Edpirou Otyadioc « de. chez Eurytos »; -- B 787
Fae... map Audc... (cf. O 134, etc...). — Noter O 5 kypera 8? Zets | ... nap
xpvaobpévou “Hone | ari 8 dp’ dvatEac « Zeus s’éveille d’auprés d’Héra, il
bondit et se lve ».
Au sens de « de la part de », avec des verbes comme ¢épa, etc... :
ZAT717 yapbpoto nape Mpolroro gépovto (cf. © 437, 617) ; — § 452 nap 8 dpa
pw Tagloy mplaro ; —~% 290 rayne nape matpds.
L’emploi qui s'est développé plus tard avec les ’verbes comme
dxode, uavOive, etc..., ne s’observe pas. Le cas le plus proche est A 795
xa wwe of mite Zavds tmbppade morwa untip.
‘On salt qu’en poésie mapé et le génitif sont presque devenus I’équi-
yelent d’un complément du.verbe passif. Cet usage est annoncé par
G 122 mip Aide sBavdroun yérog xal wivic Endy Oy.
Liemploi homerique du génitif avec nap& est moins étendu que
dans le grec postérieur, en particulier aux sens dérivés. En revanche,
la valeur coneréte originelle est bien conservée dans certaines for-
mules, en partioulier par xap& ynpod (§ 176).
§ 178. Tlept, qui doit étre étymologiquement apparenté a napd, mépa.,
etc..., peut signifier originellement « jusqu’au bout, tout autour, tout
a fait » et se distingue ainsi de dupt « des deux cétés! ». Toutefois, les
deux mots se sont trouvés en concurrence. Leurs sens et leurs emplois
sont assez voisins, et en attique rep a ; —— meptetvar (a 248, etc...); — mepiBddrew (¥ 276); noter o 17
avee laccusatif nepiiddrer dnavras | uvnatipag Sdpuct « il Yemporte sur
tous les prétendants par ses dons »; -— odS¢ cl pot wepixertat « je
n’ai aucun avantage » (I 321). — Au sens de « tout a fait » : meptaGe-
véev (x 368) ; weplowe : K 247 nepiade vojoa ; — p 317 tyvem yap neerndy ;
— avec un complément de personne au génitif en y 244 et N 728 (cf.
§ 80). .
Au sens local de « tout autour » : mepi6adAoudvoug (x 148, nombreux
exemples ayee « tmése »); — nepryynoey (H 267) ; — mepiarnsay (A 532) ;
— mepceinevog (T 4); — mepimdeyBelg (E 343); -— neplopee (1 388); —
neplonavov (x 4); — meplovertas (8 277); — neptortper (e 303); — mept-
TeMopévav (B 551) et mepurropdrov énauray (a 16), 00 le sens d’achéve-
1, Schwyzer-Debrumner, p. 499 3qq.
PREPOSITIONS Et PREVERBES 425
ment est sensible ; — reptrpontiv (B 295) ; — repipiivar (wo 236) ; — mepi-
yeve (y 437, ete.
Pour expritier que l’on défend, que l’on combat pour un objet ou
une personite : neptGy (© 331), neployeo (A 393); — noter ¥ 485 colzo-
80g meprdGue8ov « parions un trépied » et } 78 éyébev ne Sdcoua « je mé
donnerai moi-méme pour garante ».
Enfin, dans des verbes qui expriment l’idée de « s’occuper de », « se
soucier de » : « 76 neprppateiyeda... | vdotov; —~ meprnyavdeveo (E 340) ;
— neprydoaro (I 449, & 266).
Remarque. — L’interprétation de certains composés peut étre incer-
taine. Ilepwdetdia est souvent interprété comme signifiant « craindre
vivemeat », mais il est peut-étre plus probable d’attribuer a wepl le
sens de « au sujet de»: avec le datif : A 508 ri ba mepid8ercay (ef.
O 123, P 242, @ 328, ¥ 822), — avec le génitil.: K 93 alviic yap Aw-
vadsy mepiSelBua ; of. P 240 véxvos nepideldta Terpéxiowo. —- Le sens de
« tout a fait » semblerait, toutefois, se recommander en N 52°rH St 8h
advécacov neprbeldia eh tt méOcopev, oi il est difficile de faire de =f, ad-
verbial, le complément de rept. Ajoutons qu’il n’est pas sir que,
dans tous ces passages, nous ayons affaire 4 de véritables composés ;
ef. §§ 181 et 183.
§ 180. L’emploi adverbial de zepl est bien attesté chez Homere,
soit dans des phrases nominales (cf. » 279, § 3), soit dans des phrases
verbales. Parfois au sens local de « tout autour » : [384 nepl 38 Tepat
Gg Fowv; — 16 wept ve wrbmog Abe modotw ; — T 362 ybacce 88 nica
rept Bev. .
Déja dans la langue épique, rept, du sens de « tout autour de 3, est
passé & celui de « tout a fait » et a fini par exprimer Pidée de supé-
riorité ; 7 95 = 8 325 xepl yéo ww dXupdv vréxe... « malheureux entre
tous »; — 7 112 = 8 202 mepl yrdv Oelerw caxdv H88 yaxnthy; — © 161 To-
Bet8y, mept yey ae slov Aavaot ; — 1 100 6 at xpi, mepl wiv pdr Enos 38”
inoxotoa «c'est pourquoi il te faut également bien parler et écouter »;
—— 5 549 nepl Gaia cérxro « c’était un prodige extraordinaire »;— 153
TuBetdy, mepl wav mohduer Ex xaptepés daar « tu es tout a fait fort... »5 ef.
encore A 257, H 289.
§ 181. Lorsque zept porte sur un verbe, la distinction entre un
emploi d’adverbe et un emploi de préverbe n’est pas facile 4 déter-
miner, ét, a la vérité, il n’y a pas lieu de marquer une séparation tran-
chée : N 727 obvexd sor nept (« plus qu’a tous ») daxe @xd¢ nokewhia Epya ;
— de méme § 116 & ol nepl Saixev *AOjyy (cf. encore 3 722) ; — B88 neph
xépdea oldzv n’est pas éloigné des « composés » de N 728, y 244, p 317; —
P 22 wept abévet Prcueaiver « if est tout enivré de sa force»; ef. 1 237, etc...
126 CHAPITRE VIN
Un passage comine ® 27 (cf. N 634) técyov tyes meph tr’ elut Oediv, mepi
v ely’ dvOpdnev « je Pemporte sur... », oW mept adverbial est suivi d’un
génitif de supériorité, annonce a la fois Ja construction préposition-
nelle (cf. § 186) et les composes du type replays (o 248, + 326) on nepr-
yeyvoum (¥ 318; € 102),
Au sens de « échappant a », megl porte certainement sur le verbe
en M 322 nédrsuov mepl t6v8e guydyre « échappant a cette bataille », ou
T 230 mort{ovo nept orvyepoto Altewvrei « survivent a cette bataille v. |
Certaines formules ne se laissent pas analyser de fagon certaine.
Ainsi avec les verbes signifiant « craindre ». K 240 Se.cev 3& rept Lard
Meveddp, nepl préposition, signtfie « au sujet de » (cf. Hymne 4 Her-
més 236). Mais, ailleurs, wept peut étre pris adverbialement au sens de
« tout a fait » : E 566 nepl yee Sle moe Aadw (cf. 1 433, A 557); —
P 242 Govov tu xepadf) nép Seldia (ou mepiBeldia); of. les composés
P 240, A 508, O 123, et § 179, Remarque. On a toutefois fait re-
marquer que le datif seul ne s’emploie pas avec les verbes signifiant
« craindre »,
§ 182. L’expression nepi xijp. pose un probléme comparable. Voici
les exemples : A 46 rdw yor nepl xjpt tiéoxero "TAtos te « entre toutes, la
sainte Ilion m’était trés chére »; — A 53 80’ &v vor dmeyBeoveme mepl x¥ipr 5
— 158 xeivos 8° ad nepi xijpr uaxkpratos eEoyov Aduv... « plus que tous
les autres » (ef. ¢ 36, » 69, 8 63, o 245, + 280, } 389, N 119, 206, 430,
2 61, 423, 435). Dans tous ces exemples, nepi est: adverbial et xi: est
locatif (cf. Yemaploi de xjpr seul.en EF 117).
On expliquera de la méme fagon quelques expressions avec Gvzé et
peat : & 433 mept yap geecly aloxua #87 (cf. B 88); — IT 157 rototv ve rept
gpeaty Zaneros dah; — © 65 rep 8° HOede Oous « il voulait A tout prix »
(ef. & 236) ; — X 70 daisacayre, mepl Guns ; — E146 wept ydp ur eplrer not
xhSero bund,
Toutefoia, il est possible que certaines formules (comme I 157)
aient évoqué A un moment donné V'idée d’un sentiment « qui entoure
et envahit le coour », C’est cette interprétation qui s’impose pour
A 89 oltov te yAuxepoio mapt gpévag tucpos alped « le désir de manger en-
vahit son coour »; — « 362 witdp énet Kixdrona Teel epévag Havdev olvog
« lorsque le vin a envahi le coeur du Cyclope »; — K 139 nept gpévac
Hl’ tos ¢ le cri envahit son coour » (cf. p 264).
Dans les plus anciennes formules avec xjpr, Svug, gpeat, on doit ad-
mettre le sens adverbial de « complétement ». Mais certaines expres-
sions comportent, plutét le sens de « tout autour », «en envahissant »,
et les deux systémes ont pu agir ]’un sur lautre. |
Comme Préposition, nepl s'est constrbit avec le datif, ’accusatif et
le génitif.
PREPOSITIONS ET PREVERBES 127
§ 183. Un graiid nombre de passages permettent d’observer com-
ment l’emploi prépositionnel s’est institué. Dans la formule x 261-262
mept uty Elpog dpyupdmpov | dpouv fadsuny, rept peut étre considéré goit
comme adverbe, soit, comme préverbe, soit, a la rigueur, comme pré-
position.
Le datif avec negt repose sur un ancien locatif, la préposition signi-
fiant « autour de »: A 17 xvnuitdag... mept xvhyjaw HOnxe; — N 241 86-
cero tebyen nad megi xpot (cf. o 60, @ 467); — B 416 ‘Exrdpeoy 88 yerdiva,
nepl orifeoo Satim; — K 24 &Suve mepl orfeon yrdive (cf. M AOA,
N 245) ; — B 389 repl 8° tyyer xetpa xepctron « i] fatiguera sa main au-
tour de sa javeline »; — a propos de blessures : A 303 ... tpwhoa mept
Soupt « (le sang) giclera tout autour de ma javeline »; — © 577 nepi
Sougl merapuéva ; — © 86 xvawSézevog mepl yorxg. En outre : £543 reph
oxaijias midqor (of. M 175, § 123); — A317 trrcoopém, reel xamv@; —
¥ 598 nepl- craysecow éépon « la rosée sur les épis »; — X 95 (Spdéxav)
EXtoaduevog mept xerfj ; etc... .
Tlept, comme dul, s’emploie, en particulier, avec le verbe faiva
pour décrire le mouvement que fait un guerrier autour d’un mort,
ou d'un blessé pour le protéger de l’ennemi (de méme duet, § 123) :
P 4 dugi 8 &p’ abre Baty’ Gc tug meal ndprana wimp... de mel Tarpdure
Bative EavOdc Mevédaoc; — P 133 torixer de aio te Mwy... nept téxcaar (cf.
encore P 437, 355, ete...).
C’est en partant de cet emploi que s'est développé I’usage de nepi
pour indiquer objet ou Penjeu pour lequel on combat : p 471 dvip nept
olor paryersuevor xredveoo: ; —- 11 568 ott mept mand! whys drods novos ety 3
— B 245 dvipdonr xal masdveoo. poryécouoba mepl Sarl « de se battre pour
un repas »,
De 1a est issu encore l’emploi de mept avec les verbes exprimant la
crainte : E566 megl yde dle rowéue Andy; — K 250 bSsrcev dé mept ExvS.
Mevedd (voir, toutefois, une autre interprétation, § 181); enfin P 22
epl oGével Brepevatver « il est tout enivré de sa force », lon attribuera
peut-étre & rept Je sens adverbial de « complétement » (ef. § 181).
Remarque. — En © 183, Eustathe et un manuscrit donnent la lecon
drlouévous neat xanv « tout étourdis par la fumée », of rept équivau-
drait & « dans, par », mais le reste de la tradition donne id xan ou
xanvoi.
§ 184. Avec mepl Paccusatif exprime d’abord Vextension « tout au
Jong de, tout autour de », avec ou sans mouvement : 3 368 (cf. 90) wept
vijooy dbpevor ; — X 162 nept epara... trwor | ... spwydior; — K 173 der
mépu... Biedcer...; —V 13 rept venpdv... Hace trrovg; — 2 42 mepl BéOpov
epatrav; — @ 519 Askactar mepl dore Oeoduhsay Ent mipyav; — avec des
verbes qui n’expriment pas un mouvement ; « 439 éuéunxov... mepl on-
128 CHAPITRE VIL
xobg; —~ E374 éoviwevar rept tolyov; — v 187 gorabres xept Baudv; —
avec le sens de « dans la région de » : B 757 of mep! Tinverdv,.. vaisoxov ; —
mais « avec mouvement » : B 750 mepi AwSdyvyy... obet? Eevro.
A propos de parties du corps : K 139 mepi gpévac v0 lod « le cri
envahit son coeur »; — ¢ 362 mepl gptvac HvOsy olves.
Au figuré, mept, suivi de l’accusatif, s'est employé pour désigner ce
dont on soccupe : 2 444 mepi Séemax... novéovro ; — 8 624 mepi Seimvov...
mévovto « ils s’affairaient 4 préparer le diner »; — O 555 xepl redye’
frovowy,.. « ils * agitent autour des armes... »; — I 408 nept xeivov bitve.
§ 185. Enfin le génitif est souvent employé avec nepi. Un grand
nombre de ces génitifs s’expliquent comme génitils partitifs et in-
diquent que I’on w’envisage qu’une portion limitée de Pobjet. Il n'y
guére que deux exemples du seng local : « 68 tetévuora rept onetous....
fweolc « la vigne courait tout autour de la caverne (sans Ja couvrir
tout entibre) »; — ¢ 130 ... todwoa nepl tpémtoc Bébudra « je Vai sanvé
quand i était 4 cheval sur la quille (sans Ja recouvrir entiérement) »;
mais cf. ¢ 371 le datif avec dugt.
Un emploi tres important de nepi avec le génitil, et qui se dévelop-
pera en prose, est de désigner ce pourquoi.l’on combat. Le sens a Pori-
gine est concret et if s’agissait en particulier de prix déposés au milieu
du cercle des assistants et qui doivent récompenser jes vainqueurs de
jeux : ¥ 659 mept cave « pour cet enjeu »; — A 700-701 mepl tplrodes
rap Euedov | OxboeoBzt.
Par extension pour désigner tout ce qui est ]’enjeu d’une lutte :
ZLGH mept mrdhée te wayhoera HBt yovarxdy (of. 7137, 11); — E195
Bqtbev rept Tatpésehoro Oavévros ; —~ P 120 met Turpéxroro Oavévros | omed-
oopev ; — tubvedar, qui peut étre accompagné du génitif seul (cf. §§ 67
et 78), est également employé avec rept et le génitif (ot le génitif se-
rait un vrai génitif) : M 142 dusvecOe. mepl yyy (ef. M 170, 243).
Quand c’est Ja vie qui est en jeu : x 245 mepl ve duyéwv tucyoves ; —
X 161 rept puyie Otov “Exropos (qui fait penser A A 700, cité plus haut).
Cette syntaxe s’observe également avec les notions d’inguiétude,
de souci, de crainte : I 449 madranl8og népr ydoouro (ou meptydeuto) ; —
TAT mepl Today wat "Aymdy uspunpiterg; — @ 249 dyos rept 1’ adrob xal
rept révreov; — P 240. véxvog népe BelBea (ou mepidetitx, of. § 179); —
mt 234 gévou mépr Bouredoauer.
L’objet d'une rivalité s’exprime par xept avec Je génitif : @ 225
Uplfeoxov wep! séEwy « au tir A I'are »; — O 284 éploceay nepl 2i0ev « ri-
valiser d’éloquence », — ¥ 437 tnevybusvot real vixens.
Le mot tpt; lui-méme peut étre employé comme complément? sui-
4, Schwyzer-Debrunner, p. 501, voitla un génitif-ablatif indiquact Porigine.
PREPOSITIONS ET PREVERBES 129
vant mepi : H 304 euapvactny gpdog mépt; — TT 476 ouvleny epr8og née (of.
¥ 253).
Enfin, un génitif avec xept s’emploie. aprés les verbes signifiant
« interroger, entendre, savoir », etc. «135 = 777 mepl marpds dro-
youévate Eporto ; — + 270 nepl véorou dixovan ; —~ 0 347 elm’ &ye wor mept un-
tpas...; — p 563 olSx ykp eb mept xslvov (cf. encore « 405, 4 194, p 374).
Tlepi et le génitif se trouvent ainsi en concurrence avec le génitif seul.
Cette syntaxe, qui illustre le développement des prépositions, est,
chez Homére, propre a l’Odyssée.
§ 186. La préposition nept avec le génitif a pris un développement
tout différent pour exprimer lidée de supériorité. En cette. fonction,
le génitif doit reposer sur un ancien ablatif de supériorité. [] n’est pas
facile de discerner les emplois ot xepl est un adverbe et ceux ob il est
vraiment devenu une préposition. .
I] arrive souvent que xepl se trouve éloigné du génitif (cf. .© 27,
§ 181) : P 174 mept ppévac Eupevor EXdov « Vemporter par lesprit sur les
autres »; — A 258 mepl utv Bovddy Aovadiv, mepl 8’ Zort udyeaa ; — H 289
mepl 8 Eyyer “Azardv géptardg toor, — Emploi de la préposition et de
Padverbe cdte a cote : ® 214 rept ev xparéerc mepi 8° alovda deters | dvipdav
« tu Pemportes sur les hommes par ta force et par tes méfaits »; —
« 66 sqq, &¢ mepl udv véov Zari Bporéiv rept 8° lp Oeoiaw | dOawkrotaw Bune.
Ailleurs, la construction prépositionnelle est, nette : A 287 rept mdv-
vov Eupevir Mwy; — A 375 mepi 3 drwy pact yevéebar; — avec un ad-
jectif prédicat : A 417 axtuopos... repl révrwy | Exdco; — & 566 Alnv yap
xparepds rept névre bot’ dvpcnev ; — p 388 yarendg meph mévtaw ele wns
chav; — avec un adjectif ou un substantif : 1 108 mept mévcov lpie¢
dBpaov ; — 8 231 Emardyevos mept mévraw | dvpdmav; —2 246 nepl miveov
xduuope pate; —- avec un verbe signifiant « honorer », etc... : E 325
rept méons | tiev dunroxtng; — 1 38 tenutoBat nepl mévrov; — ¥ 304 nepl
rkvray plato ratdev.
Remarque. — Les expressions du type nept ristaton, etc..., sont incon-
nues d’Homére. .
§ 187. Nous avons dit que les développements de regi et éugl sont
paralléles. Chez Homére, c’est souvent pour des raisons métriques
que l’on a choisi entre les deux particules : 2 564 dui 38 xavény xdme-
tov, mept 3° Epxoc Bacce ; — comparer aussi M 175 dug’ GAdjar... mAYoL
et © 453 wept Dxarfar mana; — de méme O 555 nepl... gxovor et 5 559,
ete... &uperov,
On s’explique aussi que les deux mots aient tendu a s’associer,
dul étant précisé par rept : 4 609 dul mepl ociBeoo « des deux cétés de
la poitrine et tout autour »; — B 305 dugt repli xphyay (cf. encore ¥ 191).
430 CHAPITRE VIII
—— Adverbialement : © 10 8y6a 8° dugl nepl wes’ taxov. — Coordon-
nées : P 760 nepi +” dpe te tdppov. —- En composition dans un tour
expressif : © 348 duqimeptotpespa « il faisait tourner en tous sens »; cf.
6 175. — Citons encore O 647 dygt... xovdByce mepl xpordpotst.
§ 188. La préposition’ xpé répond a skr. pra, lat. pro- et est appa-
rentée a npw-t, lat. pro, etc... Le sens originel en est « devant » dans le
domaine de l’espace, « avant » dans le domaine du temps.
Le mot ne s’observe pas dans des phrases nominales, mais s’emploie
comme adverbe. Au sens local, par opposition a ént : N 799-800 mpd pév
v GAN, adtip in’ Bra | de Tpsiec mpd wv Hor dpypdrec ata ex’ Kor
« (comme les vagues) les unes devant, les autres derritre, de méme les
Troyens, en rangs serrés, les uns devant, les autres derriére » (cf.
O 360, P 355); — T 149 (cf. 11 188) & 8° dynye mpd pdas 88 « il Pa fait
sortir et amené au jour ». — Au sens temporel « auparavant »: A 70
1a T dvta tk 1 doodpeva mpd 1” evra? ; — a 37 mp6 of elmouev.
Comme préverbe disjoint du verbe : A 195 mpd yap Fxe; cf. p 21,
A 208, 5 168, A 442, ete... :
Comme préverbe associé au verbe, au sens de « devant, en avant »:
mpobs6itc (N 18); mpobdare (A 458); mpdxeya (1 91); mporlOnu (Q 409)
et mpoftover (A 291), cf. I, p. 459, note ; npopépe (I 323) ; npoyéw (@ 219).
Ce qui implique parfois l'idée d’éloignement : xpoism (© 365);
mpotdnea (A 3); rpotnu: (B 752); rporetme (8 279); mporpéroum. (E 700) ;
mpogetyw (A 340). — Avec la notion de mettre au jour : mpopatves (u. 394).
Pour exprimer l’idée de préférence : npoééGovda (A 113) ; AOrvatov
mpoasreyuévor (N 689). Avec le sens temporel : mpovwée (E 526) « pré-
voir ». Enfin, avec Pidée que l’on place comme protection : A 156
Rpvathsas mpd Axadiv Towsi piyeobor « t’ayant placé devant les Achéens
pour lutter pour eux contre les Troyens ».
§ 189. Comme préposition au sens local de « devant » avec le génitif
(ablatif) : Z 80 dodv epuxdxere xpd mddwv (cf. E 789, K 126); — 0 354
Eptoum mpd Koreo¢ Auetépow (cf. Q 783, @ 468); — mpd wrddtog (T 292).
— Avec un complément de personne : A 373 odd mpd plrwv Erdpav...
ydyeo8u « se battre bien en avant de ses camarades »; — se dit du
guerrier qui poursuit : E 96 xpd g€ev xoviovre pddwyyas; — ou de la
troupe que l’on méne : N 693 mpd D@lav 38 MéSav; ef. encore Y 145,
+ 435,
Remarque. — A 382 npd S805 Eyévovto « ils avaient fait un grand bout
. de chemin », xpd est proche du sens adverbial et le gonitit peut étre
considéré comme partitif.
4. Schwyzer-Debrumer, p. 595.
2. Interprétation diférente el peu vraisemblable de Belardi, Maia, 3, 1950, p. 55.
PREPOSITIONS ET PREVERBES 134
§ 190. Du seria de « devant.», on est aisément passé 4 celui de’« pour
la défense de‘ > Q 215 xpd Tpedwv xat Tpauisov Babuxéariy | doraér”
« se dressart’ pour la défense des Troyens et des Troyennes.»; —
© 56-57, udyeoOa... mpd te nalBov xal mob yuvaxdv; — en X 110 mod x5-
dyes Signifie a la fois « devant ma cité » et « pour ma cité »; — A 156
wpoorhous mpd "Ayadv Tpaol' pdyeoba « {ayant placé devant les Achéens
“pour combattre contre les Troyens »; faut-il rapporter med Ayaudv a
mpoarhaas ou a pdyeoBar?
Certains emplois dérivés se sont développés : K 286 mpd *Ayaniv dyye-
dog fet « ayant les Achéens », ou plutdt « au nom des Achéens »; —
Q 734 dOrebev mpd kvaxtas « sous les yeux d’un maitre », d’oir « sous les
ordres d’un mattre »; — Vemploi le plus évolué est en P 667 xpd 96-
Goro Bop. Sylow Mow « en présence d’une pahique, par suite d’une
panique le laissent en proie 4 ’ennemi ».
Le sens temporel est rare chez Homeére : 0 524, p 476, ned yao ;
— K 224 npd & rob éwiyoe « l'autre, avant lui, voit » : le sens « au lieu
de » serait possible. Le sens attique « de préférence a » n’est pas homé-
rique. Sur ’emploi de formes en -f avec 7p4, voir I, p. 245-246,
§ 191, La préposition qui est en attique xpdc se présente chez
Homére sous les formes mori (éolien), xoti (éolien, forme différente
et qui remonte a l’indo-européen), npts (traitement phonétique ionien
de rport). De ces formes, c’est xpd¢ qui est le plus souvent attesté
dans la vulgate homérique, mais xpb¢ a pu parfois y étre substitué a
rot (apocope ou 6lision de xort) : voir 1, p. 108, n. 2, et Meillet, R. Be.
gr. XXXI, p. 303. Cette préposition, qui répond au skr. prati, av.
paiti, sernble signifier originellement « en face de, contre? ».
Comme les « prépositions » homériques, xpt< s’emploie aussi comme
adverbe et comme préverbe?. Les exemples d’emploi adverbial sont
nets, mais assez peu nombreux : « 255 npdc 8 dpa mSddov muhoxto
« 1a-dessus, il adapta un gouvernail ». — L’expression npc &8 a pris le
sens de « en outre »: E 307 npc 8 dupe dite tévovte ; —~ = 291 pds 3 Ere
nat 168 wetfov évt ppect Gixe Kpovlow; — sous la forme mort : K 108 nol
8 ab xul tyetpouey drovg (cl. TM 86). Cet emploi de npdc 8& a subsisté
dans Ja prose ionienne attique. -
§ 192. Comme préverbe (le préverbe pouvant étre disjoint du verbe),
. mpdg signifie « contre, vers » et s’emploie soit avec des verbes quin’im-
pliquent pas de mouvement : mpdoxeyn (£379); — soit avec des
1, Voir Schwyzer-Debrunner, p. 508, avec la bibliographie citée.
2. Pas d’exemple dans des phrases nominales. Fn = 396 olite ups séas0¢ ye
moti Bebuog...« le’ grondement du fou n’est pas aussi fort... », mot! pout peul-ttre
etre conservé et signifier que le grondement s'ajoute 4 la famma. On adopte généra-
lement nédec, qui vient de la tradition indirecte.
132 CHAPITRE VII
verbes impliquant un mouvement : mpécetys « approcher » (E 682);
rpootalws (E 620); npootetya (v 73) ; nposepedyoum. (O 624) 3 mpoctrexcro
(4 34); npoortivayon (v 95); mpoarticoopat (3 77); meocptoum (x 433);
— avec des verbes transitifs : mpocdya (p 446); mpoowrelpw (x 392);
mporidrtes (2 140); npooupaploxu (E 725); mpoohdada (H 421); ete...
Avec les verbes signifiant « voir » : montdépxoyat (IL 10); mpottéocopat
(y 34), Enfin, avec les verbes de « parole », nombreux exemples de
formes, comme mpootey (A 84, etc...); nposterxe (A 105, etc...);
npoontda (E 242, etc...) ; mposepdvee a 204, ete... i — de méme 4 143
mpotipvijaaa8at,
Remarques. — 1, Le préverbe indique parfois que Von est bien disposé
& quelque chose : mottdéypevog (8 186, etc...}, d’ot Pidée d’attente ;
dans nposapivew réside Pidée de « préter secours » (B 238) ou de
« persister & défendre » (E 439, If 509).
li. Les emplois de xpdg comme préverbe séparé du verbe sont
assez fréquents : E 682, etc..., 8 803, etc..., apd¢ pSBov Heure ; ete...
§ 193. Avec le datif locatif, xpt¢ exprime d’abord la proximité, le
contact sans mouvement impliqué : ¢ 329 muxwal 8& mpdg dAAANOL Exov-
en; — E425 npg xqvaty repbvy xatauiture yeipa dparhy; —e 401 ya Bh
Boimoy sxouse morl omAdSeo ; — © 434 mpdg mérpyot... | drvol dxéBpuodev ;
— 9 378 bpyelofny 8 Enevta mort yOovl ; — y 298 vids ye mot omAdBecow
taay ; — E 408 mort yotvan. narnd{oun. — Avec des verbes signifiant
« prendre, retenir », etc... : ¥ 4418 mport of 88 4x6° Evrepa « contre lui il a
rattrapé ses entrailles »; — ® 507 rhv 8 nport of | ele « il attire a lui»;
of, « 347; — TL 504 mport 8 pptves abr} éxoveo « le péricarde accroché
Je suivait ».
Avec Vindication d’un mouvement. En particulier aveo le verbe
Bdrrew : A 245 wort Be oxirpov Bare yaty (= B 80, cf. X 64, 2 423, ob
rot yaly doit se rattacher a BddAov}; — © 415 Bday ABaxt worl née (cf.
1 279, - 284). — En outre : A 112 naréOnxe tavvacdpevog moth yaln | &y-
wAlvag; — ¥ 420 Matépevar nott yaly « en s’effondrant sur le sol »; —
459 belvorte mpdg of8e ; — 0 190 morl yaly ternEav ; — + 289 nort yaly |
none’.
Le sens fréquent dans le grec postérieur de « en outre de » ne figure
que dans un passage de I'Odyssée : x 68 Sandy y’ Erxpol te xoxol, mpd¢
totol te 6xvoc.
Remarque. — En & 403, le texte présente une ditficulté : sécparrro mpc
“105 of 03° Egapxerte « il s’est tourné face a lui». La place de Pencli-
tique of semble indiquer qu°il ne peut dépendre de nis
§ 194. Avec Paccusatif, [a préposition exprime le plus souvent un
mouvement vers un lieu : A 420 dlp? adth npds "Omen; — 6 288
PREPOSITIONS ET PREVERBES 433
mpde Sdper’ tiv — N 538 npotl dovv gépov; — Il 45 cdoansev mpori dove
veisy dine ; —- 3-4 meeBlov 8° eBteoxe | npde nor ;—] 146-147 dyéateo | meds
olxov EyAyjos. — Nombreux exemples avec 8dya, Soyara, or. — En
outre : 8374 bimracxe noth végex | — « 147 xudv8dueve mpotl yépoov; —
u 71 Bddev weydrag most métpac (A opposer aux exemples du datif en
A 245, ete..., § 193); — © 364 wWaleone tpde odpavdv.
Avec les verbes exprimant l’idée de « placer, appuyer contre » :
X 112 Sédpv.., mpd tetyo¢ epelans (cf. 6 66); — « 127 Larne pdpenv mpdg xlova.
waxpiy (ou le complément se rapporte A tornoe); — © 435 dpuata 8
Bodwav wpds evdmea ; — 8 342 mort rotyov denpéves , — a 102-103 mol Ep-
xiov adriig | eloev dvexdlvag ; — 6 395 npdc yoive xabdtero,
Avec les verbes signifiant « regarder », etc... + 244 modg thy (o-
wey; — B 233 namralvours tpd¢ hepoerdta rétpny.
Avec les verbes signifiant « parler », etc..., et un complément de
personne : 8 620, etc..., T 155, étc... mpdc ddadroug... kydpevov; ~ X 98,
etc... etme mpde Bv ueyadtropa Oops; — m 151 mabe paycten etnetv; —
© B31 cuoce 8b mpde Ey? adrév; — d’oi : Z 235 npdg Tudet8yv ArophSex
vedye’ dperée « il échangeait ses armes avec Dioméde ».
Avec le sens hostile de « contre » : P 474 mpd¢ Teac udyent ; — A pro-
pos d’une blessure : A 108 PeGatner npd¢ ori Gog. — C’est également a
cette signification que se rapportent des tours comme © 303 yosvar’
era | rede Aéov dlooovres « tandis qu’il lutte avec le flux »; — P 98
meds Bulova « contre la yolonté divine >.
La préposition au sens de « tourné vers » s’ést employée avec des
verbes comportant nettement la valeur de position immobile : A 622
ovdvte ott xvorhy « se tenant debout contre le vent 95 — b 90 mpd
ulova paxphy | toto. — D’ot, pour indiquer une situation : + 26 xetrat |
pig Cégov « elle est située vers le couchant »; — v 240-241 dao vatover
mpdg ha F HErdy te | 48" Sao uerdmae mort Copov hepdevea.
Un seul exemple d’un sens temporel dans |’Odyssée : p 191 mori to-
repa dlyrov torar « vers le soir il fera plus froid ». .
Aucun exemple des sens figurés « en considération de, d’aprés,
selon », qui sont postérieurs.
§ 195. Les emplois de xpdx avec le génitif ne sont pas trés nombreux,
mais ils posent des problémes.-
La preposition (qu’il faille voir dans le génitif un véritable génitif
ou un génitif-ablatif) signifie au sens local « venant de » el marque
Porigine : 0 29 48 npd< Holav } Eoneplav dvOpdrav « qu'il arrive des
peuples de l’aurore ou de ceux du couchant ». Mais, en partant de
tours de ce type, of a utilisé nade et Je génitif pour exprimer une orien-
tation (au lieu de l’accusatif qui est exceptionnel, cf. § £94) : p 347 va-
coist npdg “HAtdos « les files qui sont tournées vers |’Elide »; — X 198
434 _ CHAPITRE vil
aids 88 noth mréhia¢ never’ atel «il volait toujours Jui-méme du eété de
la ville »; — de méme, K 428 nods... dddg ; — K 430 mpdg Odpbong 5 —
O 670 nde vndv, — Un exemple comme X 198 a pu faire penser qu’il
sagissait 1a d’un génitif de but. I] est plus probable qu’il s’agit d'une
extension du génitif d’origine. Cf. en francais « du eété de », En
v 110-111 (S60 Gipa) al piv pbc Bopéao... |, af 8’ ad mpd vérou, cette syn-
taxe se trouve attestée pour désigner des points cardinaux, usage fré+
quent plus tard, chez Hérodote, par exemple.
§ 196. Avec des compléments de personne, xpd; indique nettement
Vorigine : A 160 tiaty dpvouevor... | pig Tea (cf. TL 85) ; — 2 302 nods
Znvdg tyovtes, etc... Avec le verbe dxobo : Z 524 altaye’ dxobo | pds
Tpdev. Avec des verbes passifs : A 831 npott... “AytdAyjog dadiSdyGan ; —
Z 57 dpora menolnta xatk olxov | mpi Tpdav. Parfois dépendant de
substantifs ou des adjectifs : 0 162 tuheaox.., | ... mpde méordg; —
X 514 mpdg Tpwwv xat Tpardduv xdtoc.
Un sens voisin de « au nom de, sous les ordres de » s’observe dans
quelques exemples : A 239 of te Oéutotas | mpdg Atdc elptara « ceux qui,
au nom de Zeus, maintiennent le droit »; — Z 456 mpdg &Ams lordv
Spalvors « tu tisserais Ja toile aux ordres d’une autre ». L’exemple ¢ 207
mpdc yee Ards elawv dravreg | Eeivoi te nrwyoi te « les hétes et les men-
diants viennent de Zeus » montre l’origine du tour.
Enfin, c’est encore par Je sens d’origine que s’expliquent certains
emplois particuliers de la préposition. Elle signifie « en présence de »,
en indiquant que telle ou telle personne, se trouve ainsi participer A
un acte solennel : A 339 udprpor Fotoy | xpdg te Gedy paxdpwv mde te
Bvntéw évOpcsrov « qu’ils me soient témoins devant les dieux immortels,
devant les hommes mortels »; — T 188 038° émopxhow mpbg Saiwovas « et
je ne serai pas parjure en invoquant le nom d’un dieu ».
D’oi, dans Jes supplications', le sens de « au nom de »- v 324 mpd¢
raps youvitouat ; 4 67 vév 3 o vév Smbev yourdLouar od napedvrar | mpds
v dddyou xal natpds « je te supplie au nom de ceux que ty as laissés
derriére toi, de ta femme, de ton pére » (dans cet exemple, on observe
que le groupe ra&v Smfer:.. ne dépend pas de mpéc):
Dans tous les emplois de mpiz avec le génitif, il est malaisé de dis-
cerner ce qui vient de|’ « ablatif » ou du,génitif proprement dit.
§ 197. Zev n’est accompagné que du seul datif (instrumental). Son
doublet &4v (cf. wetaEs?) doit étre la forme la plus ancienne, dont ov
est issu-pour des raisons de phonétique syntactique. Cette préposition 2,
4. Voir Sehwyzer-Debrunner, p. 516, ef ta bibliographie citée.
2. Schwyzer-Dehrunner, p. 487, et la bibliographie, notamment Tycho Mommsen,
cite, p.115, 0.4,
PREPOSITIONS ET PREVERBES 135
s’appliquant 4 des personnes, exprime le fait d’accompagner, s’ap-
pliquant a des choses, elle-indique les objets ou les circonstances qui
accompagnent laction.
Dans quelques formules homériques, elle se trouve encore trés
proche de l'emploi adverbial : x 42 xeveds obv yeipas dyovres « n’ayant,
ef:méme temps, que les mains vides »; — K 224 ov te 80° Epyoutva
« quand deux hommes marchent ensemble » (si !’on rapprochait obv
de épyouévw, le sens serait « se rencontrer »). En ¥ 879 obv 3¢ mtepd
ruxve Maodev peut signifier « et en méme temps ses ailes touffues sont
tombées », ou plutét en faisaft porter obv sur le verbe « ses ailes sont
retombées sur Jui ». Cf. aussi 1 429, si on lit odv tpetc alvduevos ; 0 590;
x 436 ; @ 387 (cf. M. Leumann, Hom. Worter, p. 73 sqq.).
Xv est assez fréquent comme préverbe disjoint ou non du verbe.
Ul exprime l’idée d’un assemblage : y 189 obv a nédac... Séov; d’une ren-
contre, d’un heurt : A 447 ov 6° Sadov... (ef. © 61, M 181, 377, ete...);
H 256, ete... obv... Execov ; celle d’un mélange, d’une confusion : A 579
ov... Buetra tapdEn ; ¥ 467 obv 0° Spare dea ; ¥ 687 abv Bz... xeTpes Barx-
Oey ; au figuré : A 269 adv y’ bpm Eyever (of. 2 358).
On observe l'amorce de l’évolution vers le sens abstrait de « com-
plétement » : « 293, ete... civ 38... xéaudev « il enveloppa compléte-
ment »,
Les mémes sens s’observent lorsque Je préverbe est uni au verbe :
of. cvyxadée (B55), ovyyte (1 612), ovwdye (2.87), avvogive (A 332) ; ete...
§ 198. Comme préposition avec un complément au datif désignant
une personne, « avec » ; A 227 lévar abv dprorheacw “Ayardv (of. A 307,
325, T 206, Z 372, A 140, « 362, 8 183, ¢ 260, x 268, etc...). En ce
sens, adv se trouve en concurrence avec dus.
=ov exprime volontiers la nuance de « avec l’aide de », « avec le
secours de »: P 439 &acnzev abv *AQhyn ; — A 792 adv datuove; — 0 430
réupov d¢ pe abv ye Oeotaw « conduis-moi avec la protection des dieux »;
— 149 ov yap be ed#Povfyev « nous sommes venus avec lappui de
la divinité »,
Avec un complément désignant un objet, dans des formules ov le
sens de « avec J'aide de » est parfois sensible : A 179 otead’ idv atv vyvat
te fg eat cots érdporat ; — A 183 atv vni 7’ enj xt Evots expan (cf. A389,
E 641, 1 328, y 323, etc...); — E 219 ov trnovow xal Syeape | dvribiny
20dvte (cf. A 297, etc...).
D’ objets, d’armures, ou d’armes que l’on aen main : E 220 own &vreot
merpyGiver ; — N 719 abv évreat Sadarsover | edovevto 3 — 2.418... ww xereune
abv Eveot; — A 419 odv tebysow dato yauite (cf. 1 80, ete...); — B47
aby 16 (ochatpep) En nade vijas ; — O 541 oti 8 edpde atv Soupi Andy (cf.
A 251, ete...); — Y 493 Oive obv Eyyet; ete... ~
136 CHAPITRE VID
Avec le pronom airés : abth obv odpueyyt (I 194); — ait abv midmpee
(E 498) ; — ated abv ve iveo nal phyer (v 118). En ce cas, l’attique em-
ploie plutét le datif sans atv.
Sans qu’il s’agisse d’objet : B 786 sqq. Tpwalv. 8° &yyshog HA0e... adv
Gy yerly Deyews ; — a 193 odv weydnn Sper Exrhaw korn, — De mame
E151 ob abrag woOhoouat, dd obv dpmeas — A 164 obv ce peyd re drcére-
oav « et Jes coupables paient leur dette avec un gros intérét ».
Xuv, concurrencé par pete (qui, chez Homére, ne signifie pas « avec »),
a peu a peu disparu de la prose attique.
§ 199. La préposition! snép (cf. skr. upari, Jat. s-uper, etc...) est
apparentée a iné, avec qui elle constitue un couple. Elle signifie ori-
ginellement « au-dessus de ». Elle ne s’emploie pas comme adyerbe
chez Homére et n’admet pas la tmase. En revanche, elle est associée
comme préverbe avec quelques verbes,
Avec des verbes de mouvement au sens de « au-dessus de, av dela
de »: Sepddopat (E 138) ; brepatve (M 469) ; Srepidarw (¥ 843); Snep-
Opeaxe (M53) ; Smepéxe (B 426) ; Grephoe de orepinue (0 198) ; omepixtat-
vovto (ib 3) ; drrexaraBalvn (N 50) « franchir pour descendre ».
§ 200. Employé comme préposition, Srp admet chez Homére I’ac-
cusatif et Je génitif.
Laccusatif présente le sens attendu d’extension : ¥ 227 bretp da
xbBvara hdg « Paurore se répand sur [a mer »; — Q 12-13 od8¢ pw Hadc |
patvoney Ayfeoxey bnelo dra +’ hidvac te; — y 72-73 drdiyate | old te Anto-
iipes Oreelp dra (of. 8172, . 254); — M 289 16 88 ceiyoc Smep mév Soimog
dedper; — 1 260 bmép péys Nateua Oadkoons.
Avec un verbe de mouvement, mais avec le sens d’ « au dela de »,
sans que la notion d’extension soit soulignée : E 16, I 478 srép Spov...
#00? exonxh (cf. K 373); — E 854 omtp Suytv; — x 279 bnép odxog; —
7, 135, v 63 imép odddv é6hoeto. — Au figuré « en dépassant, en vielant » :
T 59, Z 333, etc... orp aloav « contre la justice » (opposé a xat* aloav) ;
— ¥ 30, © 517 itp popov (mais B 155 brépuopa doit étre un composé
adverbial, cf. § 53, Remarque 111); — I 299, A 67, etc... Smép Spm.
D’ou P 327 Sd Oedv « contre la volonté des dieux ».
§ 201. ‘Yrép s’associe également avec un génitif qui, comme Je com-
plément du comparatif, doit étre un ancien ablatif?. Ce tour s’emploie
pour signifier « au-dessus de », sans que l’extension soit envisagée,
qu’il y ait mouvement ou non : B 20, etc... ori 8 &p’ Srp xepadijc ; —
C107 masdwv 8 bmep... xden Eyer; — 7 471 inde adhoc « Qu-dessus de la
1. Cf. Schwyzer-Debrunner, p. 518 sqq.
2, Cf., toutefois, Schwyzer-Debrunner, p. 520 et note 2.
PREPOSITIONS ET PREVERBES 137
ville » ; -~ 1406 vegéiny Zorqae Keoviaw | nds Grep yhapupiis ; — O 382 vnds
bntp tolywv « par-dessus les bordages d’une nef »; — Y 279, © 69 Eyxetn
8 dp’ Srtp vebtou avi yaly | tom « par-dessus son dos »; — p 575 tov 3
Snip ob8o% Bdvra (pour ces deux derniers exemples, cf. § 200, la concur-
rence de l’accusatif).
Pour indiquer 'emplacement d’une blessure : A 528 Bare Sovpl | oxtp-
vov Snip patoio (cf. E 145, O 433, ete...). — Avec lindication d’une me-
sure : ¥ 327 dcov 1° 8pyur’ np atng « A la distance d’une brasse environ
au-dessus du sol ». Par extension dans deux exemples de l’Odyssée «au
dela de »: v 257 énép mévtov ; — E 300 bmp Kpyryg «au dela de la Crate ».
Dans un emploi figuré, on est passé du sens de « au-dessus de » A
celui de « pour la défense de » : H 449 tetyog ererylooavro vetv Orep ; —
A 444 Sxarbutny pbb brép Aavativ; — Z 524 80° Sndp offer alae’ dxobe
«lorsque pour toi j’entends des outrages » (inép ne signifie pas ici « au
sujet de x).
Enfin, énép, de « pour la défense de », est passé au sens de « au nom
de » avec les verbes signifiant « supplier » : © 466 xai ww Ontp narod
xal pytépog juxdpoto | Atsceo « supplie-le au nom de son pére, de sa mére
aux beaux cheveux... » (ef. O 660, 665, X 338, o 261). Ce dernier em-
ploi n’a gnére subsisté en prose ionien-attique, qui a, en revanche,
développé d’autres sens dérivés « A la place de », « au sujet de ».
§ 202. La signification’ originelle de ind (cf. skr. upa, ete...) se
définit par opposition a Snép : Snép est avec Sxd dans le méme rapport
que lat. super avec sub.
Comme adverbe et comme préverbe, d’abord au sens de « en des-
sous » : 8 636 od 3° hulover « et sous elles des mules »; — A579, & 69,
ete... (of. E 3A, etc...) dmd yobver’ Buse; — 270 bed youwer? edyve ; —
K 390 tnd 8° Expeve yuia (cf. T 34); — A 635 Siw 8° bmd muOpdvec Foon;
— 6 436 bnd 88 Edda Satov; — A 486 bmd 8° Eppatw... tawooav; — $ 204
capay 8 Gro mOue’; — a 130 Sd Atta merdcous; — E 375 bnd xbera
bxdoro mOpin Ofxe,
Nombreux composés (le préverbe pouvant étre, a occasion, dis-
joint du verbe) : éxetvaa (I 204) ; srocattew (1 385) ; Srodeineobar (¥ 615) ;
Sropévery (x 232) ; drootevayitew (B 781). — Avec des verbes de mouve-
ment « mettre sous, aller sous », ete... : Sméyew (€ 73, etc...) ; Snéyew
(E 269); bréeyero (N 366, 368) « se charger de, promettre »; inépyec-
Oe. (e 476) ; bpuévan (A ABA) ; Srodseatan (3 435) 3 dnéBpaue (@ 68) ; buéyeve
(E 49); Stepvmyoxe « il baisse la téte » (X 491) ; tnonerendres (B 312);
ete...
1. Schwyzer-Debrunner, p. 522, avec la bibliographic citée, et notamment J, La
Roche, Zeitschrift f. d. dsterr, Gymn, 12 (1861), p. 337-377,
438 CHAPITRE VIII
D’une maniére générale, x s'est prété a souligner l’'amorce d’un
procés. D’ou des verbes comme Srofeldia, bro8etoas : A 406 tiv xal Smé5-
Sercav pdxapes Geoi « les Bienheureux a sa vue prirent peur »; — E 524
ove Blag Today bsBelBiow ote loxic; — Smoxvoapévy (Z 26, ete...) ; —
Y 28 pv... Snotpopsecnoy Spiiyres (cf. X 241); — x 38 Ccovrog Swepvdaate
qrvatixa; — H 144 brrogbitg | Boupt ulow mepdvncev ; — 0 174 viv... Srogfa-
pévn dre uoOov. — Dans une expression causative : « 321 Safevyoty te
& naps; — 8 113, etc... bp’ trepov dpce ydovo.
Remarques. — 1. Dans quelques exemples, le préverbe semble apporter
la nuance de « un peu, peu a peu ». C’est peut-étre le cas de IT 333
nay 8 GrebeppdrOn Elpoc atyarr; — 1 126 erepar 8° Gromepxdtouer
« d'autres (grappes| se mettent a rougir peu a peu ».
II. Le sens de « en cachette » que l’on attribue parfois & ind dans
certains des verbes que nous venons d’étudier ne semblerait attesté
chez Homére qu’en 5 513, oft Sro%aphscovro peut signifier « ils s*ar-
maient en secret »; ou « ils se mettaient a s’armer »? .
§ 203. Avec un complément dépendant du verbe, sm exprime
Pidée de ¢ de dessous », « de », en particulier avec des verbes signifiant
«se dérober, échapper a >: M113 = ¢ 332 6md scfpag @ukev (cf. N 395,
etc...) ;—- 1 17 guydv bro vydeds uap (cf. X 200). De méme! : Sratoow
(B 310, © 126) ; Snadedeabar (0275) ; Snepénrew (@ 271) ; brepaety (0 122);
— noter T 217 trai 3 tWeoxe « il-regardait par en dessous » (cf. la note
de Leaf); rapprocher de cette expression l’adverbe inédpx ; en outre :
dpapety (B 154); bpéaxew (E 477); onodsew, au sens de « dételer »
(¥ 513 6 & Buev 69° fxmouc) ; snorgety (O 636) ; Smoetxew (IT 305); dmogé-
pew (E 885); broxepety (Z 107, ete...); ef. encore A 497 ond 8 Tpdes
xexddovro,
Le préverbe s'est prété a souligner la notion de « se tourner vers »:
E-505 tnd 8 Eorpepov jwmoxyec « les cochers se tournaient pour faire
face » {A 446 Ssnootpébac équivaut au petaorpepSévr. du vers suivant) ;
tmavrdtew (Z 17); sraxotew « écouter » (E 485, ef. @ 4); 666402
« prendre fa parole » (T 80); Sroxpiveotu. « répondre » (H 407, ete...).
Certains passages sont d’interprétation malaisée et il semble qu’avec
quelques verbes exprimant un « son », Je sens de « en méme temps »,
attesté dans le grec postérieur, appgraisse.chez Homére’: A 417 =
M 149 Snai 88 te xdurog Sdévrav | yiveta « et en méme temps on entend
un bruit de dents » (trad. Mazon : « en sourdine ») ; — © 570 alvov 8 bd
xaddy Kea8e « et en méme temps... il chantait », ou «il se mettait a chan-
ter »; — 0380 nordic 8 bmd xdunog dace « et en méme temps... », mais
bx8, joint a dpaéper, peut noter seulement Ja naissance du bruit; —
1, Sur le préverbe double imix qui se rattache aussi 2 cette signification, voir § 216.
PREPOSITIONS ET PREVERBES 139
9 411 4 8 ind xariv dace « et la corde se mit en méme temps a chan-
ter » (cf. £ 570 avec l’imparfait) ; — m 10 no8av 3 Sd Boiimov dxodeo « et
en méme temps j’entends le bruit des pieds » (mais tnaxovew « éoou-
ter» en § 485). En plus d’un passage, |’établissement du texte ou son
interprétation peut préter a discussion : © 519, la tradition hésite
entre raol 8 Gn’ ddifoves Jouv et Aaol 8 droritovec. I] faut attacher
. peu dimportance a la coupe des mots, mais on peut entendre « les
hommes, a leurs pieds, étaient plus petits »; cf. § 118, avec la biblio-
graphie.
§ 204. Il est parfois malaisé de déterminer si nous avons affaire 4
une préposition ou a un préverbe. En 5 414, il s'agit bien d’un pré-
verbe : $nd 8¢ xvijua fdovro doatal « et sous lui s’agitaient ses jambes ».
Mais, dans une formule paralléle, 5nd devient prépositionnel : & 447
bd 8 duplnoror prsovta Svaxrt « elles s’agitaient pour étayer Je seigneur ».
En w 450 ndvrag ind yrwpov Séo¢ fpet « la erainte Jes envahissaient
tous » (cf. A 421), ind est certainement préverbe ; c’est également un
préverbe, mais avec une signification différente en B 154 nd 8 fipeov
Epuara vadv « ils enlevaient de dessous les étais des vaisseaux » : vadv
doit étre rapproché de Eppare plutét que du verbe ou du préverbe.
Enfin, N 611 6 8 bn’ doni8oc etdeto xaxhy | dEivyv « il a tiré de dessous
le bouclier sa belle hache », ordre des mots tend a rapprocher $d de
dantdag.
Avec le verbe arevayiZw, on observe les emplois suivants : B 95 onb Bt
ovevaxiZero vat | Aadv Kévewv « la terre gémissait sous eux lorsque les
soldats s’asseyaient ». I] semble que $d est préverbe et ruin Kavrav
un génitif absolu; — B 781 -yaia 8° Greorevdgite Au de cepmmepative |
yuouéve « la terre gémissait sous lui comme sous Zeus lorsqu’il... »;
-— enfin, avec un emploi prépositionnel net : B 784 && Epa tav bnd
rooat ptya orevayitero vate,
En o 374 etxor 8 ind BaiA0g dpdtpe, il faut associer ind a elxor, plutét
qua dpérpe, et voir dans épdteep un veritable datif.
Enfin, dans la formule de 8 295 = Q 636 breve bro yhuxep tapre-
uefa, il n'est pas sOr que ind soit a rapprocher de txve; il semble
piutdét que ce soit un préverbe indiquant le commencement de T’ac-
tion.
* § 205. L’emploi du datif-locatif avec xd s’observe d’abord au sens
local « sous ». Avee des verbes qui n’impliquent pas de mouvement :
A 44 al yap Sm’ Hedkep nat obpavéd dareptevn | vaerdover; — B 306 &8o-
uev... | xadf bnd watavierp (ef, E558); — @ 443 $m moool yeyas mre
ulter’ "Oruzmog; — P 404 wdpvavro... | relyer oma Tpdov ; — & 533... mé-
apy mo yrapupi ebBov, Bopée in’ lay « dormaient sous un rocher creux
140 CHAPITRE VIIT
a Pabri de Borée » (mais Wackernagel, Bopéao lay) ; —- 8 153, etc... or’
éqpbat Sdxpuov el6ev. — Pour dire « au pied d’une montagne » : B 866 ind
Tudr yeyadrag ; cf. Z 396, etc... — En parlant d’un attelage : @ 402
yuidow pv opaw $9” Spuaow dxdac Unrouc.
Remarque. — En © 244 Ehuaav bq’ dpuaow dxéag trouve « ils ont dételé
les chevaux des chars », on attendrait le génitif-ablatif, mais le vers
ne pouvait admettre la forme dpudtav.
§ 206. Avec un verbe impliquant un mouvement : E 692 sqq. Lapr-
Bova../ | eToav bn’ alyidyoro Aids mepixaxrét pny; — I 378 bnd 8 don
pares | Emmtov; — B 4, ete... rocal 8° dnd Aumupotow eBijoaro nade méBLAA ;
— 2 644 Beyw’ br? alDoden Seuewns (cf. x 449); — © Al Sn” Byeagt crmboxero
yedubro8® temo ; — O14 énel CevEetev 59° &puaow dxtag trmoug (cf, 2782) ;
— 757 xal ond Sofvuw noalv Fue (cf. 240) : ond peut atre associé avec
fue aussi bien qu’avec moolv (qui pourrait étre un « datif proprement.
dit »); cf., d’autre part, « 131 bd 38 Opi rooly Fev.
§ 207. Un sens dérivé de « sous la direction, sous les ordres de »
svest développé : 1 156 xal of Sd oxhrtpp Mrapac teddover Odutorac (ef.
Z 159); — 9 68 dom... bx? dv8pdaw olxov tyouat ; — E 234 bo’ sudyo...
dpya | olcerov; — Z 171 BH... Oedv Sn’ dubuowe moury; — ens 114 (ef.
§ 211), la bonne legon est peut-étre Sn’ adc}.
D’ot Ie sens de « sous l’effet de », etc...., N 667 volom in” dpyarén
pOiabar ; — Tl 384 ds 8° bmd Aaltam nica xehawh PeEpibe xOdv « ainsi sous
la bourrasque toute la terre est écrasée »; — N 590 Opdoxwow... rath,
fmd dyn (ef. ¥ 215)? ; — v 82 dpunPévres bred mArnyfiow tudaOXys (Oppo-
ser © 414); — 2 136 yheg bro dunapg dpquévov ; — O 613 emcpyue udpar-
pov Fyap |... dnd TnrelBao Binge.
§ 208. L’emploi devient proche de celui de l’instrumental avec un
complément exprimant l’instrument ou « le bras » en particulier avec
Bapivar, ddoGon, mimtew et des formes passives : B 374 yepatv bq’ hueré-
pnow ddotot re mepboudvn te; — B 860 eBdun bmd xepal roBdxeog AlonlSa0 |
(cf. E 559, 564, K 310); — © 359 yepalv bn’ *Apyelov pOluevos; —
T 61-62 "Aymol 2388 Lov donetov od8ac | Susyevéwy Smd yepalv; — A 179-
180 Yxneoov trnev | ’AtpelBew dnd yepot; — w 96-97 pijouto duypdv Bre-
Opov | AlyleBov Snd xepat; — II 698 8qq. Tpolny Brav vleg "Axaudv | Ta~
zpdxdov bmd xepal ; — A 826 sqq. Rebdnuévor odtépevol te | yeooiv dnd Toda;
— X 65 trxopevas 88 wobs dro¥e Omd xepaiv "Ayaidv, — Avec un verbe
actif : T 351 sqq. S8¢ tloxobar... xat Eufic ind yepol Séuascov, mais Aris-
tarque lit Saivor. — De méme : TI 489 dderd te otevayov Smd yapyenAfior
1, Donné par un manuscrit, cf. Schwyzer-Debrunner, p. 525.
2, 8 402 nvory Smo Zegupao est proche du sens d’accompagnement.
PREPOSITIONS ET PREVERBES 144
Aovrog ; — E 653 éud 8 imd Bough Buuévra (ef. A 444); — II 708 af
Snd Soupl nod mépOm ; — T 436 br’ adtot Soupl Sayhne, bn’ va peut-étre
avec Sovel?, mais l’emploi de «ito surprend ; cf. § 211.
Avec un nom de personne comme complément : Z 453 év xovijat
résouev tn’ dvBpdot Suszevéecow « tomber sous les coups des ennemis »;
— N 98 bnd Tpcresor Sexutvar; — E 646 on? uot Sundévea (cf. A 309);
— 0 512-513 orpedyeotan ev alvy Smotiitt |... bm’ dv8edor yerporéporst, En
particulier avec des verbes signifiant « craindre » ou « fuir » : E 93
dnd Tudet8y... xrovéovto ; — H 129 mrdccovrac dq” “Extopt; — A 121 Sx’
*Apyeloar pé6ovto (cf. O 637).
C’est a cet emploi que se rattache, avec un verbe transitif, le tour
assez fréquemment employé pour dire « mettre au monde l'enfant
dun homme » : B 728 rév §’ Erexe ‘Phyy in’ Ou (cf. B 714, 742, 2 299,
etc...).
Le sens passif? apparait complétement en TI 490-491 &¢ md Tazpé-
wy Avxlov d&yd¢ domotdev | xtewdpevos pevéarve : toutefois, la valeur
concréte du tour est encore trés sensible et soulignée par l’emploi du
présent xreivdpevos.
§ 209. Avec le génitif qui peut continuer soit un véritable génitif,
soit un ancien ablatif, les emplois homériques apparaissent variés,
tantét avec une valeur locale concréte, tantét avec un sens plus
évolué.
Au sens local, ind signifie « sous » en exprimant le « contact »; il
s’agit la d’un génitif ancien et, dans quelques cas, cette origine est
sensible : A 501 Sn’ dvOepedivos trotou (cf. § 63 xdung fe); — I 372 bn’
dvBepedivos bysie tétaro tpvpadelng. — En particulier pour désigner lem-
placement d’une blessure : A 106 sqq. bd oxtpvore tuxhoas... BeBArner
meds orfdos; — E 493 bn’ dqpog ote; — P 617 why Bdn’ Snd yvaduoio
xa ofatog (cf. encore H 12, A 579, ¥ 875, otc..., mais Paccusatif,
§ 213). — De méme encore : ¢ 346 168 xpfSepvov bd otépvoio tavicom ;
— 1875 bd onoBot Hrucx; — © 14 fy Bdbratov ind yOovde dort BkpeBpov
(ef. 4 52).
Remarque. — En quelques passages, l’interprétation peut étre discu-
tee : TL 374-375 Git 8° déddn | oxi8vad’ Smb vepgev «en haut touchant
aux nuages se déployait un tourbillon de poussiére »; — O 624-625
(xia) Ak6pov ind veqdwv dvepotpepés « une vague qui s’éléve jusqu’aux
nuages » (scholie. B) ou « une vague nourrie des vents qui naissent des
1. En tout cas, 7 295 ced" bn’ Atyledoro 85h, il vaut peut-ttre mieux rapporter
umd A Alylctoro qu’a Bédy.
2, Sur tout ce développement, voir E. Schwyzer, Zum persinnlichen Agens beim
Passio (Abhandlungen der preussischen Akademie,’ Jhrg. 1942, Ph.-hist. kl, 10,
Berlin, 1943).
142 CHAPITRE VIII
nuages » (génitif-ablatif)? — ¥ 874 "Ty 8° dnd vepkav el8e cphpova
édevxv « Trés haut sous les nuages », plutét que « trés haut sortant
des nuages ».
§ 210. Avec un génitif-ablatif, md marque l’origine, la séparation :
T 17 S08 | Sewdv ind Prepdpav de eb athac seqdavbev « ... de dessous ses
paupiéres »; — I 248 éptectan ind Techwv dpvuaydot ; — P 235 vexpdy on”
Atavrog tobew « de sous Ajax »; — y 364 ind Opdvou Spero ; — N 611 on”
dorl3og efieto... ; — N 198 xuvéiv ord xapyapoddvrav dpmitavte « enlevant
la chévre aux chiens » (traduction différente de P. Mazon); — © 56
dvaarhaovran ond Copov ; — 1140 sqq. déer dyAudy S8ap, | xphyy bad anelouc...
— Exemples nets 4 propos d’attelages : 4 5 bx’ émhyng | jusdvoug Buoy ;
—- W 7 Gr’ Syeagt dudpebe pciwoyas immove (cf. © 543, ete...); — de
méme : 1 463 on’ kpverot Avéduny. .
Avec des verbes signifiant « protéger de, fuir, échapper a » : P 224
Aboafe qriomroAguey bn’ "Ayatdy « protéger des Achéens » (cf. P 645 §-
oat bx’ hépog « sauve de cette brume ») ; — avec gebyew, etc..., le sens
approche de la valeur de complément d’agent : T 73 qbype | Sytov éx
rodgpoto Sm’ yye0g fuertpoo (ef. N 153); — © 149 be’ "Extopos av8pog6-
voto | pebyovtes (cf. ® 22); — I 305 sqq. donpitay br’ "Ayoudsy | ... po~
Blovto pedawday ded vndv; — © 149 bn’ dueio pobeipevog; — D 528 on’
adtod | Tp&es Kpap xdovéovro meputérec (mais cf. l'emploi du datif, E 93,
etc..., § 208) ; ef. encore ® 494.
§ 244. Du sens de « sous » ou de « de sous », ind s’est acheminé vers
le sens de cause ou d’agent (cet agent n’étant pas nécessairement une
personne),
Un premier groupe d’exemples se présente avec des formules
comme B 267 sqq. owddE... umavéoty | axntpov ind ypuatov, — T 128
Unuoyov On’ "Apnos nahaydov; — Y 277 rdue 8° donic Sn’ abciic (c’est-a-
dire pedtns) ; — N 334 ind uyéav dvéuev ongpywaw ddr ; — E 92 rodad
& Gr’ adeod (un torrent) tpye xarhpune xdr? aifnav. — Avec des mots
exprimant l’idée de coup, etc... : M 461 diécueyev... | Asoc Smd puri (cf.
6 192, etc...); — A 275 sqq. végog... epyduevov... bd Zepdpoto twig ; —
A 119 (Hufe) Bpdouse xparaot Onpds b9” Sputic; — B 414 ond dente... fe
pli Spiig ; — e 320 dvoyebéew peydrov ind xduaros dpuric ; — I 549 Bapiter
BE por Soe bn? abrod (Erxeoc); — K 539 wh mt mdfaow | ... 6nd Todo dpv-
uccy805 ; — T-133 tpyov deus tyovra in? Eipuatiiiog £46hav.
- Avec un complément de sens abstrait : 4 262 sq. &xédevoe... Zyvd¢
Sm dyyeding; — B 110 eeweaae... in? avtyung (cf. + 156, @ 146); —
K 376 yaupds Srat Selove, Cet emploi s’observe surtout dans ’Odyssée.
Avec des verbes qui sont plus ou moins nettement des passifs :
© 183 arCopévouc ind xanvol; — I 243 dpwoytvous bmd xarvoi ; — e 393
tim xiuatog dpbelg; — © 363 terpduevov cciecxov tn’ Bipvatijoc 4£OQov
PREPOSITIONS ET PREVERBES 143
« lorsqu’il était accablé par les travaux d’Eurysthée »; — ® 260 roi
pév te (68x70) mpoptovtog Sno Yygides Emaar | dyActvea ; — e484 bersaOy
Bt Odracon xarepyoudyyc ind nétpns; — @ 318 xelser’ bn’ tog xexcdup-
péva ; — avec un nom d’action : x 78 telpeto 8’ av3pGv Ouyds dn” elpsolng
dheyewviig. .
Avee un complément de personne : A 242 9’ “Extopog av8popdvoto |
Ovijoxovres rintac: ; — P 428 ev xovlyar neadvrog bq’ "Extopos ; — B 334
cpepSartov xovdénaay ducdvtwy On’ Ayaudv; —T 61 6 v elaw Suh Soupic
Sn’ dvépag, — P 319 domolrav in’ "Ayoudy | “Dov eloavéénaav ; — noter
le sens dérivé de + 114 dpetéar St Awol bn’ abrod « et sous leur loi les
peuples prospérent » (cf. § 207).
Méme syntaxe avec l’aoriste Savor, qui peut étre considéré comme
un passif : II 434 md Tarpéxdowo... depsyver; — a cOté d’un datif instru-
mental : A 821 Sn’ aicod Soup) Sauévrec (cf. I 136, etc...). — Un exemple
net du passif en Z 134-135 : Sn’ dv8popsvoro Auxotpyou | Oewdzevat Bourrdijyt.
En cet emploi de complément du verbe passif,-l/emploi de ind avec le
génitif est en concurrence avec ond et le datif, et commence seulement
a se développer !.
§ 212. La signification de snd s’est développée encore dans d’autres
directions: En partant, de tours comme II 594 8nlay bmd Ovpopataréay
« pressé par des ennemis destructeurs de vies », ou O 275 yay 3¢ 6 ond
layiic epavy Aig « a leurs cris un lion apparut », la préposition a pris le
sens d’accompagnement : 5 492 = + 48 = y 290 duldwy bmd rAnpmoue-
veo « accompagnés de torches brillantes ».
Comme les autres prépositions, snd présente chez Homére un carac-
tére plus concret qu’en attique. Les traits lés plus notables sont :
4° Vemploi,étendu du datif pour exprimer une notion voisine de celle
de complément d’agent ; — 2° l'emploi du génitif pour exprimer non
seulement le lieu, mais le point de départ ; — 3° la naissance de I’em--
ploi de snd avec le génitif pour exprimer le complément d’agent, avec
une variété d’usages qui montrent Vorigine de ce tour.
§ 213. ‘Yd, accompagné de l’accusatif de direction, s’emploie,
comme on Yattend, pour indiquer un lieu élevé ‘au pied duquel, sous
lequel, on se dirige : B 246 on’ "Dov Fafev (cf. A 181, 8 146); — A 407
adv &yéyovd? tnd retyos (cf. M 264, etc...) ; — A 279 Omd te anéos Hace
wira; — v 277-278 aykpovta... | rao to oxtepdv. — En parlant de
bétes de trait : y 383 xd Cuydv Hyayev; — y 476 Sq” dppat’ &yovres (mais
avec Cebyvuut, le datif, cf. y 478 ét § 206). — Pour indiquer l’emplace-
ment d'une blessure : P 309 trav Bax’ Sud xAni8a péany (of. N 652),
C’est sans doute un accusatif de direction qui est également em-
1, Voir Schwyzer, /. «., p. 29-39,
40h CAPITRE VII
ployé @ 26 : mdogoy dnd -xpnuveds « ils venaient se blottir sous l’es-
carpement, des berges » (cf., au contraire, X 191 xavarcnkas bmd Oduvp).
‘Yrs semploie parfois 1A of Pon attendrait plutét xa, pour indi-
quer le mouvement vers le bas : 8 425,-etc... 6nd mévtoy 2Bdcero (cf.
E145); — y 336, etc... ofye6” bud Cégov (of. ¥ 51); — © 333 aed dore-
po ele’ bd yaa, -
‘Avec un accuysatif d’extension et sané mouvement : 0 349 at rou ett
Chou dn? abyéy hertoro (cf. 8 184, 4 498, 619); — E 267 sc00 teow tn’
HSV Hbdby ce; — TP37A dy ye 8€ pv wodSxeorros lic dmadiy md Setphy « tout
autour du cou »,
En quelques passages, l’idée d’extension n’est guére sensible :
T 259-260 af 6’ ind yatav | dvOpdroug thvuvrat ; —- © 234 ors dp” dnd Bru-
Gedy byyyny (mais otéc implique un mouvement) ; — x 362 merrnds yep
Exeuro Sr Opdvov (I’accusatif est peut-étre amené par menrnds).
Notez les expressions géographiques : B 603 tov ’ApxaSiny ond Kua-
dtwne Beog ald 3 —~— B 824 .,, Zerelev Evatov bread x68e vetoroy “IBy.
En deux passages, in, avec I’aocusatif, prend un sens temporel :
TI 202 névé’ ond unwdpdy « tout le. temps qu’a duré ma rancune »; —
X 102 wiy6" bro thv8’ bdofy « tout au long de cette nuit funeste ». Ces
emplois de ind avec l’acéusatif ont. subsisté en attique, ob se sont dé-
veloppés, en outre, des sens dérivés.
§ 244. On s’explique que les prépositions se sojent associées a des
adverbes qui sont souvent des formes cadyelles figées. Sans parler des
formules comme 2 odpavdbey (cf. 1, p. 243}, Homére en offre plusieurs
exemples. Ainsi : é¢ avptov (@ 598); & mep brlcow (v 199); eoricw
(A 461); Rémbev (A 298); spdmapiey (A 645); Evavea, xdrevre, mipavere
(¥ 116) ; xadeorak (p 349-5, mae’ ocSO, (P 535) ; nar” abr6Or (@ 201) ; xaBi-
nepbev (I 337, etc...) ; mpontpoer (Z 307, etc...)!; etc... Méme avec
une conjonction els Sze (@ 99), & moins de lire ele 6 re.
Devant une forme verbale affectée d’un préverbe peut figurer un
second préverbe*. Le cas de la répétition expressive de x4, dans 7po-
mpoxvdwSbpevor (X 224 et p 525), est exceptionnel et archaique, mais
Je cas de deux préverbes différents est fréquent. Ainsi : eloavabaivor
(@ 294) ; elocevéyouer (6 529) ; eloawSav (Il 232, 0307) ; elowplxavev (2 230,
etc...) ; dmmdehdbeabe (co 394) ; dyxd-rhero (Z 223, etc...) ; eyxarémmte (498) 5
tmmpotrpe (A 628) ; trepbebod, (I 582); enevrawans (x 467) ; mapaordbéee-
nov (‘Y 127, 683); napxarérscto (I 565, 664) ; érepxaréénoav (N’50, 87);
dronpotes (x, 82); dmompoendn (p 457); Anomporauesy (8 475). Sur dupene-
etatpdpa, voir § 187,
Il arrive souvent que le prémier des deux préverbes soit x, qui
4, Sur ces derniers adverbes, voir M. Leumann, Homerische Warter, p. 95.
2. Schwyzer-Debrunner, p. 528. .
PREPOSITIONS ET PREVERBES 145
souligne I'achévement du procés verbal : HavaBig (8 405, ¢ 438) ; ta-
vedio (II 442, X 180); eaveton (E471); eanoroler’ (Z 60, ete...);
tanéBove (e 372); tanbxter (+ 387); eanostvor, (® 412); eapérnate
(y, 444); BamoBlaye (E 763); Hanovécstor (Ik 252); androre (Z 290);
docanBev (A 508) ; dempoxadecanpemn (8 400) ; denpodudvees (0 515).
Certaines combinaisons sont usuelles et ont donné naissance a de
véritables prépositions doubles (cf. § 245) : Buctepéeobe (K 432); deki-
pevar (Z 393); nupeberdav (2 47, of. w 55, ¥ 344); mapelerdetv (K 344,
« 104, 138); Smetaydyor (6 147); SnekadtaaBar (O 180); SneEeckacey
(¥ 292) ; sreképeper (0 268, cf. y 496).
On remarque quelques composés qui comportent trois préverbes :
mapexmpoguyeiv (¥ 314) « échapper en avant et de cOté »; — Smefavadiig
(N 352) « ayant émergé d’au-dessous » (ou « sans se faire voir »); —
Sneerpobter (I 506) « elle s’échappe en courant en avant » (cf. ® 604,
0 125); — Srexmpoérugay (f 88) « ont dételé d’en dessous en avant »;
— de méme : Y¥ 147, u 113, ete.., Snexmpopuyeiv « échapper en se déro-
bant et courir en avant »; — ¢ 87 smexnpopéa, en parlant de eau qui
eoule par en dessous; en T 354, il faut comprendre éx-xat-én-adto,
composé de douse: avec trois préverbes,
§ 245. Avec des cas il arrive assez souvent que deux prépositions
stassocient : il ne s’agit pas 14 d’un artifice de la langue poétique,
mais d’un procédé ancien.
A Vexception de dupl nepl (cf. § 187), toutes les prépositions « com-
posées » ont comme second terme 28 ou mpé, le second terme ne ser-
vant qu’A compléter Vidée exprimée par la premiére préposition.
Tlapeé « le long de, sans entrer » : 1 7 map2& &a « le long de la mer »;
276 napix thy vijoov Eradvere « doublez cette tle » (cf. Q 349); « 199
ph we nape &ye via « me Ine méne pas au dela du navire ». Au figuré.:
Q 434 napdé "Ayoioa « A Pinu d’Achille »; K 391, ¥ 133 napex-vsov « au
dela de, contrairement & la raison ». Avec le génitif,"K 349 nagit S805
« hors de la route », ov le génitif marque bien I’éloignement.
La particule. peut également s’employer adverbialement : ¢ 439
viye mapdé « il nageait le long de la céte »; A 486 oxy 88 mapé& « se place
& ses cOtés ». Au figuré : M 213 mpd dyopevduev « parler autrement.
que toi » (cf. 3 348, p16); £168 dade mapdé peyveueba « pensons & autre
chose »,
Remarque. — Dans la plupart des exemples, c’est Vidée exprimée par
napé qui est essentielle. Dans un exemple comme I 7, on peut se
demander si rapéé n’a pas été employé au lieu de nap& pour des rai-
sons métriques.
§ 216. ‘Ynéx (Sn8E) signifie proprement « en s’échappant par en des-
146 CHAPITRE VIIt
sous, en se dérobant » et s’associe au génitif ; © 504 Asoar’ brite dyéov
« dételez de dessous le char »; [I 353 mix uipav alesduever « les enle-
vant de dessous les brebis »; 4 37 Smt€ ‘Epé6evg « montant de Il’ Erébe »;
X 146 telyeos Sxtx « en s’écartant de dessous le rempart »; A 465 (cf.
232) gaxe 8 dix Bergov « il le tirait de dessous les traits ». La pré-
position se trouve volontiers avec les verbes « tirer de, protéger de,
échapper & » (cf, » 107, O 628, P 581, 589, etc...). D’od lemploi
comme préverbe disjoint : y 175, + 489, x 129 Sréx xaxdryra pdyousey.
Remarque. — En E 854 daev mtx Sipe éradotov dyOFvar, Athéna,
sur le char de Dioméde, écarte le trait qu’Arés a dirigé contre lui. On
traduit « en l’écartant du char ». Mais il existe une variante bnép.
§ 217. Aig (82) signifie proprement « 4 travers jusqu’au bout »,
avec le génitif. Un seul exemple dans I’ Jliade : 0 124 ord dukx mpobi-
pov. Dans I’'Odyssée : « 101, 386 dux npobiporo ; x 388, p 61, ele... dex
pevdpoto.
*Anonpé signifie proprement « en s’écartant en avant » et se trouve
comme adverbe : Tl 669 = 679 (vers.condamnés par Zénodote) et
comme préposition avec le génitif : H 334 (vers condamné par Aris-
tarque). Cf. &xénpobt et axénpofev.
Atenpé signifie proprement « a travers en avant ». Comme adverbe
dans des descriptions de blessures : E 538, P 518, w 524 Stexpd dt elf-
caro yorxss; cf. E 66, H 260, N 388, etc... Avec un complément au
génitif : A 138 Scanpd 88 elaxto xui Hc; cf. E 281, = 494.
Tlepixpd se lit en A 180 = TI 699 : nepimpd yap Eyyet view « il char-
geait devant et autour de lui ».
Remarques. — 1. La tradition manuscrite écrit généralement ces pré-
positions composées en deux mots, ce qui est peut-étre la meilleure
orthographe. .
II. Ces prépositions expressives sont tombées en désuétude en
attique. Mais on trouve sporadiquement des faits comparables dans
les ‘dialectes. Dans la xowh, les prépositions se sont volontiers asso-
ciées & des adverbes.
§ 218. Le systéme des prépositions constitue un des traits origi-
naux de la syntaxe homérique. On y observe nettement le réle ori-
ginel des prépositions qui étaient des particules indépendantes et. non
associées étroitement a des cas. I] est souvent malaisé de déterminer,
dans un passage donné, si un cas « dépend » véritablement d’une pré-
position. L’emplei du datif (locatif) avec lequel cette indépendance
du cas est sensible est fréquent chez Homére et s’observe avec des
prépositions qui n’admettent plus guére ce cas en prose attique (dugi,
nepl, perd, avi’). Le génitif, en revanche, est relativement rare et con-
PREPOSITIONS ET PREVERBES 447
serve assez nettement le sens partitif (génitif proprement dit), ou ori-
gine (ablatif).
L’éyolution sémantique des prépositions les fait passer d'un sens
local & des sens dérivés. Ce développement est déja amorcé chez _
Homére : duo! et le datif au sens de « au sujet de »; mepl et le génitif
ou le datif, avec le méme sens ; nape avec ’accusatif dans xdp Sivayw,
nap’ aloxy; Ord pour introduire un complément d’agent ; 2 au sens
de « par suite de »; etc...
Toutefois, bien des emplois n’apparaissent pas encore chez Homére :
rept avec l'accusatif « environ, en ce qui concerne »; nap& avec le
datif « aux yeux de », avec l’aceusatif « pendant la durée de, comparé
a»; xaté avec l’accusatif « en réponse a, durant le temps de », avec le
génitif «contre »; éxt avec le datif « au pouvoir de ». — Enfin, Homére
ignore des’ expressions adverbiales comme 8&8’ dpyig, dvi xpdroc, mpd
Blow, ete... .
Vimportance du locatif!, méme dans des cas ou nous attendrions
peut-étre l’accusatif du changement de lieu et de mouvement (ef. § 143,
etc...), est bien net dans l’usage des prépositions. Ainsi : A 55 ént pect
Gijxe Ged ; — E370 h 8 ev youvaas ninte Audyag ; — A 17 xvqpidug uty npdira
rept xviunat tOnxe ; — ¥ 131 &v cedyecow #Svvov, — Inversement, on re-
lave certains emplois de é¢ comme O 275 épdvy Aig... elg O36v. — En-
fin, & s’emploie avec les verbes exprimant l’idée de suspendre : @ 19
26 obpavéden xpeudoavees ; — K 475 26 emBieptdBos mupseens tyior BéBevro 3
— et méme : A 38 rig 8° 2 dpydpeog tehapdy Iv; — & 154 aviio’ e Ob-
Abpnoro, — Avec éxé, plus rarement : 4 278 dbanévy Bodyov alm dp’ Syh-
oto peddOpov.
§ 249. A cété des prépositions proprement dites qui remontent a
Vindo-européen, il a existé, dés ’époque homérique, des prépositions
improprement dites et moins anciennes. Celles-ci se distingyent de
celles-la parce qu’elles ne peuyent pas jouer le réle de préyerbe. Ce
sont en partie d’anhciens adverbes, en partie des formes nominales
figées. Le cas qui leur est associé est toujours unique, et ce cas est le
plus souvent le génitif, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre génitif
proprement dit et génitif-ablatif. Du point de vue grec, ce génitif
joue le rdle de déterminant de l’adverbe ou de la forme nominale.
§ 220, Avec le génitif. Adverbes exprimant l’idée de séparation,
etc.:, : &vev (cf. got. inu, ete...) « loin de, sans » (N 556, P 407, ¥ 387,
etc...), avec les doublets gvevde (0 78, X 88, 7 192, etc...) et dmdveude
(& 189, ¢ 36, ete...); — drep (v. h. allem. suntar, ete...) « a l’écart,
sans » (A 498, E 753, etc...), avec le doublet dmérepte (E 445); — éxdeg
1. UL, Schwyzer-Debrunner, p. 434.
4148 CHAPITRE VIIT
«loin de » (I 246, N 263, ¢ 8, ete...), mais Z 256 tude & amd relyeds elyev
— durée « hors de » (Z 13, ® 608, v 123), avec les doublets kxrofev (« 132)
et tere (O 301, X 439), txrose (hapaz, & 277), txroadey (I 552), a
(K 94-95, A 457, ete...); — Evepe (cf. Evepor, etc...) « en dessous de »
(@ 16, etc...), avec le doublet ‘inévepte (B 150); — xaOinepfe « au-des-
sus de » (y 170), opposé a Smévepte (y 172) « au-dessous de », pour une
orientation géographique ; — 6ra.0a « en dessous de » (Z 421); — vdege
«A Pécart de » (Z 443), « sans » (E 803, 2 9), « excepté » (Y 7, « 20),
avec les doublets and vicgt (B 233, etc...) et vdopiv dnd (O 244); — tm-
bev « derridre » (P-468), Smafey (0.15), émbev (P 52), xxrémate (u 148},
perormtafe (: 539), tkortow (P 357); — ndpog (skr. purds) : Tudet8a0 md-
og (© 254, exemple unique avec le génitif); — mépny « au dela de »
(B 626, ete...); — hiv « excepté » (6 207, exemple unique chez Ho-
mére) ; — npéaf_e « en avant de » (E 56, 170, M 145, etc...) au sens
temporel (B 359) ; — dxdrepte « de part et d’autre de » (F 340, ete...) ;
— sine (A 847), emadér (A 30) et r@dod (v 249) «loin de », mais en ¥ 880
tHe 8 dx’ adtod. — Adverbes exprimant lidée d’ « a intérieur de » :
&8ov « dans la maison de » (Y 43); tv8o8r (Z 287); évréc « A Vintérieur
de» (M 280, ete...) ; —efow « dans » (en 6 290, seul exemple avec le gé-
nitif; ailleurs on a |’accusatif dépendant d’un verbe de mouvement),
Idée de proximité : dy « prés de » (© 117, K 164), avec ayyd0e
(E 412) et eyyod (2 709, ¢ 5); — méme sens pour le groupe de tunany
(B 526), wayoicv ([ 115), nédac (o 257), qui appartient A une méme
racine ; — pour aye8dv (8 439, © 288, 4 142), éyybc (K 274, ete...), eyo
(Z 347, ete...).
Idée de «en face de» : dvra (P 29, 8 160, ete...)1, avttov (A 230, etc...),
* dutta (p 481), Bvavea (I 67), bvavtlov (A 534); — Bens voisin pour d-
cexpt (de dvri et la rac. de xépn?) « droit vers » (@ 304), et le composé
xuravexed «droit du haut de » (x 559, 4 64) ; Wéd< « droit vers » (E 849,
M 254, etc...) ; — mdporbev (A 360, 8 625, etc...) « devant, en face de».
Tdée de « jusqu’a » : wéypt (N 143), péxore (@ 128) et dyer (@ 370);
ces deux particules*, employées pour l’espace et le temps, qui connai-
tront yne certaine fortune, ne sont attestées que dans ces trois pas-
sages ; en outre, emploj adverbial de éypuc en A 522 (cf. Il 324, P 599);
— péepa (méme sens); seul exemple en © 508,
« Entre deux » : pesonytc Ou peoony),® 259, 1549, ete...
D'autres prépositions improprement dites avec le génitif semblent
tirées de themes nominaux : elvexa (de “evFexa, cf. (Flexdv) « en vue
de, en considération de® » : A 244 ‘S6ptoc cfvexa tHoSe « pour prix de
1. V. Bolling, Language 27 (1951), p. 233.
2. Que Pon ne peut guire séparer l'une de Vautre, mais dont l’étymologie est incer-
i f. Schwyzer, I, p. 620, 622; Adontz, Mélanges Boisacg t, p. 10.
3. Sur le rapport entre fvexa et elvexa, voir I, p. 16.
PREPOSITIONS ET PREVERBES 149
cette insolence 5; — A 410 +008? Evexa... otvexe « pour cette raison...,
parce que »; — A 336 ... xpote: Bpronldog etvexa xobpns « il vous envoie
pour chercher la jeune Briseis » ; etc...
La crase totvexa apparait déja chez Homére (ef. I, p. 85), ainsi que
obvexa « en vue de quoi, parce que, que », qui est devenu une véritable
conjonction (cf. § 449). Plus rare est le terme, probablement appa-
renté, mais de structure obscure, Sqr: « par la volonté de » et aban
«contre la volonté de », en parlant de divinités : d&ca se lit! A 667,
M8, O 720, « 79, ete...; mais Sqn ne se trouve que trois fois dans
POdyssée (o 349, + 86, v 42); on trouve ailleurs térqt.
Sur déna¢ et yépwv, voir § 57, Rem. II et I.
§ 221. Un datif instrumental s’observe avec quelques prépositions-
adverbes exprimant l’accompagnement ou des notions voisines : éua
«avec »: a propos de personne (A 251, I" 458), répété avec le verbe
(A 374 sqq. &y aitg... dp’ Exovro) ; avec un sens temporel (I 682, © 136) ;
avec un nom d’objet (Q 270) ; — dp05 « avec » (O 118, 8 723) ; — duds
«A Pégal de » (E535, 1 342); — wly8a « au milieu de » (@ 437).
Dans quelques cas, nous avons, semble-t-il, affaire A un datif de
destination, trés proche d’un datif instrumental d’accompagnement,
pour exprimer la proximité : en Y 254 veueiv ddafhotaw evavelov, le datif
doit dépendre de vetmeiv (cf. Y 254); — mais avee tyyig : A 339-340
ob8é of tnmot | Eyyic Koav xpopuyeiv; — avec oyeddv : K 422 ob ydp opw
nuiBes ayeddv efaron ; — 1 23 vijgor | ... varettovar... ayeddy daHagar ; — 1 304
pide rot axeddv OGor; — ¢ 27 col 88 ydyoc oxe8bv got.
" § 222. L’emploi de l'accusatif est exceptionnel. La préposition as, -
dont Porigine est obscure? et qui s’emploie en attique avec des noms
de personnes au sens de « vers », semble attestée, dans un chant de.
VOdyssée qui a subi divers remaniements : p 2418 dg alel Tov dpoiov dyer
Gedg che tov Spotov « de méme que la divinité conduit toujours le sem-
blable vers le semblable » (vers condamné par Bérard). Il n’est pas
possible de faire du second &g une particule de comparaison. I] existe
une variante é,
Avec les verbes signifiant « jurer », la particule 44, employée de-
vant laccusatif de la personne ou de la chose par laquelle on jure, a
peut-dtre été sentie en définitive comme une préposition : A 86 of us
‘yep ’Arédave (cf. A 234, ¥ 43, v 339). Originellement, il faut sous-
entendre Spuvupe.
1. Voir une hypothése hardie chez M. Leumann, Homerische Worter, p. 241,
2. Schwyzer-Debrunner, p. 533-534, et la bibliographie citée,
CHAPITRE IX
REMARQUES SUR L’EMPLOI DU COMPARATIF
§ 223. Il n’est pas hors de propos de préciser l'emploi des compara-
tifs dont les formes ont été étudiées I, p. 254 sqq.
Originellement, le suffixe -tepog (attesté et dans des adjectifs comme
‘quetepoc, nétepoc, etc..., et dans ce que nous appelons des comparatifs)
sert 4 exprimer une opposition, une distinction. Lorsque la forme en
-cepog sert 4 opposer un adjectif a un autre, seul l’un des deux est
signalé par le suffixe : O 39 of 0° teph xepad} xal vaaltepov A€yog ; —
H 238 of8? emi Se&d, of8’ én” dpratepd wotfjan Biv; — B 29 He vedv dv-
Spav, 4 of mpayevéotepol claw ; etc... Tel est l'emploi ancien du théme en
*-tero- : il s'oppose 4 une forme différente au « positif », non 4 une
autre forme en *-tero-. Optatepos et dypétepog doivent s’opposer a la no-
tion de « domestique », Sedtepog & dvOpamos (ef. I, p. 257). Dans Pordre
des sexes, seul OnAttepos est attesté chez Homére.
Le suffixe a une fonction séparative. U1 n’est pas essentiellement
comparatif. Ainsi on lit A 277 ueddvrepov fire aloow « noir comme de la
poix » (« de la catégorie des choses noires comme la poix ») : de méme
on sait que *-tero- a fourni a V'irlandais un « équatif ». -— Noter aussi
A 32 oudrepos dig xe venue.
Le suffixe primaire -twv se distingue du suffixe -cepoc. Alors que -tepo¢
qualifie des notions de caractére « spatial » ou classificatrices, -tov s’at-
tache de préférence a des mots indiquant des qualités ou des modali-
tés : ainsi naelov pelfav, pelov. Les « comparatifs » en -Lov, qui n’ont sou-
vent pas de positif, signalent une qualité qui peut étre reconnue de
tous, sans qu’il y ait proprement, a l’origine, de « degré de comparai-
son >»: 0 174 xdxtov nevOhevar Sxprtov alet « cet éternel chagrin ne vaut
rien »; — A 274 énel nelOecbor duewov ; — A 469 zreZdueven yap &pewov ;
etc... Remarquer aussi x 72 6%0c0v « au plus vite ».
Ce qui a conféré aux deux morphémes -tepoc et -fwv une valeur pro-
prement comparative, c’est l'emploi d’un complément-du compara-
tif. Or, ce complément se présente, en particulier chez Homere, sous
deux formes différentes’.
4. Voir Schwyzer-Debrunner, p. 98; 0, Schwab, Hist. Syntax der griechischen
REMARQUES SUR L’EMPLOI DU COMPARATIF, 454
§ 224. L’ablatif représenté en grec par le génitif et qui entre dans la
catégorie de l’ablatif d’éloignement et de différence (cf. § 80) exprime,
pour ainsi dire, le terme étalon dont la notion comparée est rappro-
chée. I] prend ainsi volontiers une valeur exemplaire, notamment,
dans des locutions proverbiales : A 249 yédrtog yhuxtav péev wid} (cf.
E 109); — N 819 @dcaovaz iphxav... trmove; —E 610 Odpyxw guewésrepov
mopag abyyig; — K 437 revxdrepor yedvoc (cf. ¢ 196) ; — } 103 orepewrtpy...
Boro.
Ailleurs, on a des expressions négatives de sens général ou particu-
lier, ot le terme au génitif désigne une norme d’évaluation : T 365
a8 ne ceio Gedy drodtepog Boe (cf. ¥ 439); — 8 138 ob yap Eywyé ch
qyyt xaxdrepov Edo uddoons ; cf. encore B 248, © 483, P 446, 2 94, 1 27,
2 624, v 376, 392, ete...
Enfin, le tour peut servir de comparatif banal, en particulier avec
des pronoms : ¥ 434 aéGev nord yelowv ; — E 56 xeclav offev; — ¥ 789
duet’... mpoyevéotepos ; — Z 479 mazpdc... dueivav ; of. encore A 400, H 111,
K 352, ® 190, ¥ 248 (avec dedtepor), etc...
La construction avec le génitif est surtout prédicative : elle sert &
évaluer la qualité d’un objet par référence a un autre pris comme
norme : dans bien des cas, l’expression est. proverbiale et les objets
pris comme normes sont les exemplaires aceomplis de la qualité envi-
sagée.
Remarques. — I. La valeur de cet emploi du génitif apparait de fagon
frappante dans un tour attesté trois fois dans le chant H : 39 et 226
oléGev olog « absolument seul »; — 97 alvd6ev alvéic « de fagon affreuse
entre toutes », La forme en -Gev marque le point de comparaison'.
IL. Ge génitif peut étre proche du partitif : 4 156 Darhxav avipdiv
mpoysvéotepog Fev « c’était le plus 4gé des Phéaciens ».
IU. Le superlatif admet généralement le partitif. Toutefois, le
génitif de comparaison n’est pas exclu : ) £83 ceto § ... off ttc dviip...
paxdpraros ; -— A 505 dxvuopdtatos Hav; — 0 108 velatog KAAwv.
Cet emplai existe en sanskrit.
IV. Le complément, au génitif est parfois employé de fagon bra-
chylogique : ® 191 xpeisowy... Aude yeveh notopote téruxtat : mota-
pote doit étre complément de xpelocwy, mais le sens équivaut a « la
descendance de Zeus l’emporte sur celle d’un fleuve ».
§ 225. La construction avec la particule 4 joue un réle différent
Komparation, 1893-1895 ; E, Benveniste, Noms d’agent et noms d'action en indo-
européen, p. 128 sqq.; Henning Morland, Symboloe Osloenses 26 (1948), p. 5A.
1, Hypothése invraisemblable de M. Leumann, Homerische Worter, p. 258 sq.
2, Outre Benveniste, 1. c., voir Schwyzer-Debrunner, p. 565, avec Ja bibliographie,
et notamment M. Leumann, Donum naialicium Schrijnen, p. 646,
- 959 cwrapivar 1%. — REMARQUES SUR L’EMPLOL DU COMPARATIF
Soit B.453 wien 8 dap mbkepog yhuxleov yéver” Fé véeaGat « la bataille leur
devient plus douce que le retour ». Comparons cette phrase avec A 249
pbderos yauxtov déev adh. Le tour avec le génitif-ablatif confronte un
objet avec une norme et il indique finalement que cet objet équi-
vaut a celui qui est pris comme point de comparaison. En revanche,
Je tour avec 4 implique deux termes qui s’excluent et dont Pun est
préféré 4 Pautre. Le domaine dé ce type de comparaison est celui
du choi entre deux objets en présence et d’une alternative. Le type
dune pareille construction est, par exemple, A 117 SouAopa... adov Eu-
pevar Hf dodéoder ; —- Y 594 Soiivar | Bovdolyyy #... mecéewv (autres exemples
avec un infinitif au second terme : B 453, I 42, etc...). De méme avec
un verbe exprimé : E 531 mdtoveg ado. qe népavrat. Avec une subordon-
née, pour marquer une qualité plus marquée dans une circonstance
que dans une autre ; X 373 waraxcrtepos Supdactar | “Extap Ste vijag
événpyoev « Hector est plus doux a palper que .lorsqu’il brilait, nos
Vaisseaux » Apres un comparatif 4 Iaccusatif, le nominatif dans
Yautre membre montre qu’il s’agit d’une proposition non explicite :
K 556 aqq. feta Oebc 7 206dav xa duelvovas hé nep of8e | txmoug Swophoat’.
Ce tour, qui exprime proprement Palternative, peut noter la priorité
temporelle : © 188 8qq. outv zap mpotépotar... mupdv LOyxe... #} Eyol ; — Y 444
pOjoovrat tobrots mde xat yotva xxudvea | # duty? ; — ou encore un avan-
tage marqué pour l'un des deux termes : A 162 yinecow modd pfArepor
dadzouaw « beaucoup plus chers aux vautours qu’a leurs femmes »,
Le complément du comparatif avec 4 semble bien se distinguer
toujours par une nuance du complément au génitif. Soit A 260 45 yee
mor’ bye xak dpetoow fe nep huty | dvipdow ou0mex «j'ai déja été le compa-
gnon d’hommes plus braves encore que nous » (et ils écoutaient, eux,
mes avis) : la comparaison marque une opposition qui constitue un
raisonnement ; -—— mais, au vers 259, Nestor avait dit vewttpe éovdv
éueto « vous étes tous deux plus jeunes que moi » : le génitif-ablatif
marque seulement, comme nous l’avons vu plus haut, la référence
de la comparaison.
On observe donc chez Homére deux types de comparatifs : la cons-
truction avec le génitif, of l'on confronte une notion avec une autre
prise comme étalon, et la construction avec particule 4 qui exprime
au fond une alternative. Cette distinction est ancienne et se retrouve
dans d’autres langues indo-européennes:
41. Le verbe pidva pose, en effet, des problémes comparables a ceux des compara-
tifs = gonitits (A 51), 4 (Y 445, 9 58), ou piv (IT 322),
CHAPITRE X
LES PRONOMS
a) PRONOMS PERSONNELS (AVEC abtés, ETC...)
§ 226. L’emploi des pronoms personnels ne pose pas chez Homére
de problémes notables. Il est conforme a ce qu’enseignent les syntaxes
pour le grec en général,
Au nominatif, ’emploi du pronom personnel comporte, comme on
Vattend, une emphase, notamment 1a oi une opposition est marquée :
2.727 by réxopey ob v bych ce... 3 — 1 30 4aN’ UO: anyfj tolov, Eye 8° 63dv Hye-
povesaw.
Un tour remarquable s’observe, notamment avec un impératif,
dans Pemploi de sd 8 ou od ye, pour attirer Vattention, non sur le
pronom personnel, mais sur le prédicat ou sur toute la proposition :
K 235 8qq. tov py 8h Erapiv +7 alphoeat, by x’ WeAqd0a |... | wmdt ot y’ al-
Bouevog chor gpent thy ysv dpeleo | ualelmew, ob BE yelpov' éméooen... « ne
va donc pas,.d’une dme trop courtoise, laisser 14 le meilleur, pour en
prendre un moins bon »; — Z 46 Cebypet, ’Arpéog vit, ob 8 dEva SEat
&rowa ; — K 484 dad a0" Innoug” | 42 od y’ Hpac Evape... ; — u 219 sqq.
sodrou uty xunvod xal ubparos beris Bepye | vija, ob Bé oxontdov Imyaleo, —
Cette syntaxe est paralléle a celle que l’on observe avec l’article 8 ye
{ef. § 236).
Sur Vemploi des datifs yo, ror, of, voir §§ 92 et 93.
§ 227. L’expression de la notion de réfléchi® n’est pas systématique
chez Homere ; pas plus qu’elle ne semble l’avoir été en indo-européen.
A date ancienne, c’est a la troisieme personne que, a en croire cer-
tains commentateurs anciens, l’expression du réfléchi est systémati-
quement marquée et elle est par l’accent. Hérodien enseigne que
Yanaphorique éo, of doit porter l’accent lorsqu'il est réfléchi, et seu-
lement lorsqu’il est réfléchi : 1, 557, 2 (Lentz) Al 8 sob tpltou mpocd-
rou... bre uby 7h 2B abtdy perappatSuevdy dori ards, 8 xotl eretvorypn Akyerae,
4, Schwyzer-Debrunner, p. 186, avec la bibliographic,
2. A. Dyrolt, Geschichte des Pron. reft.1. Von Homer bis zur astischen Peosa, Wira-
burg, 1893; G. M, Bolling, Language 28 (1947), p. 23-93,
154 CHAPITRE X
byelper thy mpd ocbrdiv dEetav (c’est-a-dire est enclitique) ; — dre 38 uetappa-
Copevn perk v0 & Mtyerat 4 dvravupia tol e Expepoudvou SuavvouEvon oix eyel-
povow, Hérodien oppose un peu plus loin 0 285-286 nap dt ol arg | eloe
@coxdipavov 2 8 667-668 Wad of abtH | Zede dddace Boy. De son cété,
Apollonios Dyscole (I 41, 26 Schneider) enseigne que le réfléchi est
toujours tonique, mais admet que lanaphorique puisse ]’étre égale-
ment aA Voccasion.
Les exemples de # tonique comme réfléchi direct sont nets : B 239
8 xad viv Ayia, do ey’ dpelvova gaea | Friunaev; — A 400 uldv | yelvaro
slo yépern; — A 239 xal cd ye... | Bx’ ext of; — A 534 of & peyav nep
tévra,.. | Soa dmb apelov; — M 146 rd + ev Bpeomy | ... | mepl agiot dy-
wrov Say; — B 366 xaré apéag ytp woytovrar ; — E 96 mpd tbev xoveovra,
p@ayyas; — E 800 F drtyov of maida torxéra yelvaro Todeds ; — O 574
Sug & rarrivac ; — x 436 el¢ 8 xadecodpevog ; etc...
Parfois dans des propositions dépendantes : 1 305 sqq. ob tw4, pyow
Suoioy | of tuswa; — Q 134 owtteaQal aol gra Oeodc & 3° Moya mivrav 3
— UT Av debdevsey Lo pvhonote aveven,
Remarque. — Sur aglow en K 398, voir I, p. 274.
§ 228. Loraqu’il s'agit du réfléchi dit indirect, ¢’est-A-dire lorsque
le pronom, dans une suberdonnée, « renvoie » au sujet de la princi-
pale, on emploie Ie plus souvent, semble-t-il, la forme atone : E 298
Beloag wh meb¢ of Epuoalato vexpdy ’Axanat; — O 165 émel & nur Bin word
péprepog elven; — M 458 eb Sabie foe ph of dpmupdrepar Bédos ety ; — T 265
baoa §:8obaw brig op" daleyra...
Méme emploi de l'anaphorique wv : E 845 div’ "Aids xuvexy, uh pv
Wor S6pyzos “Apne; — @ 265 aqq. daades & dppracte noBdpxns Stog “Aytr-
debs | ovivan GiavelBvov od ywduewmn ef wiv dmavees | Bbdéverror gobéovat ; —
p 91 monBeypevos ef th piv elror | ipOlun mapdnortic; — p 220 sqq. el 43y
& uw adteg epyior vleg "Axardy | dbeuevar oldvbe... Eueddov ; etc..
Emploi des pronoms de premiére et seconde personne toniques fa oa
‘on attendyait le « réfléchi ». Dans une principale : K 378 dyav eye r6-
copa ; — H 195 edyeote... | aty# tg’ bustov; — 0.773 of O dun aio xal
8’ &uuopov ; — 7 385 Sascdueve: xutk potpav ep” judas.
Lorsque le « sujet » d’une proposition infinitive, identique a celui de
la principale, se trouve exprimé, on emploie éyé : N 269 of8 yap 083°
dub que deluoptvov Eupevar daxjig; —~ 0 224 sav 3° ddrov due gnyr word
xpopeptorepoy elu ; — H 198 sqq, 088° tue viidd y’ olbtuc | Bxroua bv Ea-
Amuive yewtabat te tpapéuev te; — ou parfois la forme atone pe : Y 361
od w? tr pnpl uedyoéuer ob8’ Héardv. I] n’existe donc pas chez Homére
de systéme défini de pronom réfléchi.
Sur Pemploi de aitée avec le pronom personnel, voir § 232 et 234.
LES PRONOMS 155
§ 229. Les diverses formes de pronoms et d’adjectifs possessifa ont
été prises en considération tome I, p. 274-275, ot l’on trouve notam- «
ment une étude du pronom duds et du réfléchi é<.
L’emploi des possessifs chez Homére appelle, en outre, les observa-
tions suivantes.
Comme on Pattend, le possessif peut s’employer 4 la fois comme
adjectif et comme pronom. Exemples de l'emploi pronominal : Y 205
ob’ dp ma ob guodc Wec obs’ kp’ eyed oolg; — 1 529 el erebv ye abs elu,
mathe 8 gud edyeot elvar.— Au neutre : A 526 05 yap éudv wakweypetoy ;
— © 430 rh & qpovéov ; — B 360 pév uS6” ant coin xabhevos.
Le possessif s’emploie souvent sans article : A 42 tlocay Aaveol éud
Sdxpua cote BEAreaar ; — A 166 yeipes gui; — Z170 @ nevddpw; — 7 39
ratépr @...5 ete...
Sur Vemploi de Varticle, ef. § 242.
Sur Pemploi de é& et 2¢ comme réfléchi pour les trois personnes,
voir tome I, p. 273.
On observe, en outre, un emploi non « réfléchi » : Z 500 yéov "Ex-
sop & avi olx ; — 1 327 dv8péor papwipevoc dapiv Evexa, opereptav; —
T1752 sq. & ve... | Bnra... &) sé piv Greae Bach ; — 1 369 Ody eyd mi-
parov goa werk ole” érdporsew; — 4 281 sqq. thy wore Nypeds | yijuev dv
Buk xddR0g | — K 255 sqq. TuBetdy pty 8Gxe... gdayavov... — 7 8° doy napa
vat erro (nominatil) « ’épée de Dioméde était restée prés de sa nef ».
— Dans des subordonnées : 8 191 sqq. Néotwp péay’ d yépey br" Extuvy-
oalye8e. aeio | olow bvt weydpoier ; — 3 618 sq. 66° be Bbp0g dupexddupe |
xetoé we; etc...
§ 230. Le génitif du pronom personnel est volontiers substitué, chez
Homére comme en ionien attique, 4 l’'adjectif possessif. Accentué :
Z. B44 Bitep tueio; — A 174 ato 8 borta; — X ABA al yap an’? ofarog
ely dued Enog; — a 2AL ceto wéye xdtog; — + 446 gplEac 3 Aoglay (va-
riante). — En 0 76 éusio... O£t5 fpato youve, éueto semble complé-
ment de yobvev, plutét qu’un second génitif dépendant de fparo.
Enclitique : A 273 xot uév wv Bovdtwy Euvley; — EB 841 aad cen % xd-
arog Tohvdik yote Béuxev; — 1 355 péyig 34 uso Sxpyev dpyy ; — N 626
of peu xovpidtqy Boxov... ; — O 293 xal eb xpdvac... 3 —v 234 xat on oldu
yobvarn ; — p 230 welders 84 usv Ooudy.
Exemples du pluriel : 1 498 jyéwv xeqardc; — u 187 mpl 7’ Autor...
6x’ dxotiom ; — v 348 base 8 dpa apewy; — a 381 tH xé ogewy youver’
£ivoa (en x 219, Suéwv peut dépendre de fing ou de agedduebx). — Sur
Pemploi du datif du pronom personne) au sens possessif, cf. §§ 94 sqq.
§ 231. Le pronom aité¢ n’est pas un démonstratif; il comporte
une valeur emphatique et exprime ainsi l'opposition et Viden-
456 CHAPITRE X
tité’. Toutefois, i} peut également étre employé avec une valeur
faible : en ce dernier cas, il sert d’anaphorique et joue le réle de pro-
nom personnel de troisiéme personne,
Au sens fort, il sert & souligner une personne ou un objet par oppo-
sition 4 ee qui l’'entoure : T 195 rebyea wey of xetrar ent yBovt movduéo-
telpn | wicdc 8t...; — 1 B01 adrdg xa 10d Sapa « lui et ses cadeaux »; —
E47 nplv mel vies ennpiiont, xretvar 8b xat advodg. Autres oppositions:
le maitre et son écuyer (Z 18) ; Zeus et les autres dieux (@ 4); un oi-
seau et ses petits (B 317); des hommes et leur famille (€ 265); les
guerriers et leurs chevaux en B 466 no8dv abréiv te xat Irmav; le ber-
ger et son troupeau (: 167); les Troyens et leurs alliés (A 220); des
beeufs et leurs peaux (H 474); un héros et sa cité (P 152). — Noter,
en particulier, Popposition du corps et de l’ame : A 3 sqq. quyde “At8
mpolapev | fpdav, adcobs 3¢ Hapa tedxe xivece ; — tour comparable en
2.601-602 nav 8b per’ elevdyoo: Biny “Hoaxyelny | elBarov’ abtds 38 yer’ &0avd-
tort Peotar... (mais les vers 602-603 ont été condamnés dés |’antiquité).
. L’opposition est parfois moins nette : T 105 Sep" Spx tduvy | ated ;
— E 450 abea x? Alvela, bxerov xal redzent toto ; — + 329 8¢ pv dmnvhs ob-
roe Eq xal drenvée eld}.
Employé comme adjectif, xitig peut équivaloir au francais « exacte-
ment, précisément » : N 615 ond Adgov aieév « juste sous laigrette »;
— au sens de « méme » : Z 451 ot’ mitijc “Ending ; — avec xat : & 45
Spa xat abréc... elrns.
Sens de « par lui-méme, de sa propre initiative » : A 356 av yap
Eyer yépas adtde dxovpac « m’ayant dépouillé de son chef »; —- P 254
dad ng abtds Yrw « qu’ils viennent tous d'eux-mémes »; ef. © 293,
WY 591 ; etc...
D’ou le sens voisin de « seul »: E 880 airac tyelvao natda « tu lui as
tout seul donné Je jour », — Renforcé par mep : © 99 abcde mep tiv;
— par oloc : & 450 aisde xrhauto olog.
Adrés, indiquant une opposition, a été utilisé dés l’époque homé-
rique pour exprimer l’accompagnement au datif : © 24 adrh xev yaty
Epson? airf 8 Oadtoan ; —~ 1 542 adriar pltnor wal abrots deat ; — £77
abroic b6ehoist ; — © 290, A 699 adrotaw dyeagt ; — ov avec adv : 1 194
avépoucry,.. abty adv odpytyyt (of. & 498, v 118). Voir encore § 100.
Le sens d’identité « le méme » s’observe bien chez Homére sans
article : M 225 ®evsdue8” abcd xéhevda ; — 6 107 airhy é3v fvrep... 5
— 9 366 aici evi xopn. — L’emploi de aitdc (avec l'article) est assez
rare : Z 394 thy adthy 686v ; — 1 55 toxfay | tav adcdv ; — 7 326 quan cH
aird : ces deux derniers passages sont peut-étre « récents ». En E 396,
woxhs pout étre une modernisation de aidzéc (cf. I, p. 85).
1, Schwyzer-Debrunner, p. 187, 191, 195 sqq.
LES PRONOMS 157
§ 232. Abrég a été associé A un pronom personnel tonique ou non
qu’il souligne : 8.194 éyav... abtég ; — E 459 atte por éxésovte ; — 1 249
abt tor perémad’ &yog tocerar ; — p 494 adtév oe Bidar ; — K 242 érapdy ye
xededeté p’ abrov &A¢oBar; — 1 324 xaxéic 86 té of méder adei; — ID 12 He oe
MupyiBéveom mpadaxenr # uot aisG ; — ¥ 312 mrelova toxow oéBev abrob
pntioxofor. — Ou avec pw: A117 adthy ydp piv dmd tpdpos alvds bxdver 5
“— © 318 sqq. x3 dé pv abrdy | elbow ; —- Q 472 qq. ev 8é pw adrdv |
ep’... | — 84118 AE pew adrov narpdg edoere wvnsbiver ; — y 327 rloceatenr
3é uty adrdv (mais il y a une variante peut-étre préférable airéc).
Le sens de airé¢ est parfois affaibli : @ 396 Hiptados 8¢ & wbtbv dpec-
date kntesct; — v 190 Sopa wiv adrdv | &yvworoy tedkeev (adr Aristo-
phane!) « (Pallas) pour le rendre impossible a reconnaitre ».
Le pronom atric, employé seul, peut équivaloir 4 un pronom per-
sonnel : Q 503 422’ aldeto Geods, “AyiAed, abrév c’ EAénoov « prends pitié de
moi »; — B 268 airiy 38 xdalovta... dpfaw « je te renverrai »; — x 26
Seppe pépor vids te xat oxbtods (= fyés). .
Au nominatif, valeur emphatique de aitéc : 1 450 thy adtdc pidtec-
xev; — H 332 abrol... xoxrhoopev; — 0 443 abtdg viv We...
§ 233. L’emploi anaphorique de aitév, équivalent de wy, etc..., com-
mence a apparaitre chez Homére : H 204 et 88 xal “Extopé mep tigers
xal wheat abtod; — © 456 xal uv ble | abrg oxnntépevoy xarlyev ; —
comme sujet d’une proposition infinitive : 7 388 Béreobe | abcd te Cobetv 5
etc... En M 204 xdfe yap airy tyovre « il a frappé Poisedu {adtév) qui
le tenait » : pour confirmer ce sens, Hérodien et Apollonius écrivent.
yp adcov (atone);,on a parfois considéré eit6v comme complément
de #yovra, auquel cas il équivaudrait 4 un réfléchi.
§ 234. Déja dans la langue épique, le pronom adtéc a servi a ren-
forcer le sens réfiéchi d’un pronom personnel. Adtés peut précéder le
pronom ou en étre disjoint : p 595 atriv pty at... odo; — 3 244 adrdv
pw miayfiet... Sapdoons « s’étant défiguré »; — K 307 of + adr xb805
Spore ; — © 188 sq. dao’ av tuo mep | adsi wndolav; — 78 eukOev nepr-
Scone airig. On trouve déja souvent «dré¢ suivant le pronom person-
nel : A274 nat payduny xe’ Eu’ abtdv dys ; — de méme : V 171 & addy, -
F162 8 adriy, 424 guot abes, P51 cot ads, N 495 got ated, I 47 of adevs,
T 384 & abtob ; — au pluriel : p 225 agéuc airovg, v 213 aglaw adtois.
La valeur emphatique de «ité¢ fait qu’il équivaut parfois 4 un ré-
fiéchi sans en posséder véritablement la fonction : B 125 péya pev Atos
adr} | motets’ adrdp col ye...; — 8 247 ade 8 adrdv past xaraxpdrereov
tone ; — Y 55 dv 8 adbroig tpidu biyrwvto Bapeiav ; — T 333 Ocbpyua.... #y-
vev | ofo xacryvizroo Auxdovog, Hppoce 8 arg «il revétait la cuirasse de
1. Cette variante donne un sens plus satisfaisant.
158 CHAPITRE X
son frére Lycaon ; il l’ajusta & sa mesure » (fpyose ne peut guére étre
intransitif).
Au génitif, ait4¢ renforce un adjectif possessif : Z 446 dpvopevog na-
tpbc te wéya xAéog AS’ Endy abrod « pour gagner une immense gloire 4 mon
pére et A moi-méme »; — B 45 (dyopedw) sudv adrod ypetog; — Z 490
rh @ abriig Epyx xbpile; — 0 262 (Aiccopat Onkp...) ofig +? abrod epekiic;
— K 204 agg. otx av 34 11g dvhp nentBow8? 8 abrob | Oud ; — w 196 sq.
0d yép mag av Omrds dvip tdBe ynyevdioro | G abtod ye wo ; — 0 39 torw...
valtepoy Ayos abtdiv: — a 7 abrév yp eperépnow sBacratnary Shovro ; —
B 138 dpérepos 8 el wav Oupdg veveaiterar abrav.
Employé seul, le génitif peut équivaloir a un réfléchi : 1 342 ry od-
rot page (que l’on a voulu corriger en Ay abrod pidger); — x 27 abrdv
yap dxadsued? dppadinor ; — H 337 Selpopev... | mopyous ddndotc, eDap vyiov
we xab odrév.
§ 235. I] a été tiré du pronom adtég un adverbe abtas, dont les em-
plois sont notables, Il peut signifier « ainsi, de méme » ; X 125 yupviv
dbvra | abrag dig te yuwetxe « sans armes, tout comme une femme », I]
s'emploie avec des valeurs affectives variées, « seulement, simple-
ment >; & 451 obx arog putoopar, dark civ Spx ; 8 G65 mits olyerat
asses « Venfant s’en va a lui tout seul »; — également au sens de
«tout a fait » : 0726 vimog adtas; Y 348 pad abras « tout a fait vai-
nement »; © 474 dveyddtov adtes; — et aussi au sens de « ainsi, en
vain » : B 342 atrmg énteos’ eprSalvouev; — enfin, avec la nuance de
« toujours ainsi » : A 133 adtag | Hadar; — ¥ 268 rcvxdy br’ aidrag « en-
core tout brillant neuf »; ef. encore A 520, & 338, O 413, v 130. —
Sur l’orthographe du mot, voir Introduction a UIliade de la collection
Budé, p. 135.
6) L’aRTICLE ET LES PRONOMS DEMONSTRATIFS
§ 236. L’article ionien attique 4, 4, <6 résulte de lusure d’un vieux
démonstratif!. Son emploi comme démonstratif est important dans la
langue épique et, a cet égard, la syntaxe d’Homére différe grande-
ment de celle de Tionien attique.
C'est lorsqu’il est employé comme pronom que la valeur démons-
trative de l'article apparait la plus nette : A 9 6 yap Baodyt yoruels 5
— A 29 ty ® bya od Adow; — A 43 od 8 Have Doifjog *Andwv; —
A.55 ti yap ért peat Ofxe ; — E 390 6 8° ebaeder "Apna; etc...
L’atticle-pronom démonstratif se trouve volontiers au début du
vers. I] est souvent accompagné d'une particule : 6 wey, 6 ye, 86, 5 yap,
1, Schwyzer-Debrunner, p. 19, et la bibliographie, notamment Stummer, Uber
den Artikel bei Homer (Programme Minnerstadt}, Schweinfurt, 1886,
LES PRONOMS 159
xal yop 6, Hrow 5, cand bv, zdv fo. Le tour 6 yey... 6 8 n’est pas des plus
fréquents (cf. B 52); pour 6 pay seul, voir % 4, etc...
La particule et l’article servent souvent a indiquer un changement
de sujet : A 333 Adrdp & Ey... ; — A 342 F yap 6 ye ddor7jot gpect Over ;
— A B47 ae 8 abric teqy...; —'A 284 dan’ 8 ye qéprepss dorw..,
Noter Popposition marquée sans symétrie en X 157 +H fx mapadpa-
pérny gedyov, 6 8° Smobe didxwv « l'un fuyant, autre derriére le pour-
suivant ». — Noter également x 495, ot l’'absence d’accord souligne
que nous avons alfaire & un pronom : tol 88 oxal dlooounr « tandis que
les autres (les ombres) voltigent ».
Toutefois, il arrive que le pronom indique un changement dans le
mouvement de la phrase, mais il s’agit toujours du méme sujet :
A491 rod piv &uapd” § BE Acixav.:. | BebAjxer «il Pa manqué, mais il a déja
atteint Leucos » (cf. @ 119, 126, 302, A 80, etc...); — I 16-18 Tpacty
pv npoudyitey *ArLEav8pog BeoesShc... abrip 6 Sobpe Bbw... néddov ’Apyelov
Rpoxadilero mdvrag dplarous; — A 496 Génie 8 ob Aver’ egeruéav | maBdc
to GAN Hy" dvaddcero... (cf. E 321, Z 168, a 4, etc...); — A 320 ob8
"Ayapéuvey | 47 kpeBos... AN’ Bye...
On s’explique que l’article s’emploie également, souligné par ys,
dans des propositions disjonctives : M 240-241 et v aml deff tao... |
ely’ an’ dpiotepd tol ye... — B 132 Caer 8 y’, % réOvymev; — T 409 9 trot
Yov morhaetas 6 ye Sobany; — A 190 8qq- 4 8 ye pdoyavov 4 epuscdpevog
napé ipod | todc usv dvaarioetev, & 8 "AspetSny evapitor | He y6rov mudoetev.”
Le souci de souligner une opposition a parfois conduit le poéte a
rapprocher deux articles : ® 602 clog 4 sav xeSlow Sidxero ; — K 224
vat te mpd 6 vod tvénce « lun voit avant l'autre » : dans cet exemple,
la place de 6 altére gravement J’ordre des mots attendu (cf. encore
X 200, ete...).
Llarticle est parfois rapproché d’un pronom personnel auquel il
s’oppose : N 829 éy 8 ob rota... ; — © 532 elooua el xé pd Tubetiy¢
xparepds Atowting | mip viv mpbs tetyoc dmcaerat % xev eye shy.
Dans tous ces exemples ob Varticle indique une opposition, il est
volontiers souligné par ye.
L’article-pronom démonstratif a pu s’employer sans marquer d’op-
position nette : 0 539 loc 6 te module pévev...; — E275 obnrat re wb-
daw cavides + él rHic dpupuiat ; ete...
§ 237. Il se rapporte souvent a ce qui préctde et marque un lien avec
ce.qui précéde : A 249-250 tod xal dm yrdoons yédttos yrunlay péev add} |
zi 8 87 Bho pev yeveal pepinay avOpdmav | e@lar’... | d ape & gpovbev
dyophowro xal peréemev; — A 53 tac Stantgout... ; — a 55 105 Gvydenp...
— Noter la formule a 359 = 4 353 = @ 393 n&a pddiote 8 epol* tod
yep xpdr0g Bor” Eul ofc.
t60 CHAPITRE X
Plus souvent l'article se rapporte A ce qui suit : 8 655 ddd td bow-
udta‘ WBov...; — E 564 tk qpovéav iva...; — comme antécédent d’un
relatif : A 364 7k yap qovésis & 1° tyeh map... ; — 1 G15 ray vehServ, Be x? bud
wh8n. .
Le neutre de Particle est employé pour annoncer des propositions
introduites par des conjonctions comme &re ou d¢ : O 207 éobddy xat
20 throat 8° Hyyehos alos: elB% 3 — +442 od 38 vimoc obx evnosy | b¢...5
— ou d’une fagon un peu différente : I 308 Zeb¢ pév xov v4 ye olde... |
bnmorép (cf. E191, ¥ 466, ¥ 545).
Infinitif annoneé par l’atticle : v 52 avin xal tb guddccew ; — de méme
dans des passages ot I’indépendance de l’infinitif est sensible : P 407
* ob3t 7b Brmeto réumay | demtpaer rrodlebpov ; — ou a 370 +4 ye xaddy axové-
pev Early dordod : 16 ye est développé par dxovéuev (ef. encore v 220).
Remarque. — C’est cette valeur de liaison du thame de l’article qui
explique certains tours adverbiaux : t&, ancien ifstrumental, « alors,
c'est pourquoi » : B 250 ta obx &y Baaidijac ave oroy” Byes dyopeboug
« ainsi, quand tu discours, tu pourrais avoir moins les.rois A la
bouche » (cf. B 354, 373, ete...).
Partois aussi, on a l’accusatif 15 : 1176 rd xal xdalovow terra
(cf. M9, P 404, T 213, ‘547 ; un seul exemple dans l’Odyssée, 6 332).
Autres expressions du méme genre : éx toto, totvexa, ete...
- § 238. La valeur démonstrative de larticle-pronom se trouve
moins sensible loraqu’il s’emploie aprés des prépositions, notamment
au datif aprés pert, napd, mport, abv, ev, dua : A 348 4 8 déxove’ dua totot
yovh xlev ; etc. I] est ainsi substitué a fo, of, caplet dans de pareils tours.
Remarques. — 1. Le grec postérieur atteste certains emplois démons-
tratifs anciens qui ne figurent pas chez Homére : tov xal tov (mais
Wackernagel, Vorl. iiber Syntax 114, p. 131, propose de lire.ra nxt 7
wededer en Y 255) ; — xat cov elmeiv (cf. Schwyzer-Debrunner, p. 24).
IL. L’artide suivi du génitif et jouant en définitive le réle d’un
pronom démonstratif est, au contraire, une innovation dont on
Wapercoit chez Homére que les débuts (cf. § 242).
§ 239. Associé a un substantif, |’article conserve souvent une valeur
proprement démonstrative. On a observé que certaines formes ne
s’employaient qu’avec une valeur démonstrative : rol, tal (par opposi-
tion A of, al), roto, toiw, thay, totet, tHat, tH¢ (en Outre, roto se trouve
presque tiniquement au début du premier ou du cinquiéme pied ;
+dov au début du vers, sauf en II 833) : voir Schwyzer-Debrunner,
p. 24, et la bibliographie citée. :
§.240. Avec le sens démonitratif, il est probable que Varticle est ori-
ginellement pronom : A 20 dg Epa8’, al 8 emtvEav "A@nvaly te xal “Hen
"LES PRONOMS 164:
«et elles, elles murmurent Athéné et Héré», Ce sens est surtout pro-
bable lorsque Js: mouvement Vindique par la disjonction de l'article et
du substantif : A 409 rode 8 xatd mpipvac te xal du” Da Boas 'Ayauads...
Le substantif peut étre-mis en valeur par un rejet : A 501 tév 8’ ’Odv-
oxic dxdpnio xohwadevos Bade Bove | xdpony 4 & Erdpot 8d xpordpoto mé-
pyoev | alyuh; — 0 54 to yk te Eeivos piyvhoxetat Fuata méovre | dvB—ds
EewoSdxou. Cette construction permet de mettre un nom propre en ac-
cant: B 402 adhe 6 Pobv Lepevcey aval dvBpav “Ayapeuvan ; — de méme :
A 488-489 Ainde'h whyeynual naphuevos dxumdpoin | Stoyevis ITnAfjos vids...
Noter Pexemple de A 348 4 8 déxous’ dua toto yuvh xiev « ef elle les
suit & regret, Ja femme » :.Varticle semble a la fois annoncér yuvi et
se rapporter A Beanida, du_vers 346. :
La valeur démonstrative peut étre sensible sans que Varticle se
joint :.K. 498 téppa 8 ap’ 8 thiwav *OBvaeic « cependant, de
son ofté, Pensrarant Ulysse » (cf. ¥ 465, ete...).
Elle pout étre soulignée par la place au temps fort du promier pied :
6 388 & Eeivoc udra pot Soxder memwupevos elvan; — 7 482 ob Bw Erpepes
abst, | +6 og Ent pakis. .
Tout comme lovequ’il est employé comme pronom, l'article associé
gun substaritit gert volontiers, généralement accompagné d’une par-
ticule, A marquer une. opposition : B 217 porxds Uy, xuarbe. 8 Exepov
mdda° wis $4 of yoo... ; — N 616 rdne 8 daréa” td BE of baoe... ; — X 405
4 36 w phen | Dds iden; — A 399 totog Env Tu8eds ‘Alrdnuog* axe rov
vulbv | yetvaro...
article est ‘parfois couligné par utv-pour indiquer une opposition
avec ce qui suit : A 267 énel cb uty Dxog énipsero natouto 8? alua... (cf.
®@ 73, 14, N 640, T 4,7 75, ¥ 270). Noter Varticle suivant Je nom :
@ 116 pwmorhpwy ray ubv oxédany xark Sdwara Bety | vyshy 8 adrdg Exot:
L/article sert également A souligner un terme aprds une particule
copulative comme xal, 8¢, xat yap... : A 330 meds re Gediv paxdpav,
pbs ve Bvntav dvOpemey |, wal mobs tol Baattos dmmvteg... cet devant ce
Toi intraitable »; — O 36-37... yata xml atpayds ebple Srepbev | xa td
warreBduevov Exotic $8eop; — 5 503 obs ‘yap 4 Tpopsyoto Séuap... « elle
non plus la femme de Promachos....»
De deux substantifs réunis pat xal ov 48¢, l'un peut se trowtver sou-
ligné par l'article : K 536 ’O8uoeic te xat 4 xparepdg Atoprhbng; — x £03
Bhow 8 avbdry | xal rH Bordr@ Ha; — Y 320 Alvela HB" 6 xdvvdg Fev
*Agodeic. De méme encore : E 672 4 mporépa Ards uldv... dicbxor | i 5 ye
stv maédvov Auxlay dmb Qupdv orzo « s°1] poursuivrait le fils de Zeus ou
e'il enleverait la vie & un plus grand nombre de Lyciens » (raw marque
une opposition eritre Sarpédon et Jes Lyciens) ; — v 242 adtép 8 totew
‘dprorepds HAvbev Spvic « mais voici qu’é Jeur gauche surgit un oiseau » (5
marque l’opposition a ce qui précéde). ,
162. CHAPITRE X
§ 244. Sans qu’une opposition soit proprement marquée, l’article
comporte un sens présentatif net : A 20 mai8a 8 uot Adaaure pikqy, va 8
Snows Styeotat; — A 33 b8acev & & yépav; — ¥ 336 drdp tbv deEiby Un-
nov...; —- en 44, of Got introduit les dieux par opposition aux hu-
mains. — L’article met un substantif en relief : A 167 aot t3 yépag mond
petfov; — « 375 tov pdydov bmd pxédov Hacc. — Noter les tours du
type : A 552 motoy tiv pidov Zemec ; — 4519 olov tov Trrepldny xatevh-
paro « quel homme est ce fils de Téléphe qu’il a tué ».
L’article sert en particulier a souligner J’antécédent du relatif :
E 265 tig yép tos yeveijs Fc... (cf. Z 292, © 186, T 105, et assez souvent
dans l’Odyssée). — Noter le tour qpor tH éte... (I’ 189, ete...).
-En ce cas, i] suit volontiers le substantif, souvent en rejet : E 320
ouviectawy | thoy dc..3; — P 172 &dow | téiv So00.; — 6 119 madoudiv |
taav at népos Faav (cf. A 40, E 332, I 631, N 594, etc...).
Dans tous ces exemples, l'article a pour fonction, non de définir,
mais de mettre en accent, de présenter.
§ 242. L’article s’est employé avee ‘des adjectifs, particulidrement
‘avee ceux qui marquent une distinction, une opposition. L’emploi
avec Whos, avec étepoc, avec adtd¢ est un tour relativement nouveau,
mais en plein développement : B 665 amelanoay yap of &xhor (of. A 342,
597, © 211, K 408, © 368, 0 67, w 79).
Ta se trouve dans des formules : A 465 plorudddv ~ &po tEMa
(= B 428 = y 462 = yp 365 = & 430). — Article avec Erepog : M 93
wav 8 Erépav Hdpts Hexe: ete.
Pour l’emploi de l'article avec les démonstratifs et avec aizés, voir
§§ 231 et 254. .
Les comparatifs et les superlatifs se sont prétés & l'emploi distinctif
de Varticle : cf. of matoveg (B 277); ta yepelove (A 576); etc. — De
méme : E 414 tov Apuarov "Ayaudv ; — p 415-416 od piv por Boxter 8 xd-
xisrog *"Ayardv | Eupevar (prédicat).
Avee les noms de nombre ordinaux qui ne sont pas sans rapport
avec le superlatif : ¥ 265 sqq. 2 mpd, ... tH Sevtépes, ... 7 tprtére, ...
rip 88 terdpte ; — A 308 of npérepor ; etc...
Avec les noms de nombre dardinaux, article est employé lors-
qu une opposition est marquée : E 271 rods piv téconpac... re 88 Bbo... 5
— A174 néoas* oi 84 7? th; — K 253 tév Blo porpdav. — De méme :
1579 +d pay fusou ; — I 173 tie dv big oteyds.
Lrarticle distinctif s’emploie également avec les possessifs : @ 430
— '¥ 572 swig cobs mpdate Paddy; — A 207 nadcousn 7b
185 sb ody yépag ; — A 42 rv budy yddov; — © 360 marhp
oSpbe ; — A608 rape xexapropive Oupe ; —¥ 205 sbv bly ve WS8apyo ; —
M 280 té& & xix ; — + 250 +h d tpya ; — E153 td & Suara; etc...
LES PRONOMS 463
Avec des adjectifs, Particle s’emploie pour souligner le contraste
entre grand et petit, bon et mauvais, etc... : A 106-107 ... of mb more
pot 78 xphywov elmag | alel ror ta xdse’ dori pide... pavrebectar ; — v 310 eofad
te xal tk yépna ; — avec un génitif partitif : & 12 7d pédav Spudc,
Apres un substantif, ’adjectif précédé de Particle restreint la notion
exprimée par le substantif. La fin de vers péyag Tedapadvog Alas est
banale, mais on a en II 358 Afac 3° 4 péyac. — De méme : A 637 Néo-
top 8° & yépav ; — 5 279 Oeobs... tobe Smoruptaploug; — & 61 dvaxtes | ob
véow; — p 252 tyOdar tots datyorn ; — O 66 models drxésuve’ 2ifnobs | tobe
Gxdovg (cf. @ 211); cf. § 246.
Avec le participe : A 70 8¢ #8y td +’ tévra, ta T Exodpeve mpd +” d6vra 5
—T 138 +6 8¢ xe yorhoavn py xexrion Exoung.
Emploi avec la méme valeur distinctive de substantifs et de patro-
bymiques, etc. : A 613 Maydow mévra Home | 7G "Aoxrnmsdy (cf. N 698,
ete...); — B 595 Odpupw tov Ophera; — Z 261 neBlov 7s “Arjov (cf.
K 11), — Avec un substantif : @ 252 atetod... sod Onpytiipos.
Certains emplois ou l'article présente un sens fort semblent, toute-
fois, n’étre pas tres anciens et commencer seulement a se développer
4 l’époque homérique. Ainsi, lorsqu’i) se trouve déterminé par un
génitif : Y 181 epic He UMprdyou « le rang qu’occupe aujourd’hui
Priam »; — w 497 vleic of Aodloo ; — avec le substantif sous-entendu :
1 342 why adeod (yuvaixa) ; — ¥ 348 rods AnoptBoveos (tmrous) ; — ¢ 224
rotaw 'O8vaciios (xthpacw).
La valeur distinctive de l’article a conduit, dés l’époque homé-
rique, 4 l'utiliser avec des adverbes. Ces tours se développeront dans
Je grec postérieur. L’article s’emploie dans deux procédés différents.
D’une part, il a parfois été déterminé par un adverbe : 1 559 av8péiv | tv
vote... ; —2 86 rav SmeGev « ceux que tu as laissés derriére toi » , — x 220
th? E800, xal tk Odonpw ; — A 643 th y° SmoGe « ce qui se trouve de
dos »,
D’autre part, il semble parfois renforcer Vadverbe : 7d nplv.
Exemples : v3 mplv (E 54, ete..., y 265, ete...); — +d ndpes (E 806,
ete..., B 305, etc...); — 1d mpbadey (M 40, ete..., 8 688, ete...); — 7d
rdporBev (a 322, etc...) ; — 1 mpdrov (A 267, ¥ 324, 8 13, ete...); — 2
npéira (A 6, etc..., « 257, etc...).
Dans tous les émplois que nous avons envisagés, Yarticle comporte
une valeur démonstrative plus ou moins nette. Cette valeur est allée
8’effagant.
§ 243. L’article comporte parfois une simple valeur affective : B 275
‘sov AwSntipa « cet insulteur »; — ® 421 4 xvdpu « cette mouche A
chiens »; — X 59 sav Sbermvav « ce malheureux »; — wp 143 thy drow...
Xdpuédw « cette maudite Charybde »; — & 235 why ye otvyephy div...
284 CHAPITRE X
« cette abominable expédition » (cf. « 26, 333, etc...). — Noter N 53
RS EY 4S racy « Pendroit od ce furieux... ».
L’affaiblissement: du sens démonstratif s’observe bien lorsque l’ar-
ticle s’emploie avec des substantifs désignant des titres comme yépav,
yepuds, dvak, Hous. Originellement, le substantif jouait le rdle d’une
apposition & larticle. Si le nom propre se trouve exprimé, article
n’est généralement pas employé. On dit 6 yépav, mais yépav temdra
Tindeds. Ainsi A 380 yoduevos 8 8 yépav mid. Szeto; — A 35 dndvevde
xudov hpH8? & yepandg ; — A 322 dveiBeov Oepdmovta MoMova toto dvaxrog ; —
E 308 adtap & y’ few; ete...
L’emploi de article est également assez Iréquent avec un subs-
tantif comme pidog : A 552 notov rbv piBov termes; — B16 ... émel rev
pBbov axouse ; etc...
Dans l’Odyssée, Particle se trouve volontiers dans 4 Eeivog (n 192,
6 388), 4 vijoog (¢ 55, 1 146, w 201, 276, 403), te pre (1 464, 2 4, 20),
& pbydog (t 375, 378), 23 réEov (p 113, 305).
Dans l’Jliade, cet emploi affaibli de l’article, moins fréquent que
dans |’Odyssée, s’observe surtout dans les chants K, ¥, 0 : K 321-322
1% oxhirrpov dvdoyeo xal wor Suoacoy | ¥ udv rods trnoug te nah Apuare monet
yadxd | Soctuev of... «le sceptre qu’ Hector tient A la main », « les che-
vaux d’Achille », comme le précise la relative qui suit. Voir encore
K 97, 277, 330, 408, 497, ¥ 75, 257, 465, OQ 388, 801. Plus rarement
ailleurs : B 80 tv bverpov « le réve en question »; — H 412 2d oxin-
pov « le sceptre qu’il avait ala main »; — Y 147 vd xitog « le monstre ».
On s’est demandé si l’article ne comporte pas parfois un sens pos-
sessif. Mais le plus souvent, avec un terme de parenté, il présente une
valeur emphatique plutét que possessive : T 322 038° ef xev tod natpd¢
éropOtyévoto muflofuny « pas méme si j’apprenais la mort de ce pére...»;
— O 641 tod yéver’ x marpd¢ nord yslpovos vld¢ duelvav; — © 442 ofta
xev Tig unteds epwwias 2Eanorivors « tu subirais la malédiction de ta propre
mére »; — B 134 b« yp tod narpbe xoxd melooumr; — x 149 npdrbv xev
to} matpd¢ Hotuela vdaryov Fuse. C’est dans ces exemples de l’Odyssée
que le sens semble le plus proche du possessif.
Avec quelques autres substantifs, l’article semble également assez
proche du possessif, mais ce sens lui est conféré par un pronom person-
nel tout proche : T 331 a¢ dv wor roy mai8a,.. |... aydyors ; — 2492 do’
dye por 105 made dyaved p50ov evlomes...; — 1535 dan’ Hye wor rv Bverpov
‘Smdxpevan. :
Remarques. — 1. Dans rig ebviig (I 183, 275, T 176), ou tig dperic
{B 206), cic est un pronom complément de eiviig ou dperiig « le lit »,
«la vertu » de cette femme.
IL. En ¥ 75 xat por 83¢ thy yelp’ bropdpoum, Particle n’est pas
possessif, mais emphatique : « allons, donne-moi cette main... ».
LES PRONOMS + 165
§ 244. Un des emplois ot le sens de Particle est le plus dvolué est
celui ot il désigne une catégorie générale : T 109 ote 8 6 -ykpaw peréy-
aw, dpa mpboaw xa omicaw | Aebcae: ; — N 278 WO’ & re Berrdc aie, Bg 1° H-
mpog EspadvOy. — Avec un adjectif substantivé : Il 53 éxnére 8) civ
duotov dhe 20éxnow duspcat ; — p 218 ag alel rv dpotov kyer Bede mpd tov
dpotaev ; — N 284 rod 8° dya6od ott” dp tpémetat ypdds.... — Avec un parti-
cipe : ¥ 325 wv mpobyovee Soxever ; — 1 320 xdeBav’ buide & +! Kepyos dvb
8 re moDAd bopyiog ; — A 70 sé 1° kbvra, rt 4° Zaadjneva mpd 1° eéven},
§ 245. C’est dans des chants, que l’an a, par ailleurs, des raisons de
considérer comme « récents », que l'article homérique se trouve le
plus proche de Varticle attique. De méme, la syntaxe de l’Odyssée
parait dans |’ensemble ‘moins archaique que celle de lJliade. Le
chant K mériterait d’étre étudié a cet égard. On y reléve des emploig
comme : K 97 é¢ rode pidanas xarabhowey ; — 277 yaipe 8k tH Bend? *O8v-
ets. De méme : K 231 6 trhpev ’O8veedc ; — K 497 thy wire. — En
K 408, le texte flotte entre néic 8° al t&v Hav Tedov pudaxal eb mig
8at... — Dans le Catalogue, on reléverait des tours comme 7 Teaco
"Apyos en B 681.
Il est souvent difficile de reconnaitre si 4, 4, 74 comporte une valgur
démonstrative ou joue le réle d’article. En d’assez nombreux passages,
il est possible que nous ayons bien un véritable article. On a pu sup-
poser qu’a l’époque d’Homére, la langue courante connaissait déja
Yarticle, mais que l’épopée conservait traditionnellement l'emploi
démonstratif de Varticle. M. M. Leumann donne comme exemples
indiscutables de Particle? : A 11 tov Xpdony,-33 6 yépav, 35 6 -yepadc,
167 tb yépac, 185 v8 adv yéaag, 54 rf Sexdrn, 106 7d xphyvov, etc... Cer-
tains de ces: exemples peuvent étre discutés et semblent comporter:
une valeur démonstrative. Mais il est bien vrai que la langue épique
trahit trés largement les progrés de !'emploi de Varticle.
§ 246. Place de l'article. Etant données, d’une part, la valeur d’ac-
cent de Varticle, de l’autre, la liberté de Pordre des mots dans le vers.
épique, rien d’étonnant qu’il se trouve souvent séparé par plusieurs
mots du terme auquel il se rapparte (cf. B 402, § 240) ou placé aprés
son substantif (cf. E 320,.§ 244). Toutefois la construction la plus
nouvelle insére entre l’article et le nom l’adjectif, ’'adverbe ou le génitif
déterminatif : A 691 tav neottpay eréav; — ¥ 336 tov Sefibv nov; —
M 280 1a & xia; — E185 te o adtod xijfex; — 8 694 & piv Spsrepos
Boyde; — B 274 of Brepbe Geol; — O 37 7 narerBbuevoy Ervydg 68a; —
© 503 4 Mpopdyoro ddyap ; cf. y 145, » 298.
1. Sur importance de ce développement, voir B. Stell, Die Entdeckung des ‘Geietes,
p. 247; A. Svensson, Eranos 44 (1946), p, 249-265,
2, Homerische Werter, p. 12, 0.4,
166 - CHAPITRE X
" Lorsque’ Dadjectif est placé aprés le substantif, il se trouve ainsi
mis en relief : A 340 703 Baothijoc dmmvéog ; — @ 317 rd rebyen nade | —
A 492 roB mai8d¢ &yavod ; — p 10 wov Ecivov Sboryvov; — v 262 sij¢ ant-
Bog... mkong | — + 372 al xives afde..
Le qualificatif précédé de Particle se trouve parfois aprés un subs-
tantif sans article : 1 219 rotyov tod éréporo ; — K 11 meStov vd Tpeomndy 5
— N 794 hot +H mporépn ; — 4 298 AvSyy... thy TevBapéou mapdxoury ; —
A535 dvruyes al mept 3ippov!; — 687 naildes tol wetémate Aerensuevor 2,
§ 247. Le sens démonstratif de l’article, parfois trés sensible, tend,
on le voit, a s’affaiblir, et la syntaxe de l’attique s’annonce. Sur ce
point comme sur d’autres, la langue épique n’a pas d’unité. Dans le
détail, la valeur emphatique de l’article fait que les exemples cités ne
peuvent pas étre toujours trés nets.
Toutefois, si l’on envisage l'ensemble des faits, il apparait que, ’ar-
ticle gardant dans une large mesure une valeur démonstrative, on
observe qu’il est beaucoup moins, fréquent chez Homére qu’en at-
tique. On trouverait ’illustration de ce fait en comparant les vers A 12
qq. avec la paraphrase de Platon, Rép. 393 d-394 a.
§ 248, Une des originalités de l'emploi de article chez Homére
est qu’il a concurrencé le pronom relatif (ef. déja I, p. 277-278). C’est
a la valeur démonstrative et présentative de l'article que se rattache
son emploi en fonction de relatif. I] s’agit d'une juxtaposition qui est.
devenue équivalente 4 une subordination : A 72 4 dd pavrooivny thy of
népe Doibog “Andddwv.
L’usage homérique appelle diverses observations qui s’expliquent
par le caractére originellement démonstratif du pronom. Au nomina-
tif féminin singulier (4) et au nominatif pluriel masculin et féminin
(a Vexception de rol, zat), il n’est pas possible de distinguer entre le
theme de Particle et celui du relatif proprement dit ; Pidentité de ces
formes a pu aider a extension du théme d’article a lemploi de relatif.”
Les formes atones de l'article (6, 4, of, al) sont accentuées lorsqu’ elles
équivalent au relatif (ef. A 388, ete...). Dans plus d'un exemple, il est
malaisé de déterminer si l'article est. proprement l’équivalent du rela-
tif ou s'il est démonstratif. A la vérité, la question ne doit pas étre
tranchée, mais les exemples montrent-lorigine de l’emploi « relatif »
de Particle. Ces cas ambigus se trouvent surtout dans I Iliade.
H 365 sqq. voter 8 dvéorn | AapSavi8ng Uplaos Oebpi whorap drddav-
106, | 8 opty bb ppovden dyophanto xal peréernev. Dans le vers 367 qui est
1. Mais it existe une variante ai, souvent préférée, avec le relatif (et le verbe étre
non exprimé)y
2, Voir, toutefois, ’édition Leaf, qui préfére lire naiBéc tor...
LES PRONOMS 467
formulaire, il semble plus naturel d’interpréter le pronom ¢omme dé-
monstratif que comme relatif ; toutefois, Yorigine de l'emploi relatif
apparait clairement. Ajoutons ‘que la tradition hésite entre 6 et 6.
© 283 aqq. natpl re ob Teupdve & a” Expege turOdv dévee | xal oe vibov
rep tévra xoplacaro & dvi ot: | tov xa TpASO” dbvra duxhelng Enfnaw. Le
mouvement de la phrase conduit A faire de 6 I’équivalent d’un relatif
et de trav un démonstratif.
E 88 aqq. viv 8” tva wat cot mévos evi wpecl wlprov ely | marBd¢ dropOiue-
voto rv ody Srobébeat abtuz.., Tout dépend du mouvement de la phrase.
Si la subordonnée ta... ef, dépend de rdv ody Sro8tEcar abtc, tov est
un démonstrati!. Toutefois, il est plus naturel d’admettre une ellipse :
« mais, en réalité, il faut qu’un deuil immense s’empare de ton coeur
pour la mort de ce fils que tu ne recevras plus ».
Autres exemples, o& I’on peut hésiter entre le sens démonstratif et
relatif : E 543, E 302, 2 326,
Il arrive pariois qu'un article, qui semble équivaloir 4 un relatif,
soit souligné par pév : ¥ 808 dcow t63e pdoyavov dpyosyrav | xardv Opnl-
mov, th piv "Acteponatov dripey (of. B 101, O 40). -
Bien des exemples sont nettement équivalents A des relatifs : A 36
*Anéikow sworn toy Plxopog Thee Antd ; — x 195 vijoov vy meph mbvtos...
torepdvarat; etc... Le tour est parfois attesté dans une complétive
proche de l’interrogation indirecte : Q 106 4202 xal de tpta tS 0” elvexa
BsGpo xddsoon.,
§ 249, Il résulte de la valeur de démonstratif du theme que Varticle
en fonction de relatif suit le nom auquel il se rapporte. Les exceptions
doivent étre discutées : 8 349 = p 140 BOA’ r& ey ot ere pepe ZAtog
vaquepvig, | tév ob8év tot xpibeo nog. — De méme : A 125 aad te yey mo-
Mery tEsnpdfojev 14 Sé8eoTm « Nous avons pillé les biens des cités, le par-
tage en est fait ». — Dans ces deux exemples, le premier +a est appuyé
par pay, le tour est originellement une parataxe.
1 467 ct 8 Bye vods ay tydov Emdqoyat, of 8 mBicAov « allons, je les
choisirai, que ceux-la obéissent ». Parataxe également, ou le second
membre est accompagné de 3¢:
Habituellement, un article en fonction de relatif ne peut répondre
4 un antécédent qui est lui-méme un article (autrement dit, on trouve
vd... 6, non 76... 76 (en fonction de relatif). Exceptions : 1 334 of 8 Aayov
robs te xe wal AOcdov abedg tAkodan ; — H 452 rob 8 eridhoovras 4d Syd nab
PoiGog "AnmddAav | ... roAlsoayev ; mais une honne partie des manuscrits
donne 6 7 éya...
Lorsque Varticle antécédent est accompagné d’un substantif, le
tour semble plus naturel : + 573 rods medxeng todg waives dt uevdporow
toiow | tovnex’... (cf. encore v 263, & 227),
568 GHAPIFRE X
'§ 250. D’une maniére générale, l'article s’emploie pour ajouter une
détermination nouvelle 4 l'antécdédent, détermination--qui peut étre
importante ou-non : A 392 xstipiy-Boweijoc thy yo Séouv-vles “Aganiy 5 —
A. 319. 27° Bodog chy npsivow deqmedyo” "AgI.; — 7 3293 aidhwxte wove
per ois Spaoe (el. 2 404, « 266, -6, ebc...).
En revanche, Particlé ne s’emploie guére en fonction -de relatil,
lorsque Ja relative comporte une valeur compktive ou explicative :
E 746-747 7 Sdpvne otlyag dvipav | tadov twisty te xotéaseta S6piyo~
ndzpy : 7 indique seulement Didentité et probablement aussi toimw,
mais il existe une variante ole qui exprime mieux la nuance expli-
cative (noter aussi le subjonotif); — 1°592 ichfe’ So’ dvOpdroim rider
rév Hoty dhe; — Z 208 chy dior éuquucyovrm avec Pindicatif peut tre
considéré comme une parenthase ; — = 257 gpdtev 8 xév tic vditv diver
npégpax. Guns : le rapprochement de 4 et de n¢ est remarquable.
Remarques. — 1. Ila pu arriver que le théme de article ait été intro-
duit pour parer A un hiatus résultant de la.chute du digamma :
P 145 adv daoter rol “Iakey éyyeydacty peut recouvrir une lecon ov
raots of (Flue yyeydacw. = *
II. L’article en fonction de relatif peut étre associé 4 1a particule
se. Ou pourrait penser que ts a une valeur copulative et qu’il faut
analyser vol 7e on.« et ceux-ci », En réalité, Pexamen des exemples
montre que Particle équivaut par lui-méme_au relatif et la particule
ve Ini confére la méme valeur qu’elle confére au relatif (ef. §§ 354 sqq.}
§ 254. La langue épique possade les mémes démonstratifs que
Vionien attique*.
“O8e désigne un objet prothe du personnage qui parle A 334 ws r88e
oxirrpov « par ce sceptre que je tiens ». — En particulier.en parlant
de personnes ou de choses que l’on peut montrer : Z 460 “Bxtopoc 48
yor; — « 76 fyeis ole reprppatdyeOa « A nous ici de songer,.. »
F 193 etn’ dye por xat sév8e, gov cheas, &; nig 88" tort (ef. P 467 aq.) ;
méme reprise de &e dans la subordonnée en.E 4175, ete...; — a 226
odx Epavoc rte 7° éort « il ne s'agit pas isi P’éoot »; —.1 348 offv 1 no-
aby 768s vac dxexedfety | hueréens
Le sens du pronom se définit diversement suivant le contexte :
M 232 oleGa xal EXov piGov duetvova rode vojou «tu sais pourtant avoir
des idées plus heureuses qué celle qué-tu viens de dire », — Noter
Pemploi avec le pronom de premidre persorine : 7 205 68° ty... fuBov ;
— 9 207 soy av 8} 65° abths éyo. — Parfoia a propos d’un absent
dont on veut évoquer la présence : 352 of Ony 3} 1058" dvBpdo ‘OSuc-
1, Schwyzor-Debrunner, p. 209, avec la bibliographie, ot notamment W. Havers,
1. F. 19 (1906), p, 1-98; Magnien, B. S, L, 23 (1922), p. 156-183.
LES PRONOMS 169
aijoc qlag vidg... « ce nest pas le file de ce héros Ulysse (qui ira cou-
cher a bord...) ».
§ 252. Le pronom odtoc présente chez Homére les emplois suivants.
I] désigne un objet assez proche et semble concerner souvent la seconde
personne : K 82 Tie 8 obtog xatd vias dvd otpardv Epyeat olog « Qui es-tu,
$oi qui vas aingi seul? » Cet emploi est resté usuel en ionien attique.
Autres exemples ot le rapport avec la seconde personne est égale-
ment sensible : H 110 od8€ ci oe yo} | tabrys dqpoatvns ;’— B 40 ody éxds
dros dvip « Thomme dont tu parles n’est pas loin »; — 6 306 tabra 3é
ToL... mdvta tedeuthapuey ‘Ayal «les Achéens feront tout ce que tu dé-
sires »; — en I 178, oSvog répond a 88e de Ja question au vers 167.
Odtog désigne parfois un objet assez éloigné (cf. plus loin Yopposition
avec 68) : A 612 Néorop’ Spzto | Svriva coltoy &yer « quel est celui la-bas
qu’il raméne »?
Tl est normal d’utiliser obtog pour désigner des ennemis : E 257
mole & od nddev anc drolaetay dudes Inmov; — X 38 ph por pluve, prov
rhtog dvéga toitov.
Fgalement avec une nuance de mépris : E761 dgpova cobtov dvévres
« en déchatnant ce fou » (cf. 831, 879); — « 159 todroow phy cadre
ude. (& propos des prétendants).
C’est, comme on IJ’attend, en s’opposant I’un 4 lautre que se pré-
*cisent les sens de §8e et adroc. Ainsi au sens local : v 345 @édpxuvoc piv
88" tort Auhy... toire 3€ tot onéos... EvOa ot... « ici c’est le mouillage de
Phorcys ; 1a c’eat Ja caverne of tu... »; opposition de la proximité et
‘de I’éloignement, mais 6% garde des rapports avec nous, odds, avec
toi; — de méme : ¢ 343 sqq. etpara tabr’ droSbc... TH Sé, 1682 xphSepvov
dnd otépvoio taviesae « quitte ces (tes) vétements,... voici ce voile (mon
voile)... »; — © 109 vodre piv Oepdnavre xopslrev, Thde S¢ vee | Tpacly ép’
tremoSduotg Wivonev « ces deux chevaux-la (que nous laissons), que nos
écuyers s’en oceupent ; ces deux-ci, nous les dirigerons nous-mémes
contre lés Troyens... ».
Sur un autre plan, 3¢ annonce généralement ce qui suit, obtos se
rapporte 4 ce qui précéde : 5 485 aqq. tutta wev otra S54 reAéw, yépov, de
od usreverg | dN’ Bye por Té8e elmé... « ce que tu m’as prescrit, je le met~
trai & exécution, mais dis-moi ceci... ». Jl est exceptionnel que cdr¢
se rapporte a ce qui suit (et semble-t-il avec insistance et référence a la
seconde personne) : u 112 ef & dye 34 wor toito Bet vnpeptic evtomes « al-
lona, dis-moi donc, déesse, cette autre chose encore... »; —I' 177 todr0
Bt vot epéw & py’ dvelpeat.
§ 253. Le pronom xeivos désigne la personne ou I’objet que l’on con-
sidére comme éloigné : I 391 xeivog 6 y’ Ev OaArduy « i] est la-bas dans
170° CHAPITRE X. — LES PRONOMS
votre chambre » (xetvog est prédicat) ; cf. encore T 344; — o 239 &¢
Sv "Ipog éxetvos én’ abdelno: Apna; — E 604 xat viv of mipa xeivoc "Apne
« aupres de lui, la-bas, c’est Arés... ». —- Souvent en parlant d’un ab-
sent : «177 énet nal xetvoc Exlatpoqos fy dvOpezev. — Pour marquer |’éloi-
gnement dans le temps, notamment dans le passé : B 330 xeivocg tH¢
dyépeve « ce jour-la, voila ce qu'il a dit... »; — a 46 xal Any xetwig ye
doudt, xetrar dr€6p~... EAL por dup’ *OSuoy « celui-ld n’est tombé que
d'une mort trop juste... »; — y 195 420’ Hrou xetvoc wey émopuyepéig dad-
stwoev. — Parfois dans lavenir : T 440 viv uty yap Mevédaog tvlenaey ov
Adin | xetvoy 8 adtig eyed « 8i aujourd’hui Ménélas a vaincu, c'est grace
a Athéné; une autre fois, j’aurai mon tour »,
Ce pronom s’est peu a peu vidé de sa valeur propre et se trouve déja
attesté, déja chez Homére, avec une valeur simplement emphatique :
0.90 shnte pe xetvos dvwye usyas Bedg... « eb pourquoi me demande-t-il
ce dieu tout-puissant...? »,
§ 254. Un trait remarquable de la syntaxe de ces démonstratifs
chez Homére est que ]’article ne leur est pour ainsi dire jamais associé.
Voici les seuls exemples : + 372 at xivec atSe ; —o 114 (pugilat d’Ulysse
et d’Iros) zoiitov tov dvadtov ; — B 351 xeivov diopévn vov xdupopov...; —
en N 53, il vaut mieux lire 6 y’ 6 AvoodSys que 63° 6 AvacdIyg.
CHAPITRE XI
LE VERBE
GENERALITES : LES VOIX
§ 255. Le systéme verbal homérique posséde les catégories verbales
diverses qu’il a héritées de l’indo-européen et que le grec postérieur a
conservées : voix, temps et modes.
Le systéme des voix! se définit par l’opposition de l’actif et du
moyen. Toutefois, il ne peut pas étre constitué un systéme moyen sur
n’importe quel verbe actif, et il existe, d’autre part, des verbes uni-
quement moyens.
Les verbes dits actifs peuvent étre soit ‘transitifs, soit intransitiis.
Un verbe signifiant « porter » comme gépe est normalement suivi d’un
complément a l’accusatif. Au contraire, des verbes qui indiquent une
maniére d’étre ou un état du sujet comme 6#de « fleurir », fda « vivre »,
spéye « courir », elut « aller », sont normalement intransitifs.
Les verbes transitifs ne sont pas nécessairement suivis d’un complé-
ment d’objet & l’accusatif : p 478 tof’ Sepdoc... « mange tranquille-
ment »; — p 273 get’ tyvenc « tu as facilement compris... ».
L’emploi absolu de certains verbes généralement transitifs est, no-
table : A722 noraydg Mivuines sic dda BdrOv?; — 1 130 4 (xprun) 8 Erépw-
Bev in’ adriie ob8dv Eqor (cf. 2 239) ; — pour le verbe tyetv, on a N 520 &°
Gyo 8 bepiwov Eyyos | Zoyev « la robuste lance passa 4 travers l’épaule »;
— N 679 byev f t& mpdita whdug nal telyos dakar « Hector se tenait a l’en-
droit ot... » (of. M433, 2 27); — + 38 xloves dda’ Exovres « des colonnes
qui s’élavent trés haut ». — De méme : few « s’asseoir » (Y 15); —
Sevetv « tourner » (Z 494); — ompllew « s’appuyer sur » (uy 434); —
redaCew « approcher » (M 142); — ovew « pousser » (Z 149).
Remarques. I. L’emploi intransitif est parfois réservé a certains
thémes. Parfait comme 2éAoimev « manquer, quitter » (A 235, & 134,
1. Schwyzer-Debrunner, p. 247 et 222, avec la bibliographie citée; Kowaleck, Uber
Passiv und Medium, Programme Dantzig, 1887; H. Grosse, Beitrige s. Syntax des
grieck. Mediums und Passioums, Programme Dramburg, 1889 et 1891.
2. Bn) 424, $42.)0v peut signifier « je m’abattaisd terre» (mot? yx‘), comme Pen-
tond Wilamowitz, Hom. Ui t., p. 158, mais on lui donne souvent comme complément
he GHAPITRE XI
“ 243); aoriste radical comme tory (B 104, etc...; usage également
constant en attique}.; — Evpage « étre nourri, élevé » (B 661, E555,
H 199, XZ 436, etc...); cet aoriste n’a jamais le aens transitif; —
Erpume « se tourner » (IT 657}, mais ailleurs cet aoriste est transitif.
JI. Un verbe comme piview est généralement intransitif (II 392,
ate...), mais parfois transitif. (cf. & 47, O 492-493) ; — Ahyew, géné-
ralement intransitif, est transitif en N 424, ® 305, y 68; l’accusatif
peut étre un accusatif de relation en N 424 Ajye wévoc, mais non en
% 68 yeipas bids Affarut govern.
IIL. © 54% orpépavrec signifie soit « en faisant demi-tour », soit
«en faisant tourner leurs. bétes » (cf. § 12).
Iv. Lemplot intransitit de val « étre situé » (B 626) et surtout
vatetdo (x 404, 8 497, & 45), en particulier au participe eb vauentov
{B 648, Z 415,-etc...}, reste obscur, M. Leumann tente de la tirer
dune fausse interprétation de T’ 387, 0 vuetaosey aurait été rap-
proché &-tort de AcxeBefrow (Homerische Worter, p. 19% sqq.).
§ 256. Vemploi absolu d'un theme verbal s’observe yolontiers dans
les yerbes composés, ot Je prévérbe précise la modalité de mouve-
ment, Ainsi : ovuGdxrew « 8¢ rencontrer » (II 565); — npotyew « étre’
en saillie » {X 97) ; — draview « faire le chemin » (y 326) ; — drodetrew
« cesser » ( 117) ; — évedve, « se lancer dans » (6 295), mais Yaccusatif
vijac est peut-dtre sous-entendu ; — napaxdlver « dévier » (¥ 424), mais
trove eat, pout-étre sous-entendu ; — Expépay « filer » (‘¥ 376) ; — dmex-
pepe « filer » (y 496); — xporinrew « charger, s’élancer » (N 136); —
dverafEm « se heurter» (M 72, Q 344); etc...
L’emploi absolu d’un théme verbal semble parfois résulter de Vel-
lipse d’un complément d’ ‘objet, notamment avec le verbe daaivev. On
dit bien ; E 236 sqq. ... &daoy, wdwoyxac trmoug | ... Bovve re” dppocta xat ceed
tomo ; aU encore : » 109 viaje Gohy vt mévrg Havvéwev; — mais aussi : 0 50
od mag Sore... | wera Sd Svopephy dav ; et, dans une formule fréquente :
paatiEey 8” baav (E 366, etc...); de méme, 4 propos d'un navire : y 157
jurotes 8’ dvatdvres emivouev. — Les exemples de orpégew (E 544), ene
vat (B 295) et mapaxdtvery (‘¥ 424), cités plus haut’ doivent peut-étre
s’expliquer de la méme fagon (cf. § 12).
§ 257. La catégorie des voix (SaSécerc) et, notamment, l’opposition
entre l’actif et le moyen sont malaiséos.4 déterminer rigoureusement.
On a observé depuis longtemps que, surtout aux temps secondaires,
la voix moyenne semble parfois s’employer sans nuance de sens parti-
culiére. La notion de moyen (ueodeys) était peu précise aux yeux des
thg yeinag qui est deja complément de défpw. Voir sur Pamploi intransitif de Bai
dety, Stahl, Rhein, Mus., 66, 1911, p. 626 aqq., et Ed. Praonkel, commentaire d’ 4 ga-
mernon, p. 534; cf-eneare WY 462, 639.
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5820)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1093)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (898)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (349)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Cultura Clásica Contenidos Examen 2 EvaluaciónDocument1 pageCultura Clásica Contenidos Examen 2 EvaluaciónAnabel PoquetNo ratings yet
- Trabajo 2 Eval.Document1 pageTrabajo 2 Eval.Anabel PoquetNo ratings yet
- Ejército GriegoDocument4 pagesEjército GriegoAnabel PoquetNo ratings yet
- 7Document36 pages7Anabel PoquetNo ratings yet
- 5Document51 pages5Anabel PoquetNo ratings yet
- 8ºDocument26 pages8ºAnabel PoquetNo ratings yet
- 3Document32 pages3Anabel PoquetNo ratings yet
- 4Document42 pages4Anabel PoquetNo ratings yet
- 2Document36 pages2Anabel PoquetNo ratings yet
- Libro ItalianoDocument33 pagesLibro ItalianoAnabel PoquetNo ratings yet
- Graella Buidat de VocabulariDocument3 pagesGraella Buidat de VocabulariAnabel PoquetNo ratings yet
- Oraciones GriegoDocument4 pagesOraciones GriegoAnabel PoquetNo ratings yet
- Texto CicerónDocument3 pagesTexto CicerónAnabel PoquetNo ratings yet