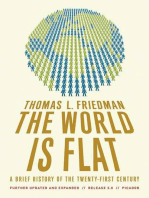Professional Documents
Culture Documents
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
18 viewsGerard Blain La Haute Tension
Gerard Blain La Haute Tension
Uploaded by
mtstCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5822)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1093)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (852)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (898)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (349)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (403)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Films of Carl-Theodor Dreyer (David Bordwell)Document262 pagesThe Films of Carl-Theodor Dreyer (David Bordwell)Ana-Maria GheorgheNo ratings yet
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Cohn - Mallarme's Prose PoemsDocument152 pagesCohn - Mallarme's Prose PoemsmtstNo ratings yet
- LenormandDocument38 pagesLenormandmtstNo ratings yet
- Personal - Empleo Tiempo RendimientoDocument1 pagePersonal - Empleo Tiempo RendimientomtstNo ratings yet
- Malvinas Cronologia y ArgumentosDocument6 pagesMalvinas Cronologia y ArgumentosmtstNo ratings yet
- Artes Visaules - FichaDocument2 pagesArtes Visaules - FichamtstNo ratings yet
- La Revue Du Cinéma Image Et Son N°280 (Janvier 74)Document6 pagesLa Revue Du Cinéma Image Et Son N°280 (Janvier 74)mtstNo ratings yet
- Lenormand 1Document80 pagesLenormand 1mtstNo ratings yet
- CV Mara Florencia CornideDocument2 pagesCV Mara Florencia CornidemtstNo ratings yet
- Historias Del ConcursoDocument3 pagesHistorias Del ConcursomtstNo ratings yet
- Calculo de F.O.S. y F.O.TDocument4 pagesCalculo de F.O.S. y F.O.TmtstNo ratings yet
- Von StroheimDocument391 pagesVon StroheimmtstNo ratings yet
- Cinéma N°163 (Février 1972)Document5 pagesCinéma N°163 (Février 1972)mtstNo ratings yet
- BRENEZ Nicole Approche Inhabituelle Des CorpsDocument5 pagesBRENEZ Nicole Approche Inhabituelle Des CorpsmtstNo ratings yet
- Ozep 121 Mackenzie SovietDocument6 pagesOzep 121 Mackenzie SovietmtstNo ratings yet
- The Tempest (Unproduced Script by D Nichols & J Renoir)Document93 pagesThe Tempest (Unproduced Script by D Nichols & J Renoir)mtstNo ratings yet
- 9042034580Document316 pages9042034580mtstNo ratings yet
- Gracq Julien - Entretiens 2012 CortiDocument124 pagesGracq Julien - Entretiens 2012 CortimtstNo ratings yet
Gerard Blain La Haute Tension
Gerard Blain La Haute Tension
Uploaded by
mtst0 ratings0% found this document useful (0 votes)
18 views7 pagesOriginal Title
GERARD BLAIN LA HAUTE TENSION
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
Download as pdf
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
18 views7 pagesGerard Blain La Haute Tension
Gerard Blain La Haute Tension
Uploaded by
mtstCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
Download as pdf
You are on page 1of 7
ETUDE
GERARD BLAIN :
la haute tension
par Jacques Grant
Plusieurs approches importantes
du cinéma de Gérard Blain ont déja
été esquissées dans Cinéma
depuis 1972, en particulier deux
entretiens (n° 163 et n° 212-213);
['avais également parlé du cadrage
et du son dans son cinéma au
cours d’un long article sur Un
enfant dans la foule (n° 212-213).
J’ai donc parlé d’autres choses
dans le texte ci-aprés, qui, sans
ces précédentes approches, serait
trop lacunaire, en particulier pour
ce qui concerne la caméra. Je ne
parle pas non plus spécialement de
son dernier film Un second souffle,
a l’occasion de la sortie duquel
pourtant nous avons 6établi ce
dossier-auteur: Mireille Amiel,
rappelons-le, I’a analysé dans notre
numéro 236.
«Etre roi est idiot; ce qui
compte, c’est de faire un
royaume. »
(André Malraux, La Voie royale)
On aurait tort de croire qu’avec Un
second souffle Gérard Blain a aban-
donné le personnage de Paul— Paul,
enfant de Un enfant dans la foule,
Paul, l’'adolescent des Amis, Paul, le
pére du Pélican. Paul qui est bien de
Sa personne, qui apprend la comé-
die, qui se fait former et aider par un
protecteur, qui a une liaison avec un
homme plus agé substitut du pére, qui
aide samére a payer son loyer, etc. Paul
a tout simplement changé de sexe, et
s’appelle Catherine.
Les obsedés de |’autobiographie
sont passés a cété de la plaque:
Gérard Blain, 47 ans, sportif comme
son héros et encore plus beau que
lui, aimerait-il les petites filles, se
demandent-ils en voyant Catherine ?
Sar que ce ne serait pas inintéres-
sant de le savoir, mais le « hic » est
que dans Un second souffle Blain est
a chercher plutot du cété d’Anicée
Alvina que de Robert Stack. Gérard
Blain, 47 ans, sportif et phallique, a
de la femme en lui. Et les voila bien
avancés, les obsédés de |’autobio-
graphie, puisqu’il se trouve qu’il n’y
arien de plus universel que ¢a.
LE PERE DU
Le Pélican. Paul, 40 ans, qui sort
de dix ans de prison aux Etats-Unis,
retrouve Marc, son fils, 12 ans, ravis-
sant et bien élevé, élevé par sa mére
et un riche beau-pére ; Marc pour qui
il est inconnu. Paul vient de révéler a
Marc qu’il est son pére. Marc (bien
élevé et pas trés rassuré, il vouvoie
son pére): « OU vous étiez ? — En
Amérique. — En Amérique, j’aimerais
bien y aller ».
Mais Paul ne peut que se taire, et
se renfermer dans son vieux costume
gris terne. Il n’a rien a raconter sur
"Amérique & ce gargon qu’il veut
conquérir. Bouleversant. Dans le
Pélican, seul film de Blain ou le vrai
pére (le pére physiologique) est pré-
sent, il 6choue dans la conquéte de
son fils parce qu’il n’est pas un
séducteur fascinant du tout.
Une image d’un autre film s’inter-
pose en moi : cette scéne d’Enquéte
sur la sexualité de Pasolini ou un
ouvrier en gréve parle contre la
famille, visage épanoui a l’idée d’un
monde idéal ov des _ institutions
d’Etat s’occuperaient des enfants
des hommes...
Je me sens alors respirer, au coeur
de la douleur blainienne: état de
grace de ce cinéma, qui m’attire loin
des sourires béats et fanatiques, qui
révent de sociétés égalitaires ou on
livrerait les enfants aux Eglises. Dans
un monde menacé par les théories
progressistes du Pouvoir et de |’Etat,
«On le voit, c’est simplement le
principe du plaisir qui détermine le but
de la vie, qui gouverne dés I'origine
les opérations de |’appareil psychi-
que ; aucun doute ne peut subsister
quant a son utilité, et pourtant I'uni-
vers entier — le macrocosme aussi
bien que le microcosme — cherche
querelle 4 son programme. Celui-ci est
absolument irréalisable ; tout l’ordre
de I’univers s’y oppose; on serait
tenté de dire qu'il n'est point entré
dans le plan de la « Création» que
homme soit « heureux », Ce qu’on
nomme bonheur, au sens le plus strict,
résulte d'une satisfaction plutét sou-
daine de besoins ayant atteint_ une
haute tension. Sigmund Freud
tous les films de Blain éveillent un
autre réve : ici terne, la brillante, une
image de pére me désirant. Ce que,
@ propos du Pélican, Barthes appelle
« l'inversion audacieuse du complexe
d’CEdipe ».
Ailleurs, dans les autres films, le
pére a fichu le camp : « Salaud! », dit
le petit Paul, irrémédiablement.
LA MERE VEILLE
Qui croit que chez Blain les comé-
diens ne jouent pas, ne verra rien.
Mais nous, nous voyons Annie
Kovacs (Un enfant dans la foule), la
jeune mére du petit Paul abandonnée’
par son mari, le regard vidé et inex-
pressif, terrifiant comme une vierge
romane, regardée par les yeux noirs,
brdlants et pétillants de César Chau-
veau, le fils. Nous voyons Francia
Séguy (le Pélican), la vieille mére
solitaire de Paul adulte, le regard
implorant et résigné, émouvant
comme celui d’une orpheline, regar-
dée par les yeux débordant de pitié
impuissante de Gérard Blain, son fils,
qui lui donne de |’argent en cachette.
Machines a coudre, planches a
repasser, loyer payé par son grand
fils : la mére immobilisée chez elle.
Abandonnée par son mari, elle
n’aime pas son fils. Yeux baissés, en
plan fixe et général, sur le mouve-
ment de l’aiguille ou sur le fer a
repasser, elle ne regarde pas son
enfant. Pendant ce temps, le jeune
Paul, qui traine ou il veut, s’arme
pour la vie. Objet de désir, monnaie
d’échange, il se sent violemment
exister par tous les hommes qui pro-
fitent de lui. Choisi, il peut choisir. 1]
n'est pas une victime : sa volonté se
forme, contre et par sa mére. Elle,
cependant, immobilisée, est la vraie
victime. (Méme Sophie Desmarets,
femme admirable de Robert Stack
dans Un second souffle, en tant que
mére, se contente de scander la vie
de ses enfants avec leurs anniversai-
res).
A ce moment, image en moi d’un
des plus beaux mélodrames du
cinéma, la Tragédie de la rue de
Bruno Rahn. Film muet. Un panneau-
titre : « LA MERE ». Plan qui suit: sa
table dressée dans sa cuisine. Je
vois aussi la Maman Kuster de Fass-
binder travailler chez elle pendant
que son mari se suicide a l’usine.
Travailler chez elle, comme dans les
films de Blain. Ce n’est pas de fem-
mes aliénées par le travail (ou autre
chose) qu’il s’agit dans ces cinémas-
la; pas de travail-alibi, mais le poin-
tage d’un lieu cinématographique
fort. Dans the Shooting, le si beau
film de Monte Hellman, pas
d’impression de désert, mais des
images de désert — sa terre craque-
\ée, sa poussiére, filmée abrupt. Le
désert dans I’écran. La piéce ou
coud la mére, dans Un enfant dans la
foule: couleurs et composition de
tableau de maitre hollandais. Les
yeux vidés de la vierge romane dans
un cadre évoquant l’immobilité éter-
nelle qu’est la peinture : sur-codage
d’images de mort. Dans le Pélican, la
mére au regard implorant se pré-
sente alors a moi comme image de
mort au travail.
Emouvante, la victime. Mais surtout
terrifiante et mortelle. La faucheuse
veille. Mére/mort. Le petit Paul doit
étre trés maitre de lui pour dépasser
ga — pour vivre. Il apprend a l’étre.
LA VOLONTE DE PLEURER
Dans tous les films de Blain, le per-
sonnage principal observe quelqu’un
d’autre sans 6tre vu. Ce qu’il observe
est toujours fort, violent, déterminant
(j'ai compté sept de ces moments
forts dans Un second souffle). Per-
sonnages qui gardent, enferment,
réfléchissent, en eux. Gardent pour
eux. A rapprocher de cette scéne
des Amis, ot Paul, qui vient
d’apprendre la mort violente de son
ami, va pleurer seul — 1a ou per-
sonne ne verra sa douleur.
Les trois Paul pleurent. Pas pour
s’exposer a la Consolance de leurs
partenaires. Les Paul pleurent parce
que c’est une des beautés de
"homme que de pleurer.
Les Paul de Blain sont phalliques
— et donc pas phallocrates.
L’homme pas fier de son phallus, ce
serait comme la femme pas fiére de
son vagin : il compenserait — ce que
fait le phallocrate Francois dans Un
second souffle (cf. ce qu’écrit
Mireille Amiel sur la démultiplication
de son personnage sur ceux qui
Ventourent). Phalliques, les Paul sont
comme le chéne de la fable: ils ne
se courbent pas, mais leur implanta-
tion est fragile. Quand une hache
commence a les couper, ils saignent.
On peut compter sur les doigts
(d’une main et demie) les cinéastes
qui font ou ont fait des portraits
d’hommes. Je les cite, parce que
cest l'occasion de leur rendre
hommage et que c’est a peu prés
ceux que je préfére: Mankiewicz,
Ford, Sirk, Fassbinder, Hitchcock,
Aldrich, Grémillon. Et Blain. Chez
tous, des hommes phalliques et fragi-
les. Ah! le Gabin de Gueule
d’Amour ! Ce qui les détermine, ce
n’est pas, comme chez les cinéastes
phallocrates, la femme. Ce ne sont
pas des jouets, et donc, pas manipu-
lables, ce ne sont pas des tordus:
enfin étres humains, les hommes de
ces cinéastes rares ont toute leur
sensibilité et sont mus par elle.
Chez Blain, la saisie de leur sensi-
bilité est ceuvre de volonté. La sensi-
bilité envahissante des trois Paul leur
permet de manifester |’acte primor-
dial de volonté : le refus. Admirable
petit Paul de Un enfant dans la foule
qui, passant de mains en mains en
tant que belle image de petit homme,
s’aiguise le caractére en s’en allant,
sans tambour ni trompette (je parle
de la mise en scéne), de toutes ces
mains.
La grandeur douloureuse qu’il yaa
garder pour soi ce qu’on découvre,
c’est le signe de la volonté des hom-
mes de Blain, et que leur volonté
nest pas volonté de puissance :
volonté de se renforcer soi. Les
héros positifs sont des personnages
d’évasion. Dans le cinéma de relation
avec le spectateur qu’est celui de
Blain, les héros ne réussissent rien,
ne sont pas positifs : ils mettent en
branle un processus de volonté dra-
matiquement contrecarré — je veux
dire contrecarré par la dramaturgie.
Le cinéma de Blain, c’est la mise en
scéne de cette tension. Beauté tragi-
que du phallus.
( — Noter qu’on n’a jamais vu
dans les quatre films de Blain une
femme regarder sans étre vue.
Noter en méme temps que Cathe-
rine, dont j’ai dit qu'elle était Paul,
ne pleure pas. J’ai d’ailleurs été
obligé dans ce chapitre de parler
des « trois Paul », pour ne pas con-
fondre. C’est que la femme est plus
forte que l'homme, au départ ; elle
est le roseau ; le cété roseau de
Paul/Catherine |’empéche de pleu-
rer dans Un second souffle. Si
Blain et les six autres cités plus
haut ne pensaient pas que la
femme est plus résistante que
l'homme, ils ne feraient pas de por-
traits d’hommes, bien sar.)
LA FOIRE
DES LIBERATIONS
Un second souffle. Francois, 50
ans, qui veut avoir l’air ouvert, recoit
chez lui le petit ami de sa petite
amie. Beau footballeur de 20 ans qui
aime le mouvement et le dit. Fascina-
tion coincée de Francois (plus tard, il
ira observer ses fesses dans les ves-
tiaires du stade), qui met son éternel
disque de hautbois d’amour. « C’est
le mouvement que je préfére », dit
Francois.
Francois, riche, est un homme
calme, tranquille. Francois (pas Paul,
donc) est le seul personnage princi-
pal d’un film de Blain a ne pas pleu-
rer.
Francois, image de ce que Pierre
Legendre appelle « /’annonce du gou-
vernement souriant», Frangois qui
pratique «cette idiotie: qu’il est
interdit d’interdire ».
Analyse terrifiante du fascisme
ordinaire, dans ce personnage joué
Yann Favre (Paul adolescent) et Philippe March (Philippe), dans les Amis
En haut : plage publique, comportement osé et géné ; en bas, entre eux :
comportement retenu et détendu.
par Robert Stack : croyant, ou faisant
semblant de croire, que |’interdiction
est la marque supréme de |’oppres-
sion, il procéde, sur ceux avec qui il
vit, € coups d’obligations. Inscrite a
longueur de pages et de discours
dans toutes les idéologies de « libé-
ration », la notion d’obligation, que
Barthes a fort lucidement analysée
comme étant la caractéristique fonda-
mentale du fascisme, ne fait pas illu-
sion a Blain. Essentiel pour compren-
dre Blain: il se moque des interdic-
tions — et méme, il en pratique lui-
méme : tout son cinéma est un tissu
de choses qu’il s’interdit. L’obliga-
tion, la contrainte, c'est la le vrai dan-
ger. Francois retirera ses billes en
jouant admirablement de |’aveugle-
ment des deux petits jeunes: si je
n’interdis rien, c’est que je vous
laisse vivre et vous respecte. En fait,
il les améne 1a o¥ il veut — et au
bout du compte a lui foutre la paix.
Lorsqu’il se rend compte que l’avenir
est trop difficile entre lui et sa petite
amie, il n’a plus qu’a l’obliger a le
quitter... A rapprocher du beau film
injustement_ décrié de Visconti:
Violence et Passion.
La ou Blain est un formidable
cinéaste, c'est en ce que (tout
comme Fassbinder) il rend cette hor-
reur émouvante : Francois se retrou-
vera seul avec son hautbois d’amour,
son appartement design et ses peti-
tes prostituées pulpeuses de la Porte
Dauphine, repoussé avec une ten-
dresse déchirante par sa femme qu’il
essaie de reconquérir. Blain ne
dénonce pas I’horreur — toute
dénonciation fait le jeu de tout
Systéme —, il la rend déchirante.
Vraie grandeur.
LA PRODUCTION
GERARD BLAIN
lly a pourtant un vrai personnage
de salope, jamais émouvante, dans le
cinéma de Blain : la sceur de Paul. Je
trouve qu’il régle pas mal ses comp-
tes avec elle, lorsque, dans Un
enfant dans la foule, il se débarrasse
d’une de ses robes pour en faire un
drapeau le jour de la Libération de
Paris.
Sans doute que Blain a un sérieux
contentieux — si on reconnait un
grand cinéaste a sa capacité a ne pas
enfoncer les étres, ce ne peut étre
que parce qu’il a une obsession, un
ennemi, irréconciliable. Chez Ford,
c'est les bigotes. Chez Blain, c’est la
sceur.
Donc, la sceur, parfaitement détes-
table. Dans une scéne des Amis, elle
est trés dure avec sa mére: jeune
mariée, elle ne veut plus emmener sa
mére en vacances pour ne pas
Vimposer a son mari.
Elle est dure, mais elle a raison,
bien sdr. Ainsi donc, ce qui fait
Vatroce de cette scéne, ce n’est pas
ce fait, cette décision, c’est le ton
sur lequel la fille, la parfaite salope,
parle.
Ce qui intéresse Blain, c’est, a tra-
vers les rapports et comportements,
Vémotion. Et le maximum d’émotion
possible : plus la fille sera filmée froi-
dement en train de dire ca, avec le
ton sordide sur lequel elle le dit, plus
ga sera douloureux a regarder.
On touche 1a ce qui est a mon avis
le plus grand contresens fait par la
critique sur Blain: qu’il serait un
cinéaste austére, retenu, pudique,
etc., alors qu’il utilise les moyens les
plus efficaces pour toucher. Voir la
scéne des Amis ow Paul apprend la
mort de Philippe. Ga se passe dans
la loge de la concierge de |’immeu-
ble, et c’est filmé de l’extérieur, du
hall de l'immeuble, a travers une
vitre. On n’entend donc pas ce que la
concierge lui dit, comment elle le lui
dit. Dans le cinéma « nouveau natu-
rel», cette annonce aurait au con-
traire été un morceau de bravoure :
on aurait fait attention a tout sauf a la
douleur, qui doit nous pénétrer, du
personnage ; ce n’est pas, ici, une
fagon de vivre la douleur (« une
sceéne de douleur ») qui nous est pré-
sentée, c’est la douleur en tant
qu’essence, la douleur telle que
NOUS (spectateurs) la connaissons,
c'est-a-dire la douleur la plus pro-
fonde, qui est appelée par cette mise
en scéne — par cette mise en scéne
d’un cinéma qui nous renvoie a nous.
Il ne s’agit pas de dire que Blain
invente le cinéma: pour continuer
sur ce méme exemple de filmage a
travers une vitre, on sait que Hitch-
cock |’a déja magistralement utilisé
pour des effets d’angoisse. Ce dont il
s’agit, c’est de voir comment, par ce
procédé, nous sommes _atteints:
accompagnée non pas par les bruits
qu’on entendrait dans la vie (la voix
de la concierge), mais par la musique
douceatre qui poursuit Paul depuis le
début du film, accompagnée donc par
ce qui est devenu notre normalité
cinématographique des Amis, cette
douleur NOUS rend la scéne émou-
vante au maximum. Aprés ga, Paul ne
peut qu’aller pleurer seul dans le bis-
trot dont nous parlions plus haut:
une douleur pareille, ¢a ne se
disperse pas. Mais ca a eu la grace
de nous pénétrer dans sa totalité. Je
Vavais déja écrit un autre jour : si les
mots ont un sens, le « cinéma
direct », c'est celui des gens comme
Blain ; un cinéma qui nous atteint —
qui ne nous laisse pas intacts.
Cette débordante impudeur du sen-
timent dans le cinéma blainien a pour
corollaire, par contre, fréquemment,
une extréme abstraction narrative —
tout a fait comparable, bien que sur
un autre mode, a la mécanique évé-
nementielle chez Hitchcock. Exem-
plaire sur ce plan: l’exposé de
Vescroquerie proposée a Paul au
début du Pélican: le dialogue entre
Paul et le type est fait en termes
absolument abstraits, réduit a sa
structure ; on ne saura pas en quoi
consiste l’escroquerie dans ses
détails, tout ce qu’on doit savoir c’est
qu’elle s’installe et qu’elle aura lieu.
A cet égard, pas de doute que le
plus bel accident de voiture de |’his-
toire du cinéma est celui de la fin des
Amis, qu’on ne voit pas. On |’entend,
par contre, et trés violemment,
depuis la station d’essence ow Phi-
lippe March vient de téléphoner.
Aucun plan sur Philippe March tué, ni
sur la voiture. Au moins aussi retors
que Bresson, Blain ne nous attendrit
pas avec ce genre de plaisir: on ne
verra plus I’homme que Paul aime.
Jacques Frenais me dit que chaque
fois qu’il voit le film il pleure quand
arrive cette scéne: cette scéne
d’absence, ce type d’émotion que
seul le cinéma peut fabriquer.
(Notons au passage que la scéne de
la concierge, qui suit, est donc sacré-
ment préparée ! Ayons donc enfin la
lucidité de dire que, sur le plan de
’émotion, Blain ne retient rien, mais
cadre tout pour se permettre d’en
mettre des tonnes. Blain : pas dugenre
atoucher du boutdesdoigts.)
Mais la douleur n’est pas la seule
modalité d’émotion spectatrice de ce
cinéma, loin de la. Voyons par exem-
ple les premiéres minutes du premier
film de Blain. Les Amis s’ouvre sur
un gros plan de souliers lustrés par
un cireur public ; aprés ca, le bel
adolescent qui les porte s’arréte
dans la rue pour voir une femme des-
cendre d’une voiture a chauffeur,
puis entre dans une station de métro
ou il achéte un billet de premiére, et
reste débout, figé, alors qu’il est
seul, dans son wagon de premiére.
Une vérité extrémement forte du per-
sonnage s’est imposée 4 travers tou-
tes ces images sans psychologie : un
adolescent qui observe son élégance
et n’est donc pas trés sir de lui.
Bien mieux que des informations,
qu’on oublie toujours vite: une
image cinématographique s'est ins-
crite dans notre sensibilité stimulée
par un montage fixe et coupant. Elé-
gance raffinée, désirable et légére-
ment ironique : un cadre a été réalisé
pour un personnage. J’appelle ¢a,
produire de I’humain.
ACTEURS ET HAUTEUR
Dire cela, c’est parler des acteurs.
Toute mise en scéne se définit, et
en derniére instance se juge, par ce
qu'elle fait des comédiens. En
dehors du cinéma expérimental, des
films, c’est de la mise en scéne de
relations entre des gens. Quand la
mise en scéne est n’importe quoi, on
appelle ca en général « /e cinéma
d’acteurs» — c’est-a-dire celui ou
aucune relation de possession, de
désir, d’échappée, etc., n’est pré-
sente entre les comédiens et le mou-
vement sur |’écran. Si, la encore, les
mots ont un sens, c’est bien au con-
traire du cinéma comme celui de
Blain qui est du «cinéma
d’acteurs >: car il y a la mise en
scéne, disposition d’un monde en
faveur d’individus en mouvement.
Pas étonnant, a vrai dire, si l’on
songe un instant 4 la présence ferme
et a la personnalité résolue de celui
qu’on avait appelé dans les années
60, a Paris comme a Cinecitta ou
Hollywood, le James Dean du cinéma
francais. Dans ses trois premiers
films en tant que réalisateur, a part la
sublime présence de Philippe March
dans les Amis, Blain avait utilisé des
non-professionnems, et on a cru un
moment que dans ces films les
comédiens, rigoureux, hautains, inté-
riorisés, ne jouaient pas, influencés
que nous étions par quelques phra-
ses plut6t paradoxales de Bresson
sur le jeu des comédiens. Erreur
patente quand on voit, dans Un
second souffle, les grands profes-
sionnels que sont Stack, Desmarets
et Alvina, traités exactement de la
méme facon que les non-
professionnels, en train de calculer
au millimétre prés ce qu’ils font.
Extraordinaire diversité du jeu chez
Blain. Chez Dugowson, Sautet et
Rosi, tous les acteurs jouent pareil a
Vintérieur d'un méme film. Quoi de
commun entre Sophie Desmarets et
Annie Kovacs, entre Robert Stack et
César Chauveau ? Il se peut par con-
tre que chacun de ceux-ci soit pareil
d’un film a l'autre : justement, c’est
que, jouant, c’est-a-dire s’observant,
a fond, ils sont capables de donner
leur plus intime vérité. Justesse de
Pintonation, réalisme de la gestuelle.
Un cadre pour les trouver. Se rappe-
ler les brefs plans sur le visage
d’Anicée Alvina entendant Robert
Stack, vieux con de pére, téléphoner
a son fils 4 c6té d’elle.
Les Amis. Phillipe, 50 ans, rentre
seul dans son appartement la nuit. II
y découvre Paul, 16 ans, son jeune
amant, qui l’attend endormi sur le
canapé. L’événement, dans le dérou-
Un second souffle
et Robert Stack.
lement de la fiction du film, est sur-
prenant. Mais Philippe regarde Paul
longtemps, le regarde dormir. Et le
cinéaste nous montre Philippe regar-
dant. Dans mes mots tout préts de
critique qui veut théoriser avec pas-
sion tempérée de correction, je dis :
chez Blain, l’événementiel est piégé
par, sert a, quelque chose de plus
important que lui : que les étres aient
la possibilité que soient vus et sentis
leurs comportements ; que le cinéma
valorise I’homme. Et j’ajoute, boule-
versé, qu’il y a pour Blain, cinéaste vio-
lemment non-naturaliste, quelque
chose de plus important quel’Histoire :
ce que Freud appelle «/a haute
tension ». et que cette haute tension
c’est lameilleur définition de la mise en
scéne blainienneauei’aietrouvée.
Mais je cherche d’autres mots,
plus éternels que ceux-ci, parce que
Voff du cinéma de Gérard Blain, c’est
Vharmonie que l'absence du pére fait
désirer, et que le désir d’harmonie
ne peut étre que la sensation d’éter-
nité qui le fait naitre. Et je retrouve
Vimmortel Camus, qui a écrit :
« Question : comment faire pour ne
pas perdre son temps ? Réponse:
!’éprouver dans toute sa longueur ».
Le cinéma de Blain, mise 4
l’6preuve du temps. Ce qu’un athée
assoiffé d’absolu pourrait dormuler
ainsi : que Dieu soit.
Jacques Grant
Deux aspects de la nudité : ici, Robert Stack et Anicée Alvina. Page 46, Frédéric Meismer
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5822)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1093)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (852)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (898)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (349)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (403)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Films of Carl-Theodor Dreyer (David Bordwell)Document262 pagesThe Films of Carl-Theodor Dreyer (David Bordwell)Ana-Maria GheorgheNo ratings yet
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Cohn - Mallarme's Prose PoemsDocument152 pagesCohn - Mallarme's Prose PoemsmtstNo ratings yet
- LenormandDocument38 pagesLenormandmtstNo ratings yet
- Personal - Empleo Tiempo RendimientoDocument1 pagePersonal - Empleo Tiempo RendimientomtstNo ratings yet
- Malvinas Cronologia y ArgumentosDocument6 pagesMalvinas Cronologia y ArgumentosmtstNo ratings yet
- Artes Visaules - FichaDocument2 pagesArtes Visaules - FichamtstNo ratings yet
- La Revue Du Cinéma Image Et Son N°280 (Janvier 74)Document6 pagesLa Revue Du Cinéma Image Et Son N°280 (Janvier 74)mtstNo ratings yet
- Lenormand 1Document80 pagesLenormand 1mtstNo ratings yet
- CV Mara Florencia CornideDocument2 pagesCV Mara Florencia CornidemtstNo ratings yet
- Historias Del ConcursoDocument3 pagesHistorias Del ConcursomtstNo ratings yet
- Calculo de F.O.S. y F.O.TDocument4 pagesCalculo de F.O.S. y F.O.TmtstNo ratings yet
- Von StroheimDocument391 pagesVon StroheimmtstNo ratings yet
- Cinéma N°163 (Février 1972)Document5 pagesCinéma N°163 (Février 1972)mtstNo ratings yet
- BRENEZ Nicole Approche Inhabituelle Des CorpsDocument5 pagesBRENEZ Nicole Approche Inhabituelle Des CorpsmtstNo ratings yet
- Ozep 121 Mackenzie SovietDocument6 pagesOzep 121 Mackenzie SovietmtstNo ratings yet
- The Tempest (Unproduced Script by D Nichols & J Renoir)Document93 pagesThe Tempest (Unproduced Script by D Nichols & J Renoir)mtstNo ratings yet
- 9042034580Document316 pages9042034580mtstNo ratings yet
- Gracq Julien - Entretiens 2012 CortiDocument124 pagesGracq Julien - Entretiens 2012 CortimtstNo ratings yet